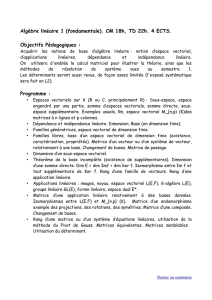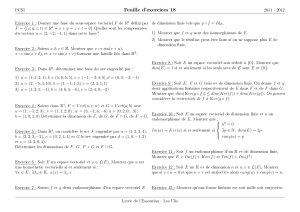Algèbre générale. - page professionnelle de Jean

1
Cours, master 2ième année, 1er semestre.
Algèbre générale.
Jean-Robert Belliard année 2006–07.

2

Table des matières
1 Factorisation des applications. 5
1.1 Rappel de vocabulaire ensembliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1 Relation d’équivalence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Applications et principe de factorisation ensembliste. . . . . . 6
1.2 Factorisation et suites exactes de modules. . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Principe de factorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.2 Suites exactes de modules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3 Problème : le lemme du serpent. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Algèbre linéaire basique. 13
2.1 fondement théorique : la dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.1 Espaces, sous-espaces et applications linéaires. . . . . . . . . . 13
2.1.2 Familles de vecteurs d’un espace vectoriel. . . . . . . . . . . . 14
2.1.3 Dimension des espaces vectoriels de type fini. . . . . . . . . . 16
2.2 Matrices.................................. 18
2.2.1 Prérequis ............................. 18
2.2.2 Représentation matricielle des morphismes. . . . . . . . . . . . 19
2.2.3 Changement de bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3 Opérations élémentaires sur les matrices. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3 Déterminant. 25
3.1 Formes multilinéaires alternées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 La forme déterminant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3 Déterminant d’un endomorphisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4 Déterminant d’une matrice carré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5 Techniques de calculs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5.1 Matrices triangulaires par blocs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5.2 PivotdeGauß. .......................... 31
3.5.3 Développement par rapport à une ligne ou une colonne. . . . . 31
3.6 Applications classiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 Dualité. 33
4.1 Dual d’un espace vectoriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 bidual ................................... 34
4.3 Orthogonalité ............................... 35
4.4 Problème : codimension des noyaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3

4
4.5 Transposée d’une application linéaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.6 Quelques calculs matriciels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.6.1 Matrice transposée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.6.2 Une utilisation du pivot de Gauß. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.7 Dualité dans les espaces euclidiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5 Formes quadratiques et hermitiennes. 43
5.1 Généralités sur les formes sesquilinéaires. . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2 Sous-espaces orthogonaux, isotropes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.3 Groupes unitaires, orthogonaux, symplectiques. . . . . . . . . . . . . 48
5.3.1 Définitions générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.3.2 symétries orthogonales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.3.3 Générateurs de O(f)et SO(f). ................. 50
5.4 Classification des formes sesquilinéaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.5 ThéorèmedeWitt. ............................ 54
5.5.1 Plan hyperbolique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.5.2 Sous-espaces hyperboliques, seti et setim. . . . . . . . . . . . . 56
5.5.3 Théorème de Witt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.5.4 Exercices : calculs d’indice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6 Réseaux. 61
6.0 prérequis à propos des Z-modules..................... 61
6.1 Sous-groupes discrets de Rn........................ 61
6.2 Théorème de Minkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.3 Applications diophantiennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.3.1 Approximations diophantiennes simultanées. . . . . . . . . . . 65
6.3.2 Equations diophantiennes linéaires. . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.3.3 Théorème des deux carrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.3.4 Théorème des quatres carrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7 Réduction des endomorphismes. 71
7.1 sous-espaces stables par u......................... 71
7.2 Théorème des noyaux et applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.2.1 théorème des noyaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.2.2 endomorphisme diagonalisable et critère de diagonalisation. . . 74
7.2.3 La version diagonalisable plus nilpotent de Dunford. . . . . . . 76
7.3 La version semi-simple plus nilpotent de Dunford. . . . . . . . . . . . 77
7.4 RéductiondeJordan............................ 79
7.4.1 Réduction des endomorphismes nilpotents. . . . . . . . . . . . 80
7.4.2 Réduction de Jordan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.5 Réduction de Frobenius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.5.1 Partie existence du théorème 7.5.3. . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.5.2 Partie unicité du théorème 7.5.3. . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Chapitre 1
Factorisation des applications.
1.1 Rappel de vocabulaire ensembliste.
1.1.1 Relation d’équivalence.
Définition 1.1.1 Soit Eun ensemble. On appelle relation d’équivalence sur Ela
donnée d’un sous-ensemble R ⊂ E×Evérifiant :
1. ∀x∈E(x, x)∈ R (réflexivité)
2. ∀x, y ∈E(x, y)∈ R =⇒(y, x)∈ R (symétrie)
3. ∀x, y, z ∈E((x, y)∈ Ret (y, z)∈ R) =⇒(x, z)∈ R (transitivité)
L’usage est de noter x∼ypour (x, y)∈ R et de dire que xet ysont équivalent pour
la relation Rou ∼. L’ensemble des éléments y∈Etel que x∼ys’appelle la classe
de x, et se note parfois x⊂E. L’ensemble de toutes les classes d’équivalence sous
une relation ∼est un sous-ensemble de l’ensemble P(E)de toutes les parties de E
et se note parfois E/ ∼. Le choix d’un, et d’un seul, élément xi∈xidans chacune
des classes produit ce qu’on appelle un système de représentants dans Ede E/ ∼.
Exemples
1. Sur tout ensemble l’égalité est une relation d’équivalence.
2. La relation de congruence modulo 10 dans Z, par définition :
x≡y[10] ⇐⇒ 10 |(x−y).
3. La colinéarité des vecteurs dans tout K-espace vectoriel, par définition
u∼v⇐⇒ ∃λ∈K, λ 6= 0 λu =v.
4. Dans un groupe Gon peut associer à tout sous-groupe H⊂Gles équivalences
à gauche et à droite modulo H, par définition :
x∼g
Hy⇐⇒ Hx =Hy et x∼d
Hy⇐⇒ xH =yH.
5. Un espace vectoriel semi-normé est un espace vectoriel muni d’une semi-norme
ϕ. Une semi-norme est une application ϕ:E−→ R+vérifiant toutes les pro-
priétés des normes sauf l’implication (ϕ(x)) = 0 =⇒x= 0. Sur un tel espace
la relation x∼y⇐⇒ ϕ(x−y)=0est une relation d’équivalence.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
1
/
86
100%