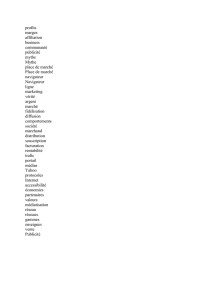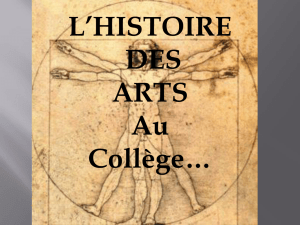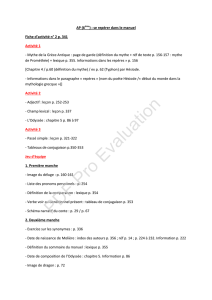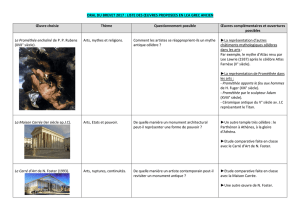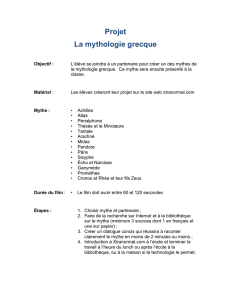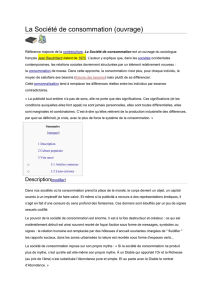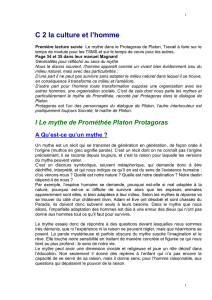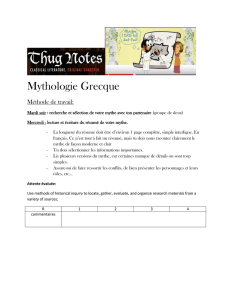Protagoras mythe

Protagoras, un Mythe qui réorganise une réflexion
Introduction
Le Mythe et le chercheur
Dans les Sciences Humaines et particulièrement en Sciences Cognitives, la place du Mythe
reste encore fragile. Il ne semble occuper qu’une place d’illustration de la pensée. Or, en
dehors du plaisir procuré par l’illustration, il me paraît s’enclencher d’autres processus
psychiques lorsque le Mythe se met au service d’une recherche. L’esthétisme du Mythe et le
plaisir qu’il procure viennent profondément revivifier les modalités psychiques. Ré
interrogeant sans cesse toute réflexion sur le monde, le Mythe plonge l’intellect dans une
dimension sensible. Le Mythe invite le chercheur qui ose le convoquer à non seulement
trouver une nouvelle cohérence à ses pérégrinations, mais il lui offre aussi la possibilité de
réorganiser, parfois radicalement, son étude. S’il renouvelle le dynamisme d’une pensée le
Mythe ne va pas, pour autant, chercher ailleurs ce qui est déjà là. Il ne s’agit pas « d’utiliser »
le Mythe comme on emploie un nouveau concept ou une nouvelle méthode de recherche. Le
chercheur entre lui-même dans l’histoire qui lui est racontée. Il y entre au sens fort : en
pensée bien sûr mais aussi en chair et en os. Ce sont toutes les dimensions de son être qui y
sont impliquées. A son tour racontant la même histoire, il en dit une autre, la sienne. Ce
faisant, il fait une singulière expérience car, réorganisant son étude, il se réorganise lui-
même. Porteur d’une dynamique réflexive, le Mythe vient en effet re-travailler la
structuration même de la personne et de son œuvre. Les chapitres consacrés aux premier et
second niveau de l’histoire traitent de la relation du chercheur avec le Mythe.
Figures du Mythe et objet de recherche
La puissance de réorganisation du Mythe réside dans quatre aspects qui le caractérisent :
- A. L’actualité du Mythe
- B. La dimension concrète du Mythe
- C. La polysémie des symboles en présence
- D. La nature analogique des processus de raisonnement.
Quelques lignes seront consacrées à cette manière particulière de toujours ré interroger nos
préoccupations présentes. La « plongée » dans le monde concret est abordée ensuite en
restituant le premier niveau de lecture de l’histoire. Puis , l’importance de la polysémie des
symboles est soulignée par la description des trois faits différenciés en contextes, figures et
relations entre les figures. Ces trois aspects des faits sont nécessairement intriqués dans le
second et troisième niveau de lecture du Mythe. La quatrième caractéristique, le
fonctionnement analogique de l’histoire, est traité dans une troisième lecture du conte. J’y
aborde la réorganisation de l’objet de recherche. Ce moment se nourrit à la fois de la
polysémie des symboles et la dimension concrète de l’objet. Il invite à vivre au présent le
fonctionnement analogique de mon raisonnement.
Ma recherche porte sur les groupes sociaux. La modélisation que je souhaite construire du
lien social dans les groupes restreints consiste à concevoir trois niveaux: le premier se
rapporte à l’action, le second à la parole et enfin le dernier met en jeu parole et action. C’est
donc sous cet angle que j’aborde le Mythe de Protagoras en considérant les trois grandes
figures Epiméthée, Prométhée et Hermes comme représentant respectivement, l’action, la
parole et enfin la simultanéité des deux instances réunies. Le Mythe raconte une histoire mais
il est en même temps l’histoire d’autre chose. Les personnages vivent une aventure que l’on
peut suivre étape par étape, c’est le premier niveau de l’histoire. Contrairement à un conte

classique, le personnage est aussi une figure symbolique. Epiméthée est un personnage de
l’histoire, mais il est en même l’histoire. Le Mythe porte une dimension imaginaire qui
dépasse les personnages et les fait entrer en correspondance avec chaque lecteur. Les
contextes, les caractères des personnages et leurs relations rencontrent donc autant de
significations que de lecteurs.
Naturellement l’esprit au travail ne fonctionne pas en linéarité, cependant, pour aider à la
compréhension de mon propos je ponctue en neuf séquences le Mythe de Protagoras afin de
faciliter le repérage des modifications opérées à chaque niveau de lecture.
Le premier niveau de l’histoire : les étapes du Mythe de Protagoras
1) Tirées de la terre et du feu, les espèces mortelles furent jadis créées par les Dieux.
Mais elles ne pouvaient sortir des sombres entrailles de la terre qu’avec l’aide de deux Titans.
Zeus lui-même les désigna : Epiméthée et Prométhée.
2) Zeus avait chargé les deux frères de pourvoir toutes ses créatures de qualités qui leur
permettraient de se conserver au mieux une fois qu’elles seraient exposées au grand jour.
Elles devaient donc être capables d’assurer leur survie par leurs propres moyens.
3) Epiméthée proposa à Prométhée d’effectuer seul ce travail et de revenir seulement
l’examiner lorsqu’il aurait terminé. Ainsi Epiméthée exécuta sa mission, chaque espèce fut
pourvue d’une compétence qui lui permettait de sauvegarder sa race et toutes les qualités
furent ainsi distribuées : à une petite taille, on donnait la vitesse ou des ailes ou la capacité à
creuser un terrier, contre le froid, des poils, pour marcher, des sabots…
4) Mais lorsque toutes les qualités furent distribuées, il n’en restait aucune pour les
hommes. L’homme n’avait ni fourrure, ni sabots, ni crocs, il ne savait ni courir vite ni
grimper aisément dans les arbres. Il n’avait pas de griffe pour se défendre. Epiméthée avait
oublié les hommes dans sa distribution.
5) Lorsque Prométhée vit qu’Epiméthée n’avait rien laissé aux hommes, et dans
l’urgence du moment, car les espèces allaient être amenées à sortir de terre, il décida de voler
à Athéna et Héphaïstos l’art et le feu. Alors les hommes purent utiliser l’art de la mécanique
pour construire des choses utiles à leur survie : maisons, vêtements, ils pouvaient manger des
aliments cuits…
6) Mais, s’ils pouvaient pourvoir aux besoins essentiels, ils ne savaient cependant pas
coopérer, s’assembler, s’associer pour mener ensemble des projets car ils n’avaient pas reçu
l’art de la politique qui incluait aussi celui de la guerre. Cela eut pour conséquence qu’ils
vivaient isolément et étaient encore très fragiles face au monde extérieur. Même s’ils
pouvaient de temps à autre construire des villes, ne possédant pas l’art de la politique, ils
s’entretuaient encore bien souvent ou repartaient séparément de leur côté ce qui les mettait de
nouveau en danger.
7) Zeus voyant que la race des hommes risquait de s’éteindre fit appel à un autre
personnage mythique. Il demanda à Hermes de faire parvenir aux hommes la pudeur et la
justice. Ces deux vertus étaient celles de la politique.
8) Lorsque Hermes dut remettre aux hommes la connaissance de la politique, il ne savait
pas comment la répartir. Devait-il la partager, comme les autres arts pour que certains y soit
experts et utiles à un grand nombre de profanes ou devait-il la distribuer à tous ?

9) Zeus voulu que l’on partageât entre tous les hommes afin que les cités puissent exister,
il ajouta : « Etablis en outre, en mon nom cette loi que tout homme incapable de pudeur ou de
justice sera exterminé comme un fléau de la société.»
1
.
A. L’actualité du Mythe
La puissance des Mythes réside dans le fait qu’ils sont régulièrement investis dans
l’histoire des hommes. Les légendes peuvent prendre des formes différentes, mais les
archétypes sont fondamentalement toujours les mêmes : la légende du Roi Arthur ou celle du
Seigneur des anneaux joue la même fonction chez les adolescents quelles que soient les
générations.
Protagoras a pour moi, poser immédiatement et très clairement le problème que j’aborde
dans mon étude à savoir « la condition d’humanité de la race humaine ». Tout individu qui
n’usera pas de ces qualités qui lui ont été assignées dès sa naissance, à savoir la tempérance
et la justice ne sera pas en droit de prétendre à être reconnu parmi les Hommes. Il sera
renvoyé, au-delà même de sa condition d’animal, à la terre dont il est sorti. L’homme est
nécessairement politique ou n’est pas. IL est donné à l’être humain d’être social, de cohabiter
avec ses semblables ou de disparaître de la société et par conséquent de disparaître tout court
en tant qu’homme.
Cette « radicalité » de l’être social n’est pas sans poser problème. En quoi peut-on encore
aujourd’hui reconnaître cette exigence imposée aux êtres humains ? Est-il toujours d’actualité
pour l’homme d’être capable de pudeur et de justice sous peine de relégation au statut de non
humain ? Si oui, quelle nature particulière constitue cette compétence politique ?
Pour répondre à cela, je ferai appel à la compréhension paradoxale des réalités sociales. Mon
hypothèse rejoint celle de Protagoras, c’est à dire qu’elle sort des limites d’une pensée
contradictoire.
B. Passage à la dimension concrète de l’histoire
Lorsque j’entre dans le Mythe au premier niveau, je suis le déroulement du conte. Je perçois
des images, des couleurs. J’ai devant les yeux les personnages, je les entends. Je suis comme
devant un écran de cinéma, je vois agir les acteurs. Si le film est bon, je me laisse emportée
par l’histoire. J’accompagne les personnages dans leurs ressentis, leurs émotions. Bien
entendu, j’ai conscience d’être à l’écoute d’une histoire, je ne confond pas les niveaux de
réalité, pourtant, tant que rien ni personne ne vient m’en sortir, je suis aussi dans l’histoire, j’y
crois.
L’imaginaire dans lequel je suis entrée est sensible, il est proche des sensations du corps, de
mes perceptions physiques. Je me laisse envahir aussi par des ressentis plus profonds comme
la colère, la peur ou la tristesse. La lecture d’une histoire, d’un roman, d’un Mythe est très
différente de la lecture d’un ouvrage de philosophie ou de tout autre livre ou article comme
celui-ci qui ne font appel qu’à ma raison, mon intellect. Chaque histoire est un cas particulier,
chaque personnage est unique, chaque situation est contextualisée et n’est identique à aucune
autre.
Lorsque l’on parle de faire résonner des sensations, faire revivre des sentiments ou raviver la
mémoire physique d’un événement, cela signifie : faire vivre une situation singulière et aider
l’esprit à la transposer à une autre vécue dans le présent. La dimension « actualisante » du
Mythe est liée à cette qualité d’investir le monde physique. Le raisonnement transductif de la
pensée fait passer d’un cas particulier à un autre cas particulier sans passage à l’abstraction,
1
Platon, « Protagoras », Flammarion,1967, p 54.

c’est ainsi que procède le Mythe. Le premier niveau de lecture de l’histoire en rencontre un
autre qui entre en correspondance avec lui.
Ce que je tiens à souligner là est l’importance des aspects concrets, singuliers de l’histoire
racontée. Dans cette imagerie, nous ne sommes pas dans l’abstrait, la généralisation ou
l’abstraction. L’esprit repose sur des sensations.
C. Polysémie des Symboles
Le Mythe relie les deux figures opposées d’Epiméthée et de Prométhée, dans celle de
Hermes. La polysémie des figures symboliques du Mythe m’autorise à y substituer les
significations qui me sont nécessaires pour avancer dans mes préoccupations. En l’occurrence
je cherche à comprendre ce qui relie les hommes dans les groupes. C’est ce qui m’est raconté
par la distribution à tous de l’art de la politique. Mais au-delà de cela, les contextes, les
figures et les liens qu’ils instaurent entre eux me disent autre chose et viennent nourrir mon
imaginaire.
Le second niveau de l’histoire parle à l’imaginaire
Je reprends ici les neuf points de l’histoire racontée afin de montrer en quoi chaque étape va
nourrir ma pensée. Je décris les significations que ces étapes prennent pour moi à la lecture du
Mythe.
Les contextes
1) L’étape sous terre.
Au début, dans un tout premier temps de l’humanité, une expérience concrète, matérielle,
physique est donnée à voir. Celle où le corps est engagé tout entier dans l’indéterminé, le
chaos, le magma indifférencié de la matière. L’homme est ici, si impliqué dans la matière
inorganique qu’il y est encore tout englué. Il y est plus minéral qu’animal. Il ne se distingue
pas d’un tout désordonné. Aucune forme d’organisation n’a encore émergé.
2) Sortie à la lumière
Ensuite, l’homme entre dans le règne animal. Il n’est pas encore entièrement sorti des
ténèbres, il n’est pas, non plus, tout à fait dans la lumière. Mais après l’étape minérale, il
devient organique. Il est vivant c’est à dire biologique. IL est donc organisé. Il possède un
sens vital. Cela signifie qu’il prend une forme distincte du chaos et se retrouve par
conséquent dans l’obligation de sauvegarder cette forme. Pour ne pas revenir à son état
antérieur, c’est à dire désorganisé, non construit, l’homme devra maintenir son organisation.
C’est la première préoccupation de Zeus que de donner à cet être vivant, comme aux autres,
des capacités de survie.
Or, pour survivre, l’homme doit s’adapter à son milieu. Tout le temps où il reste loin de la
lumière, il est protégé par le fait qu’il n’est pas distingué des autres matières qui le
constituent. Il reste invisible à lui-même et aux autres.
Dès lors que l’homme est identifié donc distinct du chaos, qu’une organisation émerge, il doit
s’auto organiser pour se maintenir dans ce nouvel environnement. Le symbole de la lumière
est bien entendu celui du savoir, de la connaissance, mais je dirai surtout d’un savoir-faire,
d’un savoir-agir qui est donné aux êtres biologiques pour défendre leur race. Il s’agit du
savoir de l’action.

Ce nouvel environnement est à la fois le même : la terre, l’air, le feu, l’eau, mais s’y ajoute la
lumière, c’est à dire la possibilité de voir et d’être vu. La lumière offre de nouvelles
capacités aux êtres vivants: celle d’espacer les choses, celle de distinguer et de se distinguer.
L’homme reçoit avec la lumière la capacité d’élucidation du monde, de le/se mettre à
distance.
Les figures
3) a) Le double accompagnement
Le changement d’un état initial (sous terre) à un autre (sur la terre) n’est pas immédiat et
spontané. Au contraire, il semble qu’il s’agisse d’un passage et que le cheminement devra
être accompagné. Le chemin n’est ni tracé ni donné. Il faut être guidé pour sortir de l’ombre
et aller vers la connaissance, la lumière. C’est pourquoi Zeus décide de la présence de deux
personnages pour aider les vivants à s’organiser.
Il est intéressant de voir la nécessité d’une part de faire appel à quelqu’un pour accompagner
le changement d’état initial non organisé à l’état vivant organisé et d’autre part d’agir dans le
sens de l’autonomie de l’être, de lui attribuer les moyens de sa propre survie afin qu’il n’ait
plus besoin d’accompagnement.
Epiméthée et Prométhée sont donc chargés de cette initiation. Ils sont frères, ils se
ressemblent puisqu’ils sont issus de la même lignée de Titans. Ils ont en commun les mêmes
parents, pourtant, ils sont toujours opposés, différents. Epiméthée est l’antithèse de
Prométhée. Dès qu’il agit, toutes ses actions sont en défaveur des humains. C’est lui qui,
désobéissant à Prométhée, ouvrira la boîte de pandore répandant sur terre tous les malheurs
de l’humanité. C’est à lui qu’est attribué l’oubli des hommes dans la distribution des qualités
vitales.
L’accompagnateur a donc une double figure dans la légende de Protagoras : la figure de celui
qui ajoute les difficultés sur le chemin à suivre l’autre qui vient au contraire les aplanir.
L’un ne va pas sans l’autre, ils entretiennent une indispensable dynamique inversée qui tantôt
fait avancer l’un, tantôt met l’autre en marche. Cette figure contradictoire ouvre à l’homme
toute liberté de choisir son modèle, d’avancer pas à pas sur le fil de l’ombre ou de la lumière,
du malheur ou de la félicité.
b) Mortalité et immortalité de l’homme
Epiméthée se distingue de Prométhée par le fait qu’il restera mortel. A un premier niveau
de logique individuel, les hommes sont confrontés à leur mortalité. Comme Epiméthée, ils
sont inscrits dans le cycle concret de la nature : ils naissent et meurent après avoir passé plus
ou moins de temps sur terre. Pourtant, par la procréation, ils perpétuent leur espèce. Faute de
prétendre à une nature divine, comme tous les animaux, le niveau collectif permet de
prétendre à l’immortalité. Elle est représentée par Prométhée.
L’immortalité de Prométhée ajoute autre chose à ce statut naturel de l’homme. Prométhée par
ses propres exploits a conquis son immortalité. Elle ne lui est pas donnée immédiatement, il
doit faire un exploit pour l’obtenir. Pour être un homme ordinaire, il faut faire des actes
extraordinaires. Prométhée n’est plus seulement un Titan, il s’élève au rang des Dieux de
l’Olympe. De même, certains parmi les hommes se différencient des animaux par leur
capacité à produire des choses exceptionnelles. Si le travail lui permet de survivre, l’œuvre
prolonge sa vie au delà de la mort terrestre. La parole entre dans la mémoire. Par sa capacité
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%