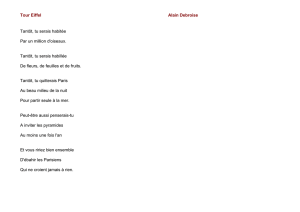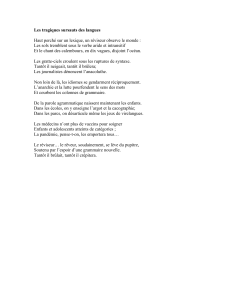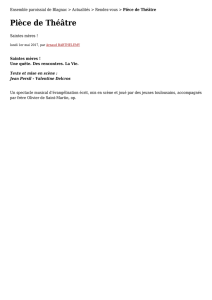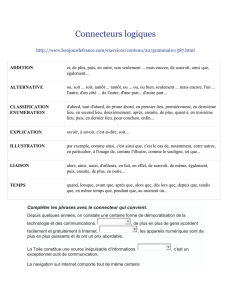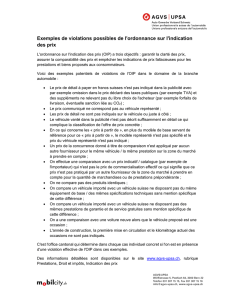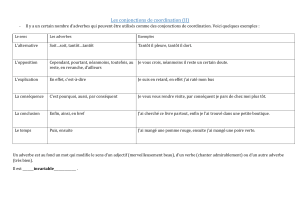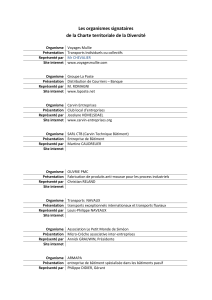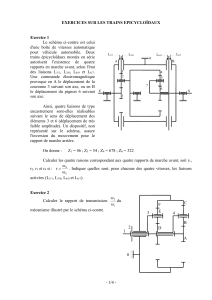la représentation du cancer dans la peinture et la sculpture

LA REPRÉSENTATION DU CANCER DANS LA PEINTURE ET LA
SCULPTURE
Émilie ANTOINE, Flora BARTOT, Ludovic JOUANOLOU, Harmonie SONGY
La représentation du cancer au travers de la peinture ou de la sculpture, bien qu’observée depuis des
siècles, a connu une évolution au fil du temps. En effet, au cours de l’histoire, les peintres ont d’abord
cherché à représenter le cancer tel qu’il pouvait se voir, c'est-à-dire par des « grosseurs » difformantes. Puis,
avec l’émergence de la chirurgie et par la suite de nouveaux traitements aux effets secondaires visibles tels
que la chimiothérapie, est apparue une nouvelles forme de représentation, résultant des conséquences de ces
pratiques, mais surtout permise grâce à une évolution des mentalités (religieuses, sociales).
Le cancer le plus représenté reste le cancer du sein, ce qui se comprend facilement du fait qu’il est
l’un des plus fréquents et qu’il peut présenter des signes extérieurs extrêmement visibles. De plus il touche le
sein, organe symbole de vie et qui par la maladie devient paradoxalement le siège d’une mort possible.
D. Gros, sénologue, fait l’hypothèse que les nombreux tableaux de la
Renaissance mettant en scène des femmes, saintes chrétiennes, qui eurent les seins
mutilés pour avoir refusé d’abjurer leur croyance, représentent en fait la crainte des
contemporains devant le cancer du sein et ses traitements. Plusieurs œuvres en effet
dépeignent les scalpels et bistouris utilisés par les chirurgiens de l’époque (dont la
tenette d’Helvétius), ainsi que le processus de cautérisation suivant l’ablation,
représenté alors par les fers brûlants aux pieds des saintes (Barbe, Agathe, Julie ou
Christine). Leurs martyrs permettraient des questionnements sur la destruction du beau,
du charnel, de la maternité et de la sexualité, ils mettraient en doute la toute-puissance
humaine face à l’inquiétante étrangeté du corps intérieur.
Raphaël avec Fornarina en 1520 ainsi que Rembrandt avec une Bethsabée au bain, de
1654 ont également peint des femmes, leurs maîtresses ayant une adénopathie axillaire.
Plus récemment, ce qui est représenté n’est plus le cancer, mais son traitement : l’ablation
d’un sein et la chute de cheveux, signes irrémédiables de la perte de féminité des patientes. Le
cancer est alors tantôt représenté selon les artistes, en tant qu’outil de mort et de perdition, ce qui
se traduira par un regard perdu, une faiblesse extrême, la sensation que son propre corps est
étranger comme dans l’Autoportrait de Kirst Ottem…, ou tantôt en tant que « simple maladie »
dont l’artiste souhaite dédramatiser les conséquences. Ainsi, le Portrait d’Evelyn par Heath
Rosselli a pour vocation de montrer que le sujet n’est pas aussi déformé par l’opération que les
gens pourraient l’imaginer, et cherche à apporter de l’espoir et du réconfort auprès des femmes
faisant face à la mastectomie.
Certains cancers, tel que le cancer colorectal, ne sont visibles que très tardivement
et se traduisent par des signes extérieurs moindres : on trouve des représentations du
caractère insidieux de son installation à l’insu du patient, par des arbres apparemment sains
mais dont les racines servant à puiser les nutriments (comme l’intestin) montrent déjà des
anomalies.
Le cancer est une pathologie qui continue de susciter de l’émotion, traduite dans les œuvres ; en
effet, elle touche de plus ou moins près chacun d’entre nous alors que nous n’y sommes pas préparés. Le
diagnostic constitue bien souvent les prémisses de mois ou d’années de lutte et d’incertitude, représentés par
de nombreux artistes.
Sources : http://www.kirstio.com ; http://www.fnclcc.fr ; http://www.antoinegaber.com ; http://www.canceranswers.org
1
/
1
100%