etre et humanisme - L`Art du Comprendre

ÊTRE ET HUMANISME.
HEIDEGGER ET GIORDANO BRUNO:
UNE POSSIBLE CONFRONTATION
p a r L u c a S a l z a
Et si « Nature » devenait le nom de l’« Etre » ?
Au cours de l’année 1940, Heidegger fit un séminaire à l’Université de Fribourg-en-Brisgau sur la Physique d’Aristote.
Quelques années plus tard, le philosophe reprit ce travail dans un texte qu’il allait intituler Ce qu’est et comment se détermine
la phusis. La première partie de ce texte, publié en français dans Questions II, est destinée à analyser les différentes portées
qui ont été attribuées au mot « Nature », aux diverses périodes de l’histoire occidentale. Parmi les autres périodes, Heidegger
nous présente une signification du mot « Nature » qu’il a observée dans l’hymne Wie wenn am Feiertage de Hölderlin. Le
poète allemand avait écrit : « Or maintenant le jour pointe ! Je l’espérais, le vis venir. / Et ce que j’ai vu, le Sauf soit ma
parole. / Car elle, elle-même, qui plus ancienne que les âges / Et sur les dieux du soir et d’orient est, / La Nature est à présent
dans le fracas éveillée, / Et haut, depuis l’Ether jusqu’à l’abîme en bas / Selon ferme statut, comme jadis, d’un chaos sacré
engendrée, / Sent neuve l’Inspiratrice, soi, / La Toute-créatrice, à nouveau »1.
Il est clair qu’il s’agit de la reprise de la part de Hölderlin d’un thème d’origine matérialiste, c’est-à-dire le primat
ontologique de la Nature. Heidegger le comprend assez bien lorsqu’il commente ces vers : « "Nature" devient ici le nom pour
ce qui est au-dessus des dieux et "plus ancien que les âges", ces âges où, chaque fois, de l’étant devient étant. "Nature"
devient le nom pour l’"être"; car l’être est antérieur à tout étant, qui emprunte de lui ce qu’il est ; et sous l’"être" sont aussi
tous les dieux, dans la mesure où ils sont, et quelle que soit aussi leur manière d’être ». Jusqu’ici il s’agit d’un commentaire
bien équilibré et il ne semble pas que Heidegger entende opposer « Nature » et « Etre ». Mais immédiatement après, le
philosophe allemand se montre bien moins complaisant envers ce genre de pensée : « Ici, l’étant dans son ensemble n’est pas
plus mésentendu dans un sens "naturaliste" (c’est-à-dire ramené à la "Nature" au sens de la matière douée de force) qu’il n’est
obscurci dans une "mystique" et délayé dans l’indéterminable »2. Dans cet article, nous nous proposons justement
d’expliquer la motivation du refus de la part de Heidegger de la perspective naturaliste et, par conséquent, les objections
possibles qui pourraient être faites à une philosophie sans Nature, comme celle de Heidegger, par une philosophie de la
Nature, représentée en l’occurrence ici par Giordano Bruno.
Dans le petit commentaire sur Hölderlin, on découvre les deux raisons pour lesquelles Heidegger se montre ainsi hostile
au naturalisme. Dans la philosophie de la Nature, il serait inconcevable de penser le retrait de l’Etre et par conséquent il n’y
aurait pas de place pour la différence ontologique. Notre intention est de passer ces questions au tamis de la « nouvelle
philosophie » de Giordano Bruno. En effet, si l’on conçoit la Renaissance non pas seulement comme une époque « figée » de
l’histoire, et donc dans une perspective purement historiographique, mais aussi comme un « fait » philosophique, comme
Bruno Pinchard l’a suggéré lors d’un colloque effectué à Tours en 19953, on est autorisé à faire une comparaison avec la
pensée contemporaine. Une comparaison qui se fonde moins sur des faits (Heidegger n’a jamais parlé de Bruno mais ce
silence est peut-être éloquent, autant que son silence sur Spinoza) que sur des concepts philosophiques et sur la manière de
les affronter. Dans cette perspective, on peut imaginer un Bruno interprète de Heidegger. Quelle serait alors la réaction du
Nolain face aux objections anti-naturalistes de Heidegger ?

Suivant Héraclite, Heidegger a compris l’Etre non seulement en tant que dévoilement, présence, mais aussi en tant que
voilement, absence : « L’être des choses aime à se cacher ». Dans cette sentence, on a la preuve que l’émergence, la phusis,
est aussi voilement. Cela est possible car Héraclite a démontré le caractère essentiel de l’alethéia, qui n’est pas simplement
oubli de l’Etre, mais qui est liée à l’altérité, à la différence de l’Etre, au fait qu’il est absent par rapport aux choses présentes
(il se retire derrière les choses). Or, l’histoire de la pensée occidentale serait marquée par le fait qu’elle a voulu penser l’Etre
seulement dans sa présence. Seulement, dans la pensée initiale, Heidegger voit une possibilité de penser la « vérité de
l’Etre », justement parce que celle-ci arrive à penser l’altérité de l’Etre en tant que présence face au présent. La différence
entre présence et présent, la différence ontologique, est déjà oubliée lorsque l’on essaie de nommer cette présence. La
première faute du naturalisme serait donc d’avoir voulu donner un nom à l’Etre : « Lorsque la présence est nommée, il y a
déjà représentation de présent. Au fond, la présence en tant que telle n’est pas distinguée de l’étant présent. Elle ne passe que
pour le plus général et le plus élevé des présents, donc pour un présent »4. Il s’agit d’un point bien précis dans la philosophie
heideggerienne : pour assurer la véritable différence de la présence, de l’Etre, il ne faut pas la nommer. Dès que l’on a voulu
dire la présence, on l’a aussitôt oubliée. Cela découle pour Heidegger d’une conception du Logos comme simple
« manifestation ». L’Etre devient alors le suprême étant, la raison de tout étant, et en conséquence un pur objet de
représentation. Si, en revanche, on entend le Logos comme « Pose recueillante », on peut penser pouvoir mettre l’Etre à l’abri
dans l’Etre du langage (c’est ce que nous lisons en conclusion de la Lettre sur l’humanisme). Cette alternative est aussi celle
de toute l’histoire de la philosophie. D’un côté, une pensée où l’étant a submergé l’Etre, donc une pensée de l’objectivation,
de l’étantisation de l’Etre, de l’autre côté, une pensée qui, grâce aux ressources du langage poétique, peut sauvegarder l’Etre
dans sa différence.
Le philosophe allemand revient clairement sur ces interrogations dans un article de 1955, écrit en hommage à Ernst
Jünger. Il s’agit de Zur Seinsfrage (Sur la question de l’Etre) dans lequel Heidegger utilise le nom de l’être uniquement s’il
est rayé : seule sa disparition permettra de se délivrer de la prétention objectiviste : « Cette biffure en croix ne fait d’abord
que défendre en repoussant, à savoir : elle repousse cette habitude presque inextirpable, de représenter l’ "Etre" comme un
En-face qui se tient en soi, et ensuite seulement qui advient parfois à l’homme. Selon cette représentation il semble alors que
l’homme soit excepté de l’ "Etre". Or non seulement il n’en est pas excepté, c’est-à-dire non seulement il est inclus dans l’
"Etre", mais l’ "Etre" est tenu (…) de rejeter l’apparence du Pour soi, raison pour laquelle il est aussi d’une autre essence que
celle que voudrait accréditer la représentation d’une Omnitude embrassant la relation Sujet-Objet »5. La garantie de la
sauvegarde de l’Etre ne semble plus assurée dans la langue, fût-elle poétique. Seul le silence semble encore pouvoir rendre
compte du voilement de l’Etre, qui se doit d’être le plus indéterminé possible afin d’éviter toute représentation, même
linguistique. L’opposition heideggerienne envers un type de pensée objectivante devient de plus en plus forte. Dans cette
perspective, la métaphysique n’est pas l’erreur de tel ou tel penseur (ou de tous). Elle est avant tout une modalité selon
laquelle l’être lui-même se détermine, ce qui advient sans aucun doute dans l’activité de l’homme et, d’une certaine manière,
par lui.
Dans l’interprétation de Heidegger, il est clair que la philosophie de la Nature représente une variante, peut-être l’une des
plus dangereuses, de cette pensée, à savoir de l’onto-theo-logie, la philosophie d’une totalité « close ». La philosophie de la
nature veut exprimer la plénitude de l’être, mais elle ne peut le faire qu’en s’objectivant, c’est-à-dire en donnant une
représentation de soi-même, à laquelle tous les étants doivent rendre compte.
Mais peut-on vraiment réduire tout le naturalisme à l’histoire de la métaphysique ? Nous pensons qu’en revanche, nous
pouvons soustraire la philosophie de la nature à cette histoire, si nous gardons à l’esprit la façon dont la question a été traitée
par Bruno. Nous ne revenons pas sur ces questions car nous avons déjà essayé de dire, dans ce même numéro de L’art du
comprendre, que la philosophie brunienne n’est ni une philosophie de la représentation, ni une philosophie de la totalité
« close ».
La matière brunienne n’est pas toute la réalité (puisque Bruno rejette une pensée de la totalité), mais elle peut, avec
vicissitude, devenir toutes les choses. Cela peut avoir lieu car la matière a toute la réalité, a toutes les choses, mais n’est pas le
Tout totalement, car ses choses ne sont pas éternelles (c’est la raison de la polémique contre les formes aristotéliciennes),
mais plutôt elles deviennent sans cesse. La matière n’a aucune forme particulière, non pas parce qu’elle en est dépourvue,
mais parce qu’elle les a toutes6. Ce qui ne comporte jamais cependant qu’elle soit totalement accomplie, puisqu’elle
comprend d’infinies possibilités non réalisées. C’est en ce sens que nous pouvons comprendre la différence que Bruno établit
entre l’infinité divine et l’infinité naturelle. Dans un passage du De l’infini, Bruno déclare avec fermeté que « l’infinito non
può essere compito » (l’infini ne peut être achevé)7. Ainsi l’infini brunien se rattache à des sources très anciennes avec deux
conséquences importantes. Cela signifie en premier lieu que Bruno peut fonder une philosophie du devenir et non pas une
philosophie de la totalité « fixe », et en deuxième lieu qu’il évite les pièges d’une pensée de la représentation en attribuant un
primat génésique à la Nature et non à l’homme (c’est pourquoi toutes les différentes formes d’idéalisme de Hegel jusqu’à
Cassirer n’ont jamais vraiment compris la portée de la philosophie de Bruno). L’Un brunien conserve son indicibilité
précisément parce qu’il est toujours en devenir, il est illimité. L’infini doit être « poursuivi sans fin » (« infinitamente
perseguitato »8), il est donc évident qu’il n’existe pas chez le Nolain un sujet qui se voudrait maître de l’étant, en réduisant la
totalité au rang d’objet de sa représentation.
Il n’y a pas de totalité « déterminée » car le fondement est indéterminé. Il n’y a pas de représentation, car cette
indétermination ne peut jamais être complètement atteinte. Nous sommes des ombres (ou dans l’ombre)9 et donc nous ne
pouvons pas avoir une vision accomplie de l’Etre. Au contraire, l’être se dérobe continuellement. On trouve la même
formulation du problème dans le De docta ignorantia de Nicolas de Cues : « L’infini, en tant qu’infini, en échappant à toute
proportion, est inconnu » (De docta ignorantia I, 1, par. 3). Si Bruno a donné le nom de « Nature » à l’« Etre » il n’a
cependant pas pour autant réitéré une onto-théologie. La Nature reste toujours impossible à atteindre.

Il est évident qu’une telle conception ne peut être réduite à une pensée de la représentation. Etant donné que la nature
infinie se fonde sur une matière infinie, elle reste réticente à toute objectivation. En revanche, le fond de la Nature demeure
caché. Pour reprendre une autre expression présocratique, la vérité reste dans un abîme (Démocrite)10.
C’est la raison pour laquelle nous défendons l’idée que la nova filosofia de Bruno ne devient pas une onto-théologie.
Heidegger, dans sa tentative de rassembler toute la philosophie occidentale en un seul schéma, a oublié la spécificité de la
philosophie de la nature renaissante. La Nature de Bruno reste toujours impossible à atteindre. Elle est présente, mais
toujours mystérieuse. Un abîme. Néanmoins, elle n’est pas quelque chose de transcendant, puisque le mystère est dans les
choses mêmes, dans la réalité. À la différence de Heidegger, Freud avait bien compris que l’on ne pouvait pas réduire la
philosophie de la Nature de la Renaissance à une pensée de l’étantisation. Il clôt son admirable livret sur Léonard de Vinci en
évoquant cette conception renaissante de la Nature : « la Natura è piena d’infinite ragioni che non furono mai in isperienza »
(la Nature est pleine d’innombrables raisons qui n’ont jamais accédé à l’expérience)11. Par ailleurs, nous pensons que ce
caractère irréductible de la Nature est le signe le plus évident de la démarcation entre la philosophie de la Renaissance et la
nouvelle science du XVIIe siècle.
La « mesure » : le langage imaginatif de la poésie
S’il existe un philosophe qui mérite d’être écouté sur cette question du rapport entre Heidegger et la Renaissance, c’est
Ernesto Grassi, en tant qu’ancien élève de Heidegger et spécialiste de l’humanisme italien. Grassi peut nous intéresser pour
différentes raisons. Il démontre que la critique heideggerienne de la pensée occidentale ne vise pas l’humanisme renaissant
car la Renaissance ne pense pas dans les termes d’une « vérité logique »12. À cette aune la polémique de Heidegger est
injustifiée du point de vue historique. L’humanisme se développe sur la base d’une forte résistance à la pensée logique13. En
ce sens, il révèle des « parallèles surprenants » avec la pensée de Heidegger lorsqu’il repère, lui aussi, la seule voie d’accès à
l’Etre dans le langage de la poésie. Il est intéressant de remarquer le fait que Bruno entre pleinement dans cette lignée
philosophique qui remonte à Dante14.
Le Nolain a toujours combattu l’aristotélisme parce qu’Aristote avait inauguré un genre de connaissance fondé sur la
« rationalisation » de la Nature. L’erreur d’Aristote est d’avoir superposé la logique à la Nature15. Cette dernière, en
revanche, ne peut jamais être réduite à la tentative de la saisir de manière définitive.
Dans le premier chapitre de cet article, nous avons essayé de démontrer que, tout comme la pensée heideggerienne, la
philosophie de la Nature brunienne laissait être l’Etre, c’est-à-dire qu’elle laissait la Nature dans sa différence absolue par
rapport aux étants.
La philosophie de la Nature de la Renaissance se refuse à arracher ses secrets à la Nature, elle ne veut jamais la violer.
C’est alors qu’intervient, comme chez Heidegger, l’imagination : seule la poésie des images saurait être fidèle au vœu de la
nature. La Nature ne peut jamais être comprise « logiquement ». Elle ne peut être exprimée qu’à travers le langage
poétique16. La poésie sert justement à ne pas contraindre violemment au vrai la Nature, à ne pas la conquérir. En revanche, la
Nature doit émerger dans les images que seul le poète peut offrir.
C’est la raison pour laquelle le statut de la poésie devient fondamental chez Bruno, surtout à partir des Fureurs héroïques.
Au début de l’œuvre, le Nolain nous dit que l’inspiration poétique dérive des nombreux obstacles que son programme
philosophique a rencontrés à Londres. Bruno est arrivé en Angleterre deux ans auparavant avec l’espoir de mener à bien sa
« révolution copernicienne », qui consistait à construire une philosophie de l’infini sur la base de la découverte (ou plutôt de
la redécouverte) de l’héliocentrisme. Ses premières œuvres (les œuvres cosmologiques) sur le territoire anglais ne lui
permettent guère d’affirmer sa pensée. Les intellectuels anglais se révèlent indifférents à la nova filosofia de Bruno, et, pire
encore, ils se montrent très agressifs. C’est à ce moment précis que le Nolain décide de se tourner vers les Muses : « Enfin
pour avoir été victime de l’autorité de censeurs qui, le détournant des choses plus dignes et plus hautes auxquelles par nature
il inclinait, entravaient son génie : en ce sens que, de libre qu’il était sous le règne de la vertu, ils le rendaient captif sous celui
d’une très vile et stupide hypocrisie. Mais finalement il s’est produit que dans le bouillonnement de tant d’ennuis où il était
plongé, n’ayant rien d’où tirer consolation, il se rendit à l’appel de celles dont il est dit qu’elles l’enivrèrent de fureurs, de
vers et de rimes dont elles n’étaient jamais parées aux yeux de nul autre : aussi bien cette œuvre brille-t-elle plus par
l’invention que par l’imitation »17.
Dans un premier temps, le Nolain explique son retour vers les Muses par la simple volonté de se « consoler » des attaques
provenant de la philosophie « officielle », mais il ajoute également qu’il lui sera possible de se « consoler » dans la mesure où
les Muses pourront le faire s’enivrer de « fureurs ». Nous sommes sur le seuil d’un des thèmes centraux de la philosophie de
Bruno, qu’il est nécessaire d’examiner plus attentivement.

Dans les Fureurs héroïques, le thème de l’invention, de la liberté à l’égard des règles, s’entremêle avec la critique des
poètes de son temps, en premier lieu des pétrarquistes. Lorsque Bruno en vient à la poésie, il sent immédiatement l’exigence
de se démarquer de ses contemporains, d’autant plus que sa réflexion a pour sujet l’amour, le même que les pétrarquistes. Le
furor caractérise une écriture qui se démarque âprement d’une conception de la littérature comme pur plaisir (le pétrarquisme
selon Bruno). Le Nolain vise à affirmer une conception différente de la littérature. Le pétrarquisme du Cinquecento a
fortement contribué à construire une poésie qui n’avait d’autre reflet qu’elle-même. Bruno lutte violemment contre une
littérature qui prétend se suffire à elle-même, une écriture-miroir qui a uniquement son image comme point de référence. Les
pétrarquistes, en réduisant la poésie au chant de l’amour « animal » pour les femmes, appauvrissent la littérature, au même
titre que ceux qui écrivent pour exalter les mouches, les blattes ou les ânes (la poésie comique, à la Berni). La polémique
brunienne veut rétablir la portée gnoséologique que peut détenir la littérature, en s’opposant à une utilisation qui la dégrade
fortement, et en disant des plaisanteries et en chantant l’amour des femmes. Le furor, qui provient d’une longue tradition
platonicienne, sert à donner un nouveau rôle à la littérature. Et ceci, en réactivant la communication entre l’humain et le
divin. Quand l’homme « s’élève à la divinité »18, il saisit également le problème de comment parler avec elle. Il découvre
que seul le langage poétique peut lui permettre de « vivre » ce rapport.
Le lien qui existe entre l’écriture et la recherche du vrai a été analysé dans la philosophie présocratique puis repris par la
tradition platonicienne. Platon a fort bien indiqué comment l’enthousiasme (ce qui nous conduit vers les dieux, la fureur)
s’associe à la poésie. Dans les pages du Phèdre, il parle d’un troisième type de « délire » (Phèdre, 245a), celui que les Muses
introduisent dans l’âme humaine. Dans ce cas, la poésie devient la langue qui nous permet de nous « exciter », c’est-à-dire de
nous faire communiquer avec les dieux. Nous retrouvons les mêmes idées dans des pages mémorables de l’Ion (533d-535a).
Cette poésie « furieuse » dépasse largement la poésie (et, en général, le langage) des « sages ». Mais c’est à ce moment que
Platon sent aussi l’exigence de limiter cette puissance créatrice. Dans le cadre d’une philosophie qui est attentive surtout aux
équilibres politiques, la poésie, en tant que furor, constitue un danger potentiel. Tout en reconnaissant une « sacralité » à la
poésie, les pages de la République et des Lois condamnent sans appel l’imagination poétique.
Bien qu’il se soit fondé sur les prémisses jetées par Platon, le discours brunien ne suit pas l’Athénien. Le Nolain ne bannit
pas le langage « enthousiaste » de la philosophie, au contraire, il l’intègre en elle. A la lumière de cette position, il est clair
que la poésie n’est pas le simple « vêtement » que peut assumer la philosophie. Mais la poésie devient elle-même
philosophie, étant donné que le philosophe peut atteindre le vrai seulement en passant par elle (car elle lui permet de
s’enivrer, et donc de se hisser vers la vérité). Bruno est tout à fait conscient de la fonction de « médiation » que la poésie joue
entre l’humain et le divin. En fait, la poésie est un « sacrifice », étymologiquement « faire les sacra », justement parce qu’elle
permet à l’humanité de s’élever au ciel et de communiquer avec le divin : « La louange est un des plus grands sacrifices que
puisse offrir une affection humaine à l’objet de son amour. Et pour laisser de côté ce qui touche au divin, dites-moi : qui
connaîtrait Achille, Ulysse et tant d’autres capitaines grecs et troyens, qui garderait le souvenir de tant de grands soldats,
sages et héros de ce monde, s’ils n’avaient pas été portés aux nues et déifiés par un sacrifice de louanges offert sur cet autel
qu’est le cœur enflammé des poètes et autres chantres illustres, sacrifice grâce auquel s’élèvent ensemble vers les cieux le
sacrificateur, la victime et l’homme divin canonisé par la main et le vœu d’un digne et légitime prêtre ? »19. Nous voudrions
préciser que ces références au ciel ne signifient ni une nouvelle manière d’exprimer la passivité de l’homme face aux dieux ni
la reprise de thèmes dualistes dans la pensée brunienne. Bruno suit Platon quand il considère la poésie comme le langage
facilitant le passage de l’humain au divin. Toutefois, il n’accepte point que le poète soit perçu comme un « vase », un
« instrument ». La poésie, même dans son caractère divin, est encore une conquête humaine. À travers la poésie, ce n’est pas
la divinité qui parle aux hommes, mais l’homme qui atteint le ciel. Comme Paolo Rossi l’a si bien dit, le héros brunien ne se
fait pas habiter par les dieux, mais il les rejoint20. Il ne faut pas non plus croire que la référence au ciel comporte une division
de l’univers entre un « en bas » et un « en haut » : la signification profonde de la Nolana filosofia se trouve dans l’affirmation
de l’homogénéité de l’univers et dans la destruction « vicissitudinale », « métamorphique » de tous les degrés hiérarchiques.
Cela sera amplement théorisé dans le De Immenso, mais les Fureurs héroïques aussi trouvent leur véritable portée dans la
forte affirmation du plan d’immanence. La Chanson des Illuminés qui clôt l’œuvre est une revendication de la grandeur de
l’Océan même par rapport au Ciel21.
La poésie sert surtout à offrir une « mesure » horizontale, c’est-à-dire à établir une relation entre l’homme et les dieux qui
n’est soumise à aucune transcendance. La divinité est en nous-mêmes et dans la Nature. La poésie n’est pas une manière pour
se délivrer des liens avec la Terre, elle est le chant même de la Nature. En somme, le modèle brunien est Lucrèce plus que
Platon. À ce propos, nous pourrions ajouter que la question de la poésie qui est plutôt « théorique » dans les Fureurs
héroïques, devient « réelle » dans les poèmes de Francfort – De triplici minimo et mensura ; De monade, numero et figura ;
De immenso et innumerabilis – où la philosophie brunienne « pratique » clairement la poésie en se rattachant justement à
Lucrèce. Pour ces poèmes, nous devons parler d’une véritable poésie-philosophique (ou d’une philosophie-poétique)22.
1
/
4
100%
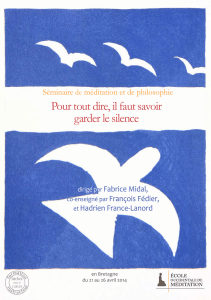
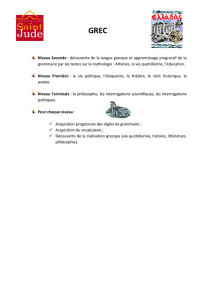

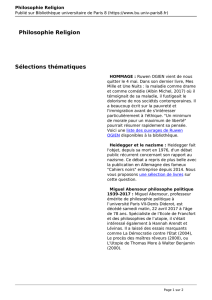


![PROPOSITIONS [Martin Heidegger] « La philosophie est une des](http://s1.studylibfr.com/store/data/003957154_1-7d167e4564521f5c2b9c483ce6d4f43c-300x300.png)




