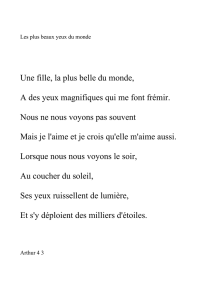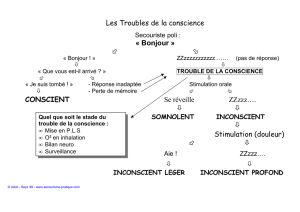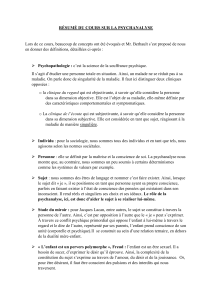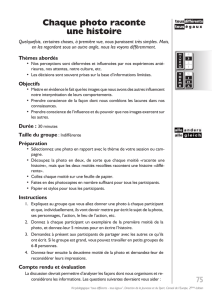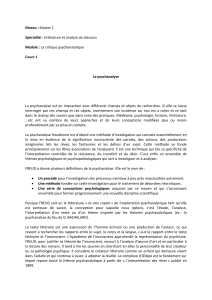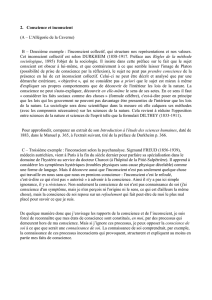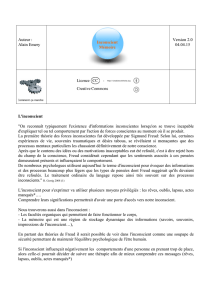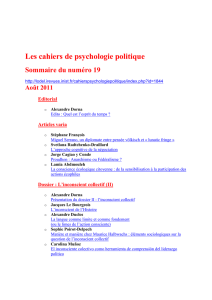Suis-je ce que j`ai conscience d`être

Quelques indications pour le traitement du sujet :
Suis-je ce que j’ai conscience d’être ?
Le sujet invite le candidat à interroger l’équivalence entre deux termes : [ce que je suis] = [ce
que j’ai conscience d’être]. Au premier abord cette équivalence semble aller de soi : comme
l’enseigne l’étymologie du mot conscience (cum-scientia) être conscient c’est accompagner
de savoir notre existence et tout ce que nous en faisons. Non seulement nous sommes
(presque) toujours sous notre propre regard mais ce regard plonge au-dedans de nous-
mêmes. Il semble donc que rien de nous ne puisse nous échapper. Nous n’avons avec
personne l’intimité que nous avons avec nous-mêmes. Qui plus est nous ne pouvons voir les
autres comme nous nous voyons c’est-à-dire plonger dans leur intériorité. Pourtant, à la
réflexion, chacun peut se rendre compte qu’il a l’occasion au cours de sa vie d’apprendre (de
lui-même ou par les autres) ce qu’il ignorait sur lui-même. Il faut donc bien interroger l’idée
d’une conscience qui embrasserait la totalité de notre être et nous le rendrait transparent.
Y a-t-il égalité entre ce que je suis et la conscience que j’en prends ?
Si oui : conscience = être. Donc tout ce que je suis : j’en ai conscience. C’est
l’hypothèse de la transparence à soi du sujet. Cette hypothèse est celle du sens
commun, mais elle trouve un appui théorique dans la philosophie de Descartes. Pour ce
penseur du XVIIe il existe deux réalités distinctes et indépendantes (= deux
substances) : l’étendue (ou réalité matérielle) et la pensée. De ce dualisme il résulte que la
pensée ne doit rien à l’étendue et que l’étendue ne doit rien à la pensée : il n’y a pas de pensée
dans la matière. Appliqué à l’homme cela signifie qu’il n’y pas de conscience des
phénomènes physiologiques : nous ne « voyons » pas fonctionner nos artères, notre cœur ou
notre foie. Il y a donc bien une sorte d’inconscient chez Descartes (même si le mot n’existe
pas dans son langage) mais il ne concerne que le corps, c’est-à-dire ce que nous ne sommes
pas puisque nous nous définissons comme « chose pensante ». Inversement il n’y a rien dans
la pensée qui ressemble aux rapports entre corps. Les corps sont extérieurs les uns aux autres :
ils peuvent s’interposer, se masquer les uns les autres, se rapprocher, s’éloigner, etc. Parler de
choses cachées en nous c’est appliquer indûment à la pensée le mode d’être des réalités
matérielles ; c’est faire des métaphores illégitimes. Si obscurité il y a en nous, elle ne peut
provenir que d’un défaut d’attention de notre part ; mais en droit il n’y a rien en nous qui ne
puisse parvenir au jour de la conscience.
Deux remarques pour montrer que l’adéquation de l’être et de la conscience n’est peut-être
pas si absolue qu’on pourrait le croire :
1. D’abord tout ce que nous faisons ne bénéficie pas du témoignage de la conscience : nous
accomplissons bien des choses sans nous en rendre compte (on peut penser, entre autre, aux
automatismes innés ou acquis).
2. Si réellement le sujet se possédait en toute clarté aucun progrès de la connaissance de soi
ne serait envisageable (cette connaissance étant par hypothèse déjà réalisée). Mais comment
expliquer alors qu’il nous arrive de prendre conscience de ce que nous sommes ?
Il faut donc envisager l’autre hypothèse : conscience ≠ être, inadéquation qu’on peut
entendre en diverse manières : soit la conscience est en deçà de l’être, l’être débordant
la conscience que nous en prenons (conscience < être). Soit la conscience est à côté de
l’être (j’ai conscience d’autre chose que ce que je suis ou je suis autre chose que ce dont
j’ai conscience). Quelle que soit la manière d’entendre cette hypothèse, elle soulève la
question : pourquoi y a-t-il en moi des choses dont je n’ai pas conscience (= des choses que je
ne sais pas être en moi) ? Plusieurs types de réponse :
1
2

— Il y a des raisons objectives. Ainsi l’inconscient freudien est objectivement séparé de
la conscience par la puissance du refoulement. Même si je voulais le connaître je ne
pourrais pas. Contre le refus cartésien de conférer à la pensée le mode d’être des
choses dans l’espace il faut bien admettre un sujet cloisonné, théâtre d’un conflit entre
forces antagonistes.
— Autre raison objective : nous sommes les seuls à nous voir comme nous nous voyons
mais ce point de vue n’est pas le seul point de vue. La conscience de soi est une
perspective sur soi parmi d’autres, avec ses inconvénients et ses limites. En
l’occurrence la conscience de soi est un point de vue purement intérieur. Autrement dit
ce n’est pas tout notre être que nous voyons par la conscience mais une partie
seulement. Nous avons souvent une idée très confuse des apparences que nous offrons,
de notre comportement, de notre corps.
— Il y a des raisons subjectives : il y a des choses que je pourrais voir en moi mais que je
ne veux pas voir. Cf. Aristote qui parle des passions et de l’indulgence : elles faussent
le jugement sur nous-mêmes et entraînent un regard sélectif : nous minimisons nos
défauts, nous exagérons nos qualités.
Le constat d’une conscience qui reste en deçà de l’être amène alors la question :
comment récupérer dans la connaissance cette partie de l’être qui nous échappe ?
Comment convertir la conscience de soi en connaissance de soi ? Comment égaler la
conscience que nous prenons à l’être que nous sommes ? Après tout la conscience est
sans doute moins une réalité toute faite qu’une conquête à réaliser. Si tel n’était pas le cas
pourquoi dirions-nous que nous prenons conscience ? Chaque prise de conscience n’est-elle
pas comme un degré dans le progrès général de la conscience de soi ? Mais comment prendre
conscience de ce que nous ignorions être nous (ou en nous) ? Plusieurs réponses
complémentaires :
— On peut commencer par souligner le rôle d’autrui. Par son extériorité il est en position
de me révéler des aspects de moi-même que j’ignorais. Lui et moi ne voyons
évidemment pas la même chose de moi. Son point de vue complète le mien et enrichit
la conscience que j’ai de moi-même. Combien de fois avons-nous été éclairés sur
nous-même par une remarque, une boutade, un reproche ?
— On trouve chez Hegel l’idée que la conscience n’est pas donnée au départ mais se
construit dans une histoire qui est celle du débat du sujet avec le monde. Chaque
nouvelle expérience est pour la conscience l’occasion d’une prise de conscience qui
l’amène à un degré de clarté plus fort, plus aigu. « Il faut, pour se connaître, se mettre
à l’épreuve : on n’apprend l’étendue de ses forces que grâce à l’expérience » disait
déjà Sénèque dans De la providence.
— En ce qui concerne la critique freudienne des positions cartésiennes : la séparation du
sujet en conscient et inconscient serait indépassable si l’inconscient ne trouvait
finalement le moyen de s’exprimer (= retour du refoulé). Mais en raison de la censure
ces expressions sont cryptées et se refusent à toute lecture claire de la part de la
conscience. Cependant ces expressions constituent tout de même des signes qui
appellent une interprétation. Ce rôle d’interprétation est celui de la psychanalyse.
Bien entendu tout le monde ne subit pas une cure psychanalytique mais la
psychanalyse enseigne au moins à la philosophie qu’il n’y a pas de connaissance de
soi immédiate. Nous ne sommes pas d’emblée donnés à nous-mêmes.
3
1
/
2
100%