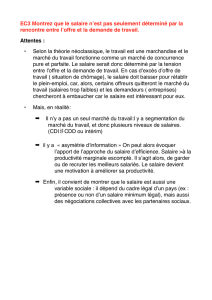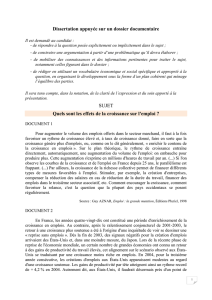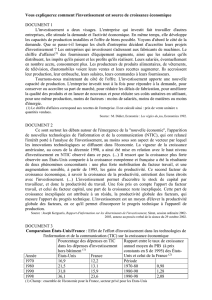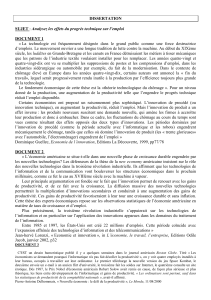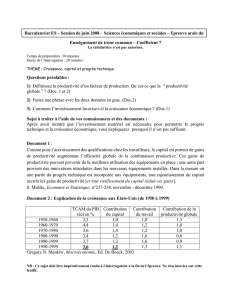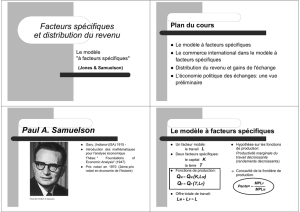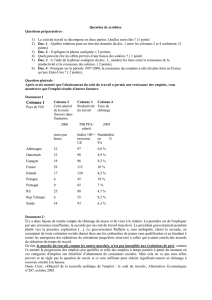politiques economiques: une perspective europeenne

POLITIQUES ECONOMIQUES: UNE
PERSPECTIVE EUROPEENNE
SEMESTRE 4 IEP TOULOUSE
Gabriel COLLETIS
Les économistes définissent un « carré magique » : la croissance économique, les
prix, l’emploi et le commerce extérieur ; qu’on appelle aussi « la croissance et les grands
équilibres ». Le terme de croissance caractérise la période des années 50-60, « les Trente
glorieuse », en fait 20 années dans le meilleur des cas. Certains économistes préfèrent parler
de développement. La croissance est donc forte durant ces années. La notion de
développement est beaucoup plus qualitative : elle ne se mesure pas uniquement par le PIB,
qui ne fait pas allusion aux nombreuses disparités. La période de crise caractérise les années
70-80 : on a un image de la crise orientée vers le passé, vue comme mode de régulation. On
parle ici du mode de régulation keynesiano-fordiste, qui rentre en crise dans ces années. A
partir des années 90, les économistes ne parlent plus de crise, mais parlent d’une mutation de
l’économie. On se demande quel est le nouveau mode de régulation. On a pensé jusqu’en
2001 à une « nouvelle économie », une « société de la connaissance », « capitalisme
cognitif ». On a donc trois périodes.
I La période de croissance : 1950-1960
Cette croissance économique est très importante, du milieu des années 50 jusqu’en
1973. Elle est assez inégale parmi les pays développés, et la France fait très bonne figure avec
le Japon. Si la France est encore un pays développé, elle le doit à cette période. La croissance
annuelle du PIB est alors de 5%, ce qui est énorme. On a donc en l’espace d’une génération
un PIB qui va être multiplié par plus de 2. Même s’il y a des disparités, le niveau de vie est
multiplié par plus de 2. C’est un véritable miracle économique.
Dans les autres pays développés, ce rythme est beaucoup plus faible, notamment aux
Etats-Unis ou au Royaume-Uni où en enregistre environ 2% de croissance (rythme actuel de
la France).
Quel est le moteur de cette croissance ? Il y a deux façons de l’aborder. La croissance
peut être le résultat d’une accumulation extensive, ou d’une accumulation intensive. La
première se caractérise par une augmentation de la population active, la seconde joue elle sur
les rendements (mesure physique) et la productivité (mesure monétaire). Ce prisme permet de
présenter une croissance intensive sur cette période, avec des gains de productivité d’environ
5% par an. Ils sont générés en France par les méthodes tayloriennes de travail (travail à la
chaîne, rationalisation du travail). Ce moteur est très fortement redistributif, sous la forme
d’augmentations de salaires : on ici le cœur du fordisme et du keynésianisme. Le fordisme :
l’entreprise mise sur le travail à la chaîne, avec des économies d’échelle importantes, et la
distribution de salaires élevés pour tenir les gens au travail, instrument qui va aussi assuré des
débouchées à l’entreprise (20% de sa production pour Ford, ce qui est encore le cas pour les
grandes entreprises françaises) ; c’est un système qui se diffuse, et les entreprises constituent
les débouchées des une des autres. C’est un principe de création et de diffusion des gains de

productivité, cercle vertueux. Le keynésianisme : Keynes est le dernier très grand économiste
(La Théorie générale, 1936), ce n’est pas un économiste de la demande, mais un économiste
du circuit économique ; il est influencé par le Français Quesnay (médecin physiocrate) qui
décrit « le circuit économique d’ensemble », repris par Keynes, avec l’importance du
« bouclage du circuit macro-économique » ; il faut qu’il y ait un équilibre économique entre
profits et salaires, une économie qui n’investit pas ne peut pas croître, de même que des
salaires élevés sont la condition des débouchées ; la valeur ajoutée est donc répartie entre
profit et salaire, cette répartition devant être adéquate. Si les entreprises hésitent à investir,
c’est très souvent qu’il y a un problème de profit : il faut donc déplacer cette répartition vers
le profit. De même si on constate une insuffisance de la demande, on déplace la répartition
vers les salaires, à travers les prélèvements sociaux. Selon que ces prélèvements chargent plus
les entreprises ou les salariés, les pouvoirs publics peuvent déplacer la répartition de la valeur
ajoutée. Le keynésianisme, c’est cette question de partage de la valeur ajoutée. Les keynésiens
ne sont plus aujourd’hui dominants. Ils étaient à l’époque convaincus d’avoir trouvé la
solution à toute crise économique. Se mettent en place des outils de pilotage économique
(notamment la comptabilité nationale), qui constituent un tableau de bord de l’économie,
permettant de connaître la politique à adopter. On ne comprend donc pas l’arrivée de la crise.
L’élément clé de cette répartition est l’indexation des salaires (indexation de droit) sur
les prix et sur les gains de productivité (indexation de fait) : le SMIG, puis le SMIC (1969).
Le gouvernement est tenu de prendre en compte l’évolution des prix, et donc d’augmenter les
salaires en fonction, d’où les multiples débats sur l’évaluation des prix (INSEE/syndicats),
avec des différences entre les paniers de consommation, la CGT ne prenant pas en compte
l’effet qualité. L’indexation sur les gains de productivité se fondent sur des accords de
branches, car ces gains ne sont pas les mêmes d’une branche à l’autre. On a donc une
indexation de droit sur les prix, et une indexation de fait sur les gains de productivité. D’où
une sorte de compromis institutionnel fondamental qui a tenu jusqu’en 1983, du fait de cette
indexation.
Cette croissance a été dès les années 60 contestée par un club d’économistes, le Club
de Rome, constitué après le traité de 1957, lorsque les dirigeants confie une réflexion sur la
croissance à un club d’économistes. Une étude est confiée au MIT, le professeur Meadaw,
aboutit à un constat : la croissance produit des déséquilibres importants qui risque d’être
préjudiciables à terme. La croissance démographique est beaucoup plus forte que la
croissance de la production alimentaire, et surtout est mal répartie, d’où des problèmes de
nutrition croissants dans le monde. Cette conclusion est critiquée, qualifiée de malthusienne.
Autre prévision, l’épuisement des matières premières et énergétiques : on a tenté un inventaire
des ressources mondiales. La principale critique consiste à dire qu’ils ne tiennent pas compte
du progrès technique. Troisième résultat, c’est une pollution croissante, la mauvaise
utilisation des ressources, qui à l’époque a été mesurée : tous les secteurs polluent. D’où un
ouvrage : La Croissance zéro, la croissance doit être maîtrisée, on doit faire attention à la
pollution, aux dépenses d’énergie, … Dans les années 60, on a pas beaucoup tenu compte :
ces travaux ont été ressortis après 1974 lorsque la croissance recule, avec des économistes et
des hommes politiques qui se sont réjouis de la crise se rapportant aux rapports du club de
Rome. C’est en réalité un constat d’impuissance, en faisant référence au Club de Rome. Ce
qui revient aujourd’hui une vision, dans une période de croissance très forte, sur les
problèmes de déséquilibres liés à cette croissance.
On ne doit plus confondre augmentation des prix et inflation. Le terme « inflation »
signifie un gonflement de la masse monétaire, que les économistes mesure par les agrégats
monétaire : M1, liquidités ; M2 et M3 en ajoutant de la quasi-monnaie. La nature de la liaison
avec la hausse des prix a été mis en évidence par Fischer, qui fonde la théorie quantitative de

la monnaie, repris par les monétaristes (Hayek) : M x V= P x T. M masse monétaire, V
vitesse de circulation de la monnaie, P prix moyen d’une transaction, T nombre de
transactions. On peut dire qu’à court terme, V et T sont des constantes, ce qui signifie que P
est une fonction de M, c’est-à-dire que le prix moyen d’une transaction dépend de la quantité
de monnaie en circulation. Pour agir sur P, il nécessaire d’agir sur M.
C'est bien en 1962 que le premier plan de « refroidissement » de la hausse des prix est
adopté dont son inspirateur est VGE. Ce plan va s'avérer très orthodoxe: il y a trop de
monnaie, ce qui fait augmenter les prix. Très logiquement, une politique monnétaire
restrictive va être appliquée: elle ne va pas utilisé l'arme des taux d'intérêt, mais le taux de
réserve obligatoire (TRO) relevé par la Banque de France. En France, historiquement, il y a
avait une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaire. Les banques de dépôt
collectent l'épargne des particuliers entre 0 et 2ans, qu'elles transforment en prêt, prêtant
principalement aux ménages, mais surtout aux entreprises, opération de transformation de
dépôt en prêt. Les taux d'intérêts diffèrent selon la durée de l'épargne ou du prêt. La Banque
de France impose aux banques de dépôt de consigner une partie des dépôts collectés: les
banques doivent elles-même mettre à disposition ces dépôt à la caisse des dépôts et des
consignations, qu'elle ne rémunère pas. Si la banque de France impose une élévation de ce
TRO, les prêts vont diminuer, et vont être accordés à des taux plus élevés. La caisse des
dépôts bénéficient de sommes, et elles peut effectuer des prêts à des taux très bas, et va donc
financer le logement social, les collectivités locales et les autoroutes.
Ce plan ne va pas fonctionner, et avec le recul, on peut dire qu'à l'époque la hausse des
prix n'était pas liée à un excès de monnaie. La hausse des prix était fondée sur la course entre
les salaires et les prix, avec un climat globalement revendicatif, les salariés tentant d'obtenir
des hausses de salaires importantes (SMIC), ce qui induit une hausse des prix, ce qui
provoque de suite une nouvelle revendication, ... Le problème était en réalité celui du partage
de la valeur ajoutée.
C'est une période de plein emploi, lorsque le taux de chômage ne dépasse pas 3% de la
population active (chômage frictionnel), avec environ 300 000 chômeurs par an. L'économie
française ne crée pas beaucoup d'emploi, car l'accumulation est une accumulation intensive,
fondée sur les gains de productivité. La population française ne croît par de façon importante,
sinon avec l'immigration. On a un déput de féminisation de l'emploi, et le phénomène d'exode
rural. Le principal élément marquant du marché de l'emploi est alors ce que Alfred Sauvy
appelle le « déversement sectoriel »: la population change de secteur d'activité. La part de
l'agriculture diminue de façon importante, et passe à l'industrie. Les gains de productivité dans
l'agriculture sont les plus importants, et induisent le remplacement de la main d'oeuvre par les
machines et les produits chimiques. On a du côté politique des volontés de fixer la population
rurale, avec notamment l'ouverture d'une usine Citroën en Bretagne. La part de l'agriculture
dans le PIB diminue (2% aujourd'hui): le prix des produits agricoles chutent
considérablement, et la part d'un secteur dans le PIB dépend plus de la valeur que de la
production produite. La PAC nait sur cette base là, afin de maintenir le revenu des
agriculteurs.
L'économie française est une économie peu ouverte, auto-centrée: le taux d'ouverture
de l'économie est de l'ordre de 5%. Le taux d'ouverture est mesuré soit à la sortie soit à
l'entrée: à la sortie, c'est le taux d'exportation par rapport à la production (X/P); à l'entrée, le
taux d'importation par rapport à la consommation (M/C, C=P+M-X). Le commerce extérieur
français est donc assez peu développé, et géographiquement très ciblé, avec de forts échanges
avec les colonies. La signature du traité de Romeva faire évoluer cette spécialisation
géographique, avec un abaissement des barrières tarifaires, processus qui va durer longtemps,

abaissement total en 1968. Ce ne sont qu'une partie des barrières qui sont abaissées, mais pas
les barrières non-tarifaires (normes). C'est l'Acte unique (1986) qui supprime les barrières
non-tarrifaires, processus lui aussi long (30ans). Le traité de Rome va accroître la part de
l'échange de la France avec les pays de la CEE, et dans la même période, les pays colonisés
vont s'émanciper, et donc le commerce va se redéployer sur l'Europe. Le taux d'ouverture va
en même temps progresser, et atteint 15% à la fin des années 60. Le problème, c'est que le
commerce avec les pays africains était plus facile: on vendait des biens chers contre des biens
basiques, les termes de l'échange étaient donc très favorables. Mais avec les pays du marché
commun, les termes de l'échange sont différents: dans les années 60, on va remarquer un
déficit franco-allemand, c'est-à-dire que les importations d'Allemagne vont valoir plus cher
que les exportations françaises. Ce redéploiement ne se fait pas dans de bonnes conditions: la
France est un « pays intermédiaire », forte avec les pays faibles, mais faible avec les pays
forts (R.Barres). On essaye d'équilibrer sont déséquilibre avec les pays riches en commerçant
avec les pays pauvres. On y arrive assez mal, et le déficit de la balance commerciale est
important à la fin des années 60. On commence à avoir dans la littérature économique
l'expression « contrainte extérieure ».
On a donc deux indicateurs plutôt bien orientés, croissance et emploi, le lien entre les
deux étant très forts; mais il y a un déséquilibre au niveau des prix, et un déséquilibre au
niveau du commerce extérieur. Le tableau est donc nuancé, et il est donc défficile de parler de
« Trentes glorieuses ». Mais ce qui domine, c'est cette vision du plein emploi et de la
croissance. Les ménages ne s'intéressent pas au déficit extérieur, et son pouvoir d'achat n'est
pas vraiment diminué par la hausse des prix. Les problèmes sont des déséquilibres
macroéconomiques, qui n'ont pas d'incidence directe sur la population. Ils auront plus tard des
conséquences.
II La période de crise: 1970-1980
Le principal indicateur de la crise est l'effondrement du rythme de croissance du PIB
en 1973, avoisinant les 0. La France n'a jamais connu de recul de son PIB. Il y a eu des
récessions (recul sur deux trimestres consécutifs du taux de croissance du PIB), mais jamais
de dépression. C'est une décellération du rythme de croissance. En 1973, le recul est très fort,
on passe d'environ +5% à 0. Cette chute coïncide avec le choc pétrolier: il se passe une erreur
d'analyse économique très grave, qui confond la coïncidence et la cause. On pense que c'est le
choc pétrolier qui est à l'origine de la crise. Ce choc a bien sûr des incidences sur l'économie
française, mais ce n'en est pas la cause.
Les prix vont inévitablement augmenter: augmentation du rythme de hausse des prix.
Le commerce extérieur est déséquilibré. Les deux problèmes des années 50-60 sont aggravés
par le choc pétrolier.
En 1973, le prix du pétrole augmente, de même qu'en 1978, mais le prix du pétrole
doit ressitué par rapport aux termes de l'échange: les pays producteurs de pétrole achètent des
biens de consommation. Jusqu'en 1973, ces termes de l'échanges pour les pays producteurs de
pétrole se dégradent. En 1973, le choc ré-équilibre les termes de l'échange, et 1978, on
retrouve les termes de l'échange de 1957: après le second choc, ils présentent une facture
équitable.
Cet effondrement trouve en fait son origine en 1967, alors que le rythme de croissance
de la productivité chute. On ne s'en apperçoit pas de suite du fait de la force d'inertie de
l'économie française. Cet effondrement des gains de productivité, qui va se poursuivre, a deux
explications: le ralentissement du rythme des investissements; la diminution de création de la

valeur ajoutée. Les sociologues vont parler d'une crise du travail, crise du taylorisme: il a
permis des gains de productivité très forts, mais les salariés ont troqué ce pouvoir d'achat
contre une certaine aliénation. Quand le niveau d'éducation s'élève, quand la consommation
change (taux d'équipement), quand la diffrenciation devient importante, le système taylorien
ne marche plus, ce qui se caractérise par un taux d'absentéisme important (30% dans
l'industrie automobile), et un certain nombre de défauts. C'est ce que les sociologues appellent
les « coûts cachés », qui explosent.
En 1981, la gauche arrive au pouvoir et tente une relance qualifiée de relance
keynesienne, supposée ressembler à la relance allemande. On souhaite relancer l'emploi par
la relance de l'activité économique. La demande va donc être relancée, en appuyant sur des
composantes de la demande.
La demande des ménages va être augmenté par la hausse du salaire minimum, ainsi
que la hausse des prestations sociales. L'Etat va augmenter ses dépenses de 27%, soutient les
entreprises par la multiplication des subvention et des investissements publics. La demande va
progresser et profiter de façon dominante aux exportations. Les Français achètent des biens
qui ne sont pas fabriqués en France (magnétoscopes), de même que les entreprises. En 1981,
le déficit de la balance commerciale passe de 40 à 100 milliards de francs, ce qui va
déboucher sur des mesures de freinage sur la demande qui commence en 1982. Est décidé une
politique de rigueur avec un blocage des prix et des salaires.
L'agravation du déficit de la balance commerciale était prévisible. Le point de départ
était un déficit de 40 milliards de franc: ce lancer dans une politique de relance dans ces
conditions est dangereux. La demande des ménages et des entreprises a été relancée, mais on
n'a pas relancé la demande extérieure. On peut le faire par la dévaluation. Mais on ne pouvait
pas sortir du serpent monnétaire européen. A partir de 1979, si la monnaie est attaquée, la
Banque de France peut s'appuyer sur les réservent de la FECOM. Sortir du serpent induisait se
priver ce cette protection. Ce risque, le gouvernement de l'époque n'a pas voulu le prendre,
mais rien n'a alors pu compensé l'augmentation des importation. La relance est donc bancale.
Cette relance n'est pas une relance keynesienne: ce n'est pas un économiste de la
demande. Or le partage salaire/profit en 1982 est largement en faveur des salaires. Il n'y a pas
assez de profit. Le chômage s'est considérablement accru depuis 1975, et ce sont les
entreprises qui payent cette charge, les cotisation salariales augmentant peu. On pensait que
c'étaient les entreprises qui crééent le chômage et que c'était à elle de payer cette
augmentation de chômage. A partir de 1981, la profitabilité des entreprises est insuffisante. Il
aurait fallu en réalité qu'elle rééquilibre le partage en faveur des profits, une vrai relance
keynesienne.
On entre dans une phase plus keynesienne en mars 1983, car différentes mesures sont
prises, dont celle consistant à désindexer les salaires des prix et des gains de productivité. Ces
gains sont donc répartis à partir de 1983 en faveur des profits. Le niveau de financement des
entreprises va être relancé: elles vont d'abord se désendetter, et recommencer à investir à
partir de 1988-1989.
Il y a deux période: jusqu'en 1983, et après. Avant, c'est la course poursuite entre
salaires et profits qui génère une hausse des prix importante, qui atteint son maximum en
1980 avec 14% de hausse des prix. En même temps, le franc entre dans le SME. Il y a donc
incompatibilité entre la volonté d'arrimer le franc à un système de change stable, et une hausse
des prix bien plus forte que celle des autres pays du SME. La résolution de cette
incompatibilité passe par la rupture de 1983, qui désindexe la hausse des salaires des prix. La
hausse des prix était véritablement due à cette indexation. La France devient ainsi un modèle
en matière de modération dans les prix. Certains économistes ont pu écrire que la France
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%