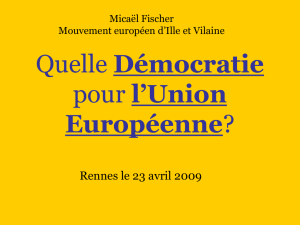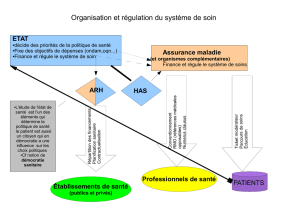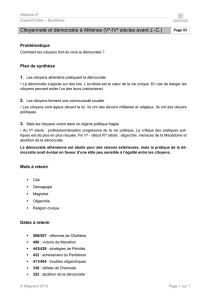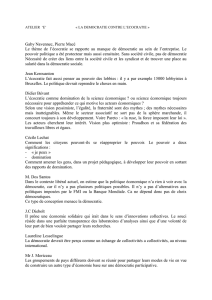Compte-rendu

IEP Paris, samedi 22 janvier 2005
FAIRE DES EUROPÉENS
L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EUROPE EN
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE
Introduction
R. Descoings, directeur de l’IEP de Paris
L’école : un creuset. Elle l’a été pour la nation, mais attention à l’usage actuel de l’intégration,
terme qui peut paraître vexatoire pour des jeunes Français de droit.
L’école : un creuset pour l’Europe des citoyens, pour combler le déficit démocratique de la
construction européenne ; pour mieux connaître nos voisins en revisitant les enseignements de
l’histoire et en puisant dans l’histoire longue, en particulier à propos des frontières de
l’Europe, en se gardant du spontanéisme de l’opinion ; dans cet esprit il faut essayer de
comprendre la liesse des pays entrants le 1er mai 2004 et d’expliquer le traité constitutionnel,
texte de compromis.
M. Hagnerelle, doyen du groupe histoire et géographie de l’IGEN
L’IG entend prendre appui sur les programmes en cours de rénovation, sur les réflexions sur
l’Europe (1999-2000), les séminaires inter-académiques sur les nouveaux territoires, la
collaboration avec le Centre d’histoire de Sc.Po Paris.
Faire des Européens relève fondamentalement de nos responsabilités d‘historiens -
géographes, invite à considérer la place accordée à l’Europe dans nos disciplines, ce qui
revient à chacune spécifiquement (H, G, EC-ECJS).
Eveiller une conscience citoyenne européenne, donner un sens à l’Europe, autant d’objets de
débats.
Les deux journées proposent un état des lieux prospectifs.

Jean-Pierre Wytteman, IA-IPR, dresse un tableau très fouillé des programmes d'histoire
dans l'Europe des 25 : il se dégage des contenus très divers, en raison du statut de la
discipline (obligatoire dans la plupart des cas, optionnelle au Royaume-Uni, évaluée à
l'examen ou non) et d'une résistance inégale de l'histoire nationale (ou de son exhumation
récente dans les pays de l'Est). L'histoire de l'Europe est plus présente qu'en France en Italie,
en Autriche, au Luxembourg, au Portugal et dans des Länder allemands.
Jean-Claude Boyer, directeur de l’Institut d’études européennes de Paris VII, en s'appuyant
sur une analyse des manuels par l'APHG avec l'Institut Georg-Eckert, compare
l'enseignement de la géographie de l'Europe en France et en Allemagne et présente des
suggestions.
En Allemagne, les programmes sont fixés par les Länder, qui ont refusé la recentralisation en
déc. 2004. Il y a 15 manuels, avec des modules communs conçus par les éditeurs, qui ne sont
que 4 ou 5. Les IO sont moins contraignantes, les changements de programmes non
simultanés. Les manuels sont peu volumineux et peu mis à jour.
L'Europe est étudiée à divers niveaux. La France est abordée partout, sauf dans 3 Länder, une
fois au début du collège et deux fois en classe terminale.
En abordant l'Europe plus tôt qu'en France, l'étude est plus simple.
L'étude de cas régionale paraît pertinente : à partir d'un jumelage, d'une comparaison (ex.
Ruhr-Lorraine), d'une eurorégion. Suggestion : éditer une brochure pour la région.
Il faudrait éviter les documents journalistiques, les livres d'images sans problématique
d'ensemble.
Quelles limites au continent ? Chypre est intégrée, mais les IEM la classe en Asie. Pour F. et
All., l'Oural est la frontière orientale admise depuis le XVIIIe siècle. Au sud-est, l'Europe
s'arrête au Caucase pour les F., à la dépression ponto-caspienne pour les Allemands. Les
Tchétchènes sont en Europe pour la F., en Asie pour les All..
L'Europe comme construction politique :
Les auteurs de manuels s'en tiennent aux données « sûres » : frontières étatiques, institutions,
politiques et programmes communautaires. Les structures économiques et sociales sont
négligées. On parle plus d'Airbus ou d'Ariane que des FMN, des banques et des bourses. Les
sources officielles sont reprises sans recul critique.
Les auteurs de manuels s'interrogent peu sur l'identité européenne, les critères
d'appartenance. Le gradient d'européanité de Jacques Lévy est rarement repris. Les images de
l'Europe relève du collage.
Les Français parlent de construction européenne à partir de « briques » nationales. L'Europe
se construit comme l'Etat. Pour les Allemands, l'Europe préexiste : ils parlent d'unification et
d'intégration. Mais les différences de points de vue s'estompent : l'Europe est conçue comme
un espace de civilisation sans frontières bien marquées.

Une subjectivité nationale consciente ou non : l'Europe est plus un contexte qu'un objet
d'étude. La formule « la France dans l'UE » est ambiguë. Le centrage national est plus marqué
aujourd'hui en Allemagne, avec le sentiment d'occuper une position centrale en Europe :
marché de consommation, de matières premières, de main-d'oeuvre, espace touristique... La
géographie all. distingue espaces passifs et espaces actifs (avatar de la « banane bleue »).
L'immigration est plus abondamment traitée en All. qu'en F..
Les anciens pays communistes sont plus loin des Français (« nouvelle périphérie ») que des
Allemands (« notre voisine, la Pologne »).
Les manuels allemands offrent une représentation traditionnelle des pays étrangers, à travers
le prisme des loisirs et du folklore : agro-alimentaire et gastronomie françaises, « pays du
Club Med »... Les Allemands sont fascinés par le vide français, le centralisme (par référence
au modèle implicite). Les Français ont abandonné les clichés sur l'Allemagne. La fascination
inquiète des années 1980 (« un géant au cœur de l’Europe ») fait place à une perception
nuancée : « la puissance ébranlée ».
L’enseignement tend à délaisser l’Europe-continent pour l’Europe – construction politique ;
est insuffisant sur les limites et le contenu de l’Europe ; conserve une vision centrée sur l’Etat,
tout en introduisant des points de vue régionaux.
Il est difficile d’élaborer un manuel franco-allemand.
Table ronde animée par Bertrand Badie, professeur à l’IEP de Paris : à Sc. Po, le savoir des
étudiants français est bien supérieur à celui des étudiants étrangers et surtout américains.
Mais…
L’histoire comparée des nations est insuffisamment enseignée (ignorance de la Grande
Charte, des révolutions anglaises, des enclosures…), avec l’histoire des interactions, des
conflits, des diplomaties antagonistes, des asymétries temporelles (ex. cité, fait impérial,…).
Le programme de 4e est catastrophique et celui de géographie de 1ère S est déprimant.
La notion de territoire doit être critiquée : ce n’est pas l’instrument monopolistique du
pouvoir. Il faut réfléchir à la déterritorialisation, à la régionalisation ou de réseau informel.
Des frontières disciplinaires à lever : on ne peut raisonner sur la mondialisation sans
l’économie (même si les économistes ne sont pas commodes…) et le droit.
L’H. et la G. de l’Europe doivent être replacées dans le monde : l’Europe n’est plus au centre
des relations internationales ; elle est « à côté du cratère »…
L’intelligence des périphéries de l’Europe est insuffisante :
L’histoire de la Russie,qui pose un gros défi (pourquoi s’est fermée à l’Europe ?) est
désertée par les manuels.
Les collégiens n’entendent jamais parler de la Chine, de l’Inde ou de Meiji. [Il est vrai
que l’historiographie française est pauvre à ce propos.]

Les étudiants ont besoin de repères chronologiques (mesure du temps, contemporanéités…) et
cartographiques.
Table ronde :
Laurent Wirth, IGEN, constate, d’une part, la crise de la fusion des sciences sociales et
revient sur le saucissonnage du programme Braudel puis du programme Haby ; évoque,
d’autre part, la crainte d’une dérive européocentriste (le professeur petit télégraphiste de
Maastricht) et l’influence du schéma lavissien sur notre conception de la construction
européenne.
Marc Vigié, IA-IPR : l’Europe ne s’est pas souciée de l’éducation, avant deux articulets du
traité de Maastricht, contre 30 pour la forêt. L’idéologie n’est jamais absente de l’histoire
enseignée en France (de « faire des Républicains » à « faire des Européens ». Une histoire
intégrée de l’Europe est impossible : un « Tour d’Europe par deux enfants » risque la dérive
téléologique.
L’histoire rectrice de la mémoire européenne ? le projet européen n’est pas le passé cautionné,
mais un sentiment de partage à forger. On emboîte dans une nouvelle échelle.
Jacqueline Jalta, IA-IPR : l’enseignement de la géographie est aujourd’hui problématisée.
Elle dégage des lignes de force, des acteurs, la diversité des territoires, des dynamiques et des
logiques spatiales, une vision éclairée et critique de l’objet et non une accumulation de
données.
L’UE en terminale est traitée en relation avec d’autres aires de puissance. En 1ère, l’Europe est
définie par l’unité dans la diversité, une mosaïque héritée et un objet de débat, l’UE.
Le territoire est au centre des programmes de lycée, dans une démarche multiscalaire ;
l’espace régionale est réévalué à l’aune des nouveaux territoires, des euro-régions.
Hubert Néant, IA-IPR, est confiant, quant à l’histoire comparée, dans la capacité des
professeurs à innover, à tisser des liens, sur les Balkans par exemple. Il y a des reculs, ainsi
sur l’Angleterre (système parlementaire, révolution industrielle) mais les problématiques sont
renouvelées sur la PGM, la crise des années trente...
Amal Azzouz, U de Nantes (?) : l’identité européenne est le résultat d’une culture commune,
fondée sur l’héritage judéo-chrétien, des convergences apparues au XIXe siècle
(industrialisation, urbanisation, éducation) et des valeurs communes (démocratie, égalité,
tolérance). La construction européenne répond à une demande sociale. L’Europe est une
réalité vécue pour des enfants qui n’auront pas connu le franc.
Marc Vigié considère que, sur l’Europe, on ne peut pas tout dire, que des choix s’imposent,
contestables mais logiques et que des repères sont nécessaires au collège (dates et documents
patrimoniaux non exclusivement français, cartes). Les fondements de la civilisation
européenne sont présentés en 2e avec une nouvelle conception de la causalité.
L’Europe échappe au déterminisme disciplinaire. Là, se situe l’atout pédagogique des sections
européennes (DNL, autre manière de pensée, échanges).

M. Hagnerelle admet que nos paradigmes scientifiques et politiques sont faibles et qu’il n’est
pas question de manuel unique ; sur les projets de binômes d’éditeurs il n’y a pas de
précipitation.
Nous avons à enseigner une Europe qui se fait, en faisant des choix, dans une approche
globale, croisant l’H, la G et l’EC.L’ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES ET LA QUESTION DE LA CONSTITUTION
Jean-Louis Quermonne, professeur émérite des universités
Le traité du 29 octobre 2004 n’est ni un commencement ni un aboutissement, mais une étape
stratégique dans un processus inscrit dans le temps long.
5 thèses
1. Le mythe fondateur du plan Schuman (9 mai 1950)
Trois organisations intergouvernementales existaient déjà : OECE, UO et Conseil de
l’Europe.
Le plan Schuman introduit un changement de perspective avec
1° la reconnaissance de l’égalité des Etats, vainqueurs et vaincus, ce qui lui vaut l’adhésion
enthousiaste d’Adenauer ;
2° une initiative concrète, sans fédéralisme à tous vents : l’unification des marchés du charbon
et de l’acier qui alimentaient les industries d’armement, scelle l’irréversible réconciliation
franco-allemande ;
3° des institutions supranationale : Haute Autorité, Cour de justice, Assemblée consultative.
Ainsi est créée la matrice de la construction européenne, l’œuvre du fonctionnalisme, à
l’encontre du réalisme traditionnel des relations interétatiques.
Le processus engagé est fondé sur l’expertise plutôt que sur l’adhésion démocratique, porté
par le dynamisme d’un groupe de pression, à défaut de parti européen.
2. L’Europe communautaire, une entité singulière.
Cet « objet politique non identifié » (J. Delors) n’a pas de précédent théorique ou historique.
Le processus de décision, la « méthode communautaire », est en contradiction avec les
principes des chancelleries (le Quai d’Orsay a été tenu à l’écart au début et, selon M. Barnier,
a besoin de s’européaniser).
La méthode communautaire associe supranationalité et intergouvernementalité : le monopole
du pouvoir de proposition appartient à la Commission ; la délibération au sein du conseil ds
ministres doit déboucher sur un compromis, après consultation de l’Assemblée (dont le rôle
s’est renforcé avec la co-décision).
L’Europe s’est construite avec des tâtonnements par le dialogue entre organisations
communautaires et Etats.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%