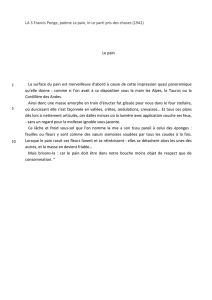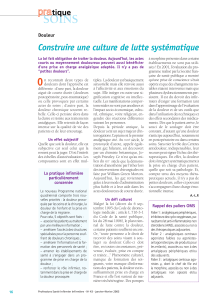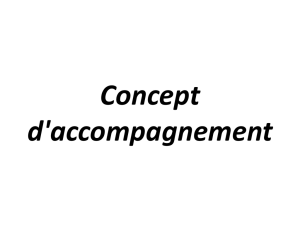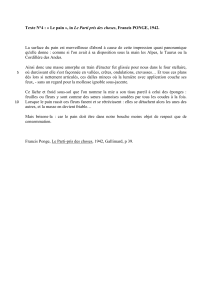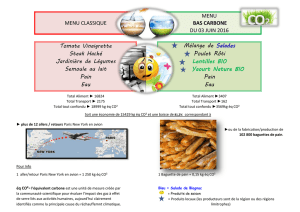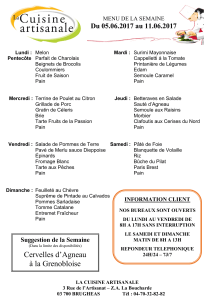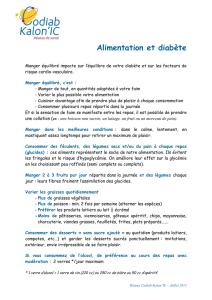Prise en charge médicamenteuse de la douleur cancéreuse en

ÉTUDE ORIGINALE
Médecine palliative
126
N° 3 – Juin 2004
Med Pal 2004; 3: 126-133
© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés
Prise en charge médicamenteuse de la douleur cancéreuse
en médecine générale
Anne Abel (photo), Inserm U444, Faculté de médecine St-Antoine, Paris.
Jean-Michel Lassaunière, Centre de Soins Palliatifs et traitement de la douleur, Hôpital de l’Hôtel-Dieu, Paris.
Antoine Flahault, Inserm U444, Faculté de médecine St-Antoine, Paris.
Summary
Drug management of cancer pain in general medicine
Objectives
: to describe the drug management of cancer pain in
outpatients.
Methods:
a prospective survey by mail among general practi-
tioners usually participating in the French Communicable Dis-
eases network denoted as “Réseau Sentinelles”. Enrolment of the
first patient consulting for cancer pain. Pain assessment by VAS
(Visual Analogic Scale). Collection of treatment data before and
after the visit.
Results:
Out of the 1 113 contacted physicians, 398 responses
(35.7%) including 248 valid questionnaires, and 150 invalid re-
sponses mainly due to the absence of eligible patients. Sex ratio
of 1.85 likely to be due to an excess of smoking related cancers.
Before the visit, 7% of the 248 patients had no antalgic treat-
ment, and 45% already had strong opioids. While 96 patients
had medium or strong pain (VAS>4cm) at the visit time, 20%
(19/96) didn’t get any treatment reinforcement. Among 135 pa-
tients who have been prescribed strong opioids after the visit,
only 46% got rescue doses.
Discussion:
We report the first national French survey since
1995 aimed at describing the modes of treatment for cancer
pain in outpatients. Indirect comparisons with previous studies
suggest that handling of pain has been improved. Nevertheless,
a substantial proportion of patients can still be considered as
not properly relieved. Moreover, rescue doses are too rarely pre-
scribed.
Conclusion:
Although the training efforts of the French general
practitioners in cancer pain management have been fruitful,
they are still not sufficient and must be pursued.
Key-words:
pain, cancer, general practice, morphine, rescue
doses.
Résumé
Objectifs :
Description de la prise en charge médicamenteuse de
la douleur chez des patients cancéreux suivis en ville.
Méthode :
Enquête prospective par courrier, en 2002, auprès des
médecins du Réseau Sentinelles (réseau national de généralistes
participant à une surveillance épidémiologique). Inclusion du
premier patient cancéreux douloureux vu en consultation. Me-
sure de la douleur par échelle visuelle analogique (EVA). Le trai-
tement avant et après la consultation était recueilli.
Résultats :
Sur les 1 113 médecins contactés, 398 (35,7 %) ré-
ponses. 248 questionnaires valides. 150 réponses non utilisa-
bles, essentiellement par absence de patient éligible. Sexe-ratio
de 1,85, lié à un excès de cancers associés au tabac. Avant la
consultation, 7 % n’avaient aucun antalgique et 45 % avaient
déjà un palier III. Lors de la consultation, 96 malades (39 %)
avaient des douleurs modérées ou fortes (EVA > 4 cm). Parmi
ceux-ci, 20 % (19/96) n’ont pas eu d’intensification de traite-
ment. Seulement 62/135 patients (46 %) ayant un morphinique
à l’issue de la consultation, avaient une prescription d’interdo-
ses.
Discussion :
Première enquête nationale depuis 1995 décrivant
les modalités de traitement des douleurs cancéreuses en milieu
libéral. Des comparaisons indirectes avec les enquêtes antérieu-
res semblent montrer une meilleure prise en charge de la dou-
leur. Néanmoins, une proportion encore importante de malades
n’avait pas reçu de proposition de soulagement adéquat. De
plus, les doses de secours ont été trop rarement prescrites.
Conclusion :
Les efforts de formation des médecins généralistes
sur la douleur semblent avoir porté leurs fruits mais de manière
encore insuffisante et doivent impérativement être poursuivis.
Mots clés :
douleur, cancer, médecine générale, morphine, inter-
doses.
A
bel A et al. Prise en charge médicamenteuse de la douleur cancéreuse en mé-
decine générale. Med Pal 2004; 3: 126-133.
Adresse pour la correspondance :
Anne Abel, EMASP, Hôpital Louis-Mourier, 178, rue des Renouillers, 92700 Colom-
bes. Tél. : 01 47 60 67 65. Fax : 01 40 61 56 88.
e-mail : [email protected]

Med Pal 2004; 3: 126-133
© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés
127
www.e2med.com/mp
ÉTUDE ORIGINALE
Anne Abel
et al.
Introduction
La fréquence des plaintes douloureuses augmente avec
l’évolution du cancer, atteignant 75 % des patients at-
teints de tumeurs en stade avancé [1]. La douleur d’origine
cancéreuse touche donc une partie importante de la po-
pulation puisque le nombre de décès par cancer était ap-
proximativement de 147 000 par an en France en 1999
selon les données de l’Inserm (http://sc8.vesinet.in-
serm.fr). Parallèlement à des publications internationales
faisant état d’insuffisance dans la prise en charge de la
douleur [2, 3], des enquêtes épidémiologiques, parues en
1995, ont mis en évidence les mêmes lacunes en France
[4-6]. Deux de ces enquêtes fournissaient les réponses des
médecins généralistes sur leurs connaissances concernant
le traitement de la douleur cancéreuse, et relevaient à la
fois l’imperfection de leur formation et l’existence de
puissants freins à l’utilisation d’antalgiques forts.
Depuis lors, la lutte contre la douleur a fait l’objet de
nombreuses actions et avancées. La législation sur les stu-
péfiants a été assouplie. L’Agence Nationale d’Accréditation
et d’Évaluation en Santé (ANAES) et la Fédération Natio-
nale des Centres de Lutte contre le Cancer (FNCLCC) ont
établi des recommandations, largement diffusées, de même
qu’ont été médiatisés reconnaissance de la douleur, avan-
cées médicamenteuses et droits des malades. Depuis 1995,
aucune enquête épidémiologique s’intéressant aux prati-
ques libérales vis-à-vis de la prise en charge de la douleur
cancéreuse sur l’ensemble du territoire métropolitain n’a été
publiée. D’autres travaux ont porté sur les patients consul-
tant en milieu hospitalier [7, 8], sur les douleurs d’autres
origines [9] ou sur des régions et départements, donc dif-
ficilement extrapolables à l’ensemble des généralistes fran-
çais (www.sfsp-publichealth.org/Plan-lutte-Douleur). Afin
de mieux connaître la façon dont est actuellement prise en
charge la douleur cancéreuse en France, nous avons effec-
tué une enquête épidémiologique transversale auprès de
médecins généralistes libéraux. Notre étude avait pour ob-
jectif de décrire les habitudes de prescriptions d’antalgiques
parmi les cancéreux suivis en ville, en prenant comme ré-
férences les recommandations internationales de l’OMS
[10] ainsi que françaises de l’ANAES [11] et de la FNCLCC
[12, 13].
Méthode
Les médecins interrogés : le réseau « Sentinelles »
Le réseau « Sentinelles », plate-forme de recherche de
l’unité Inserm U444, recueille les données fournies bénévo-
lement par plus de 1 000 médecins généralistes libéraux,
répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il permet
ainsi depuis 1984, la surveillance de maladies infectieuses
telles que la grippe ou d’autres risques sanitaires et des re-
cherches sur ces pathologies (http://www.u444.jussieu.fr).
Les médecins sentinelles sont aussi sollicités pour des en-
quêtes ponctuelles comme celle que nous avons effectuée.
Recueil des données
L’ensemble des 1 113 médecins sentinelles a reçu un
questionnaire standardisé par voie postale mi-mars 2002 ;
en cas de non-réponse, une relance leur était adressée
deux mois plus tard. Il leur était proposé de :
–inclure (anonymement) le premier malade cancé-
reux douloureux qu’ils verraient en consultation. Pour
être inclus, les patients devaient avoir ressenti des dou-
leurs lors de la consultation ou dans la semaine qui la
précédait, ou être déjà traités par des antalgiques. L’ori-
gine de la douleur devait être attribuée par le médecin au
cancer ou aux effets secondaires des traitements d’un
cancer. Il devait s’agir de malades adultes, capables d’es-
timer leur douleur sur une échelle visuelle analogique
(EVA) ;
–décrire quelques caractéristiques du patient (âge,
sexe, diagnostic) ;
–évaluer à l’aide d’une EVA,
l’intensité des douleurs à trois temps
différents (au moment de la consul-
tation : T0, et rétrospectivement la
veille : T-1 et la semaine précédant
la consultation : T-7). Une phrase
type était suggérée au médecin pour présenter l’EVA à
son patient. La formulation était sensiblement la même
selon que l’évaluation portait sur le moment même, la
douleur de la veille ou la douleur rapportée en moyenne
sur la semaine écoulée ;
–spécifier le traitement prescrit à l’issue de la con-
sultation, et le cas échéant les modifications par rapport
au traitement antérieur ;
–signaler une éventuelle prise en charge conjointe
par un médecin spécialiste, une consultation antidouleur
ou de soins palliatifs ;
–préciser le nombre de patients cancéreux auxquels
ils avaient prescrit un opiacé durant l’année écoulée.
En cas d’illisibilité, de réponses manquantes ou inco-
hérentes, le médecin était contacté par téléphone pour ob-
tenir des précisions. L’inclusion s’est arrêtée fin
août 2002.
Une enquête téléphonique a eu lieu auprès de 50 mé-
decins non-répondants tirés au sort, pour connaître les
causes d’absence de participation.
Analyses
L’évaluation de la douleur a été traitée à la fois en con-
sidérant la variable continue (mesure en cm de l’EVA) et
en la discrétisant. Dans ce dernier cas, les douleurs rappor-
La législation
sur les stupéfiants
a été assouplie.

Médecine palliative
128
N° 3 – Juin 2004
Prise en charge médicamenteuse de la douleur cancéreuse en médecine
générale
ÉTUDE ORIGINALE
tées étaient classées en trois catégories en nous appuyant
sur l’article de Serlin et Cleeland [14]. Ainsi nous avons
groupé les EVA en douleurs dénommées « faibles » pour des
valeurs inférieures ou égales à 4, « moyennes » ou « modé-
rées » entre 4 et 7, et « fortes » à partir de 7. Concernant
les antalgiques, la classification utilisée est celle des paliers
de l’OMS [10]. L’analyse statistique a été réalisée avec le
logiciel SAS. Les comparaisons de moyennes sur les varia-
bles quantitatives ont été faites par des tests non paramé-
triques de Wilcoxon. Les coefficients de corrélation ont été
mesurés par le coefficient de Spearman et les comparaisons
de fréquences entre différents groupes par des tests de Chi2.
Résultats
Description des médecins participants
Sur les 1 113 médecins contactés, 398 (35,7 %) ont ré-
pondu. Parmi ceux-ci, 248 (62,3 %) ont envoyé un ques-
tionnaire valide. Les 150 autres réponses se répartissaient
en 120 médecins déclarant n’avoir
pas vu de patient éligible, et 30 ré-
ponses inexploitables, la majorité
étant l’expression de refus soit par
manque de temps, soit pour cause de
grève des médecins généralistes
(2002). L’enquête téléphonique auprès
de l’échantillon de médecins non-ré-
pondants montre que la première
cause évoquée de non-réponse est
l’absence de patient éligible dans 44 % des cas (22/50).
Viennent ensuite le manque de temps dans 40 % des cas,
et un émoussement de l’intérêt pour les enquêtes dans 8 %
des cas. Le pourcentage de patients éligibles qu’auraient pu
voir ces médecins n’est pas connu.
La répartition des 248 médecins répondants selon cinq
grandes zones géographiques françaises était la suivante :
23,5 % provenaient du Nord-Ouest, 20 % du Nord-Est,
16 % de l’Ile-de-France, 17 % du Sud-Ouest, et 23,5 % du
Sud-Est. La distribution des médecins répondeurs ne dif-
férait pas de l’ensemble des médecins du réseau. Parmi les
248 questionnaires, 148 généralistes (60 %) déclaraient
prendre seuls en charge la douleur de leur patient, 79
(32 %) conjointement avec un spécialiste le plus souvent
hospitalier. Vingt et un médecins (8 %) partageaient la
prise en charge avec une consultation spécialisée en dou-
leur ou en soins palliatifs. Le nombre de cancéreux aux-
quels les généralistes ont prescrit des opiacés de niveau
III durant l’année écoulée a fluctué entre 0 et 25, avec
une moyenne à 5,1 (
±
4,7) (moyenne
±
ds). Ce nombre doit
cependant être pris avec prudence, puisque son estimation
a été réalisée auprès de médecins qui ont eu au moins un
patient éligible.
Description des cas
Sur les 248 patients, 161 (64,9 %) étaient des hom-
mes, se répartissant entre 30 et 89 ans (65,5
±
12,1). Les
87 femmes se situaient entre 36 et 89 ans (63,9
±
12,3).
La différence d’âge entre les sexes n’est pas significa-
tive. En revanche il existe un fort excès d’hommes dans
notre échantillon (p<0,001), par rapport à la proportion
dans l’ensemble des patients atteints de cancer en
France, qui serait de 51 % selon les estimations l’IARC
sur des données de prévalence [15] (http://www-
dep.iarc.fr/eucan/eucan.htm). Le
tableau I
présente la
répartition des sites primitifs de cancer en fonction des
sexes. On observe que les proportions des cancers des
voies aéro-digestives supérieures (17 %) et broncho-
pulmonaires (16 %) sont particulièrement élevées. En
effet, selon l’IARC, les proportions estimées de ces mê-
mes tumeurs parmi les cancéreux en France sont res-
pectivement de 10 % et 6 %. Ces cancers, liés au tabac,
sont à forte prédominance masculine (73/84 cas dans
notre échantillon). Or notre enquête a naturellement re-
cruté les cancers entraînant fréquemment ou rapidement
des douleurs, plus souvent que les cancers permettant
une bonne qualité de vie du fait d’un dépistage précoce
ou d’une survie habituellement longue. L’excès d’hom-
mes est donc vraisemblablement lié aux types de can-
cers recrutés. Nous notons également que la proportion
d’atteintes pancréatiques, localisation fréquemment res-
ponsable de douleurs intenses, est plus élevée dans notre
population (5 %) que celle estimée dans la population
des patients atteints de cancer en France (1 %).
Description des douleurs
La distribution de l’intensité de la douleur rapportée
par les 248 patients au moment de la consultation, est
présentée dans la
figure 1
sous forme d’un histogramme.
Les moyennes (déviation-standard) des valeurs d’EVA ob-
servées sur l’ensemble des patients étaient respectivement
les suivantes : 3,58 cm (
±
2,5), 3,92 cm (
±
2,16), et
4,06 cm (
±
2,11). Pour aucun des trois temps, il n’y a de
différence significative entre les sexes pour les moyennes
d’intensité douloureuse. Après catégorisation en trois
classes de l’EVA
(tableau II)
, au moment de la consulta-
tion, 152 (61,3 %) malades avaient une douleur faible, 58
(23,4 %) une douleur moyenne, 38 (15,3 %) une douleur
forte.
Il existe une forte dépendance entre les évaluations de
douleur aux différents temps. Lorsque les EVA sont con-
sidérées de manière quantitative, les coefficients de cor-
rélation entre les différents temps, comparés deux à deux,
sont très significatifs (p<10
–6
), compris entre 0,55 et 0,75.
Parallèlement, lorsque les douleurs sont catégorisées en
trois niveaux (faible, moyen, fort), plus de 90 % des pa-
tients rapportent une intensité de douleur concordante en-
L’excès d’hommes
est donc
vraisemblablement lié
aux types
de cancers recrutés.

Med Pal 2004; 3: 126-133
© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés
129
www.e2med.com/mp
ÉTUDE ORIGINALE
Anne Abel
et al.
tre les trois temps d’évaluation. Par concordance, nous
entendons le fait que le malade ait coté la douleur de ma-
nière assez proche aux trois temps d’évaluation, c’est-à-
dire trois fois dans le même niveau, ou deux fois dans le
même et la troisième fois dans un niveau voisin. La suite
des résultats présentés ici est restreinte aux douleurs me-
surées chez les patients au moment de la consultation (T0).
Description des antalgiques
Antalgiques avant la consultation
Le
tableau III
indique la répartition des classes d’an-
talgiques que les patients ont déclaré prendre en fonction
de leur niveau de douleur lors de la consultation. Avant
la consultation, environ 7 % n’avaient pas reçu d’antal-
giques. Près de 46 % (115/248) avaient une monothérapie,
de palier I (14 %), de palier II (2 %), et de palier III (30 %).
10 % des patients recevaient une association d’opioïdes
faibles et forts. Parmi les 112 patients recevant un opioïde
fort, plus de la moitié (66) se trouvait au moment de la
consultation dans le groupe à intensité faible, donc avec
des douleurs contrôlées.
Modification des prescriptions à l’issue de la
consultation
Sur 152 malades rapportant une douleur de faible in-
tensité au moment de la consultation, trois patients
n’avaient pas d’antalgiques (ni avant ni après la consul-
tation), mais tous trois avaient un co-antalgique (respec-
tivement un corticoïde, un anti-épileptique, et un spas-
molytique). Parmi les 66 patients recevant déjà un
antalgique de palier III, le médecin a décidé de diminuer
la posologie journalière chez sept patients, a prescrit en
plus un médicament contenant une association de palier I
Tableau I : Répartition des cas par sites primitifs de cancer.
Table I: Cases of primary cancer by site.
Type de
cancer
Hommes Femmes Total
n (%) n (%) n (%)
ORL +
œsophage
39 (24) 4 (5) 43 (17)
Bronches +
poumon
34 (21) 7 (8) 41 (16)
Sein – – 34 (39) 34 (13)
Prostate 28 (17) – – 28 (11)
Colon +
rectum
13 (8) 9 (11) 22 (9)
Pancréas 6 (4) 6 (7) 12 (5)
Rein 6 (4) 4 (5) 10 (4)
Utérus +
ovaire
--10 (12) 10 (4)
Hémopathie 5 (3) 4 (4) 9 (4)
V
essie 7 (4,5) 1 (1) 8 (3)
Foie 7 (4,5) 0 (0) 7 (3)
Estomac 5 (3) 1 (1) 6 (3)
A
utres 11 (7) 7 (8) 18 (8)
Total 161 (100) 87 (100) 248 (100)
Tableau II : Répartition des patients en fonction des catégo-
ries de douleurs, aux trois moments d’évaluation de l’EVA.
Table II: Patient distribution by type of pain at three times of visual
analog scale evaluation.
Niveau de
douleur
T0 (%) T-1 (%) T-7 (%)
Faible 152 (61,3) 133 (53,6) 129 (52,9)
Modérée 58 (23,4) 92 (37,1) 90 (36,9)
Forte 38 (15,3) 23 (9,3) 25 (10,2)
TOTAL 248 (100) 248 (100) 244 (100)
Figure 1. Répartition des valeurs d’EVA en cm, recueillant
l’intensité douloureuse au moment de la consultation.
Figure 1. The visual analog scale (in cm) for pain intensity at the time
of consultation.
<1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
0
10
20
30
40
50
EVA à T0 (cm)
nombre de patients

Médecine palliative
130
N° 3 – Juin 2004
Prise en charge médicamenteuse de la douleur cancéreuse en médecine
générale
ÉTUDE ORIGINALE
et II chez huit patients, a augmenté la posologie chez
11 patients ; et quatre nouveaux patients ont eu une pres-
cription de palier III. Parmi ces 11 patients ayant eu une
augmentation et ces quatre ayant eu une introduction de
palier III, tous avaient déclaré avoir eu des douleurs mo-
dérées ou fortes à T-1 ou T-7.
Parmi les 96 médecins confrontés à des patients dé-
clarant des douleurs moyennes ou fortes au moment de
la consultation, 77 (80 %) ont intensifié le traitement. Par
« intensification du traitement médicamenteux » nous en-
tendons l’introduction d’une nouvelle molécule (antalgi-
que ou co-antalgique), ou l’augmentation de posologie de
molécules déjà prescrites antérieurement. Les patients des
19 autres médecins se répartissent ainsi :
–5/38 (13 %) patients rapportant des douleurs fortes
au moment de la consultation. Tous avaient mentionné
des douleurs moyennes ou fortes la veille ou la semaine
précédente. Tous rapportaient prendre déjà un antalgique
de palier III. La posologie la plus élevée était de 200 mg/j
d’équivalent morphinique oral. Un seul sur les cinq avait
la possibilité de prendre une interdose ;
–14/58 (24 %) patients avec des douleurs modérées.
Douze avaient rapporté des douleurs moyennes ou fortes
la veille et dans la semaine précédant la consultation.
Neuf recevaient déjà un palier III ; trois seulement
avaient une prescription d’interdoses, et à des posologies
très faibles.
Ainsi, 20 % des patients ayant des EVA témoignant
de douleurs modérées ou fortes, qui
a priori
, auraient
justifié une intensification de traitement, n’ont pas eu
de modification de leurs prescriptions d’antalgiques. Il
n’a pas été mentionné pour ces patients que des théra-
pies autres que médicamenteuses aient été mises en œu-
vre. De manière générale, par sa structure et son inti-
tulé, le questionnaire recueillait préférentiellement les
informations médicamenteuses. Néanmoins une ques-
tion portait sur les autres mesures (kinésithérapie, in-
filtrations, soutien par un psychologue, relaxation,
hypnose, ou autres à mentionner librement) dont pou-
vait bénéficier le patient. Cette question a été rarement
renseignée, quel que soit le niveau de douleur, et n’est
donc pas utilisable.
Antalgiques de palier III et interdoses
À l’issue de la consultation, le nombre total de patients
ayant eu une prescription d’antalgique de palier III était
de 135. Nous nous sommes intéressés à la proportion de
patients ayant eu une prescription d’interdoses, qui sont
recommandées pour les douleurs intercurrentes à la po-
sologie d’un sixième de la dose de 24 heures [12]. La
figure 2
indique la répartition des prescriptions d’interdo-
ses en fonction du mode d’administration de l’opiacé.
Parmi les 135, seulement 62 (46 %) ont une prescription
d’interdose. Cette proportion est encore plus faible dans
le sous-groupe traité par patch transdermique de fentanyl
(32 %). Parmi les 50 patients pour lesquels sont connus à
la fois la posologie et le nombre maximal d’interdoses,
neuf (18 %) ont reçu la prescription d’une dose corres-
pondant au sixième de la dose totale journalière. Le nom-
bre maximal d’interdoses prescrites par jour était de six
dans 10 % des cas, de quatre par jour dans 32 % des cas,
et de trois ou moins dans les autres cas.
La prescription d’interdoses n’était pas liée à l’habitude
que rapportait le généraliste de prescrire des opiacés. Cette
dernière notion a été estimée à partir du nombre de pa-
tients atteints de cancer, traités par antalgiques de pa-
Tableau III : Répartition des paliers d’antalgiques pris avant la consultation, en fonction des
niveaux de douleur à T0.
Table III: Pain levels before consultation by level of pain at T0.
Niveau de
douleur
Antalgiques
Aucun I seul II et I
+ II
III seul III en
association à
I et/ou II
Total
Faible 7 28 51 50 16 152
Modérée 9 4 21 15 9 58
Forte 2 3 11 10 12 38
Total 18 35 83 75 37 248
(%) (7,2) (14,1) (33,5) (30,2) (14,9) (100)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%
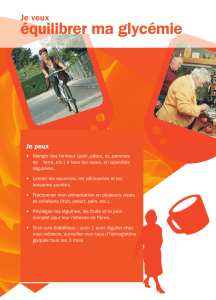
![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)