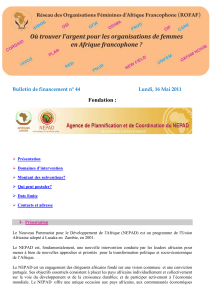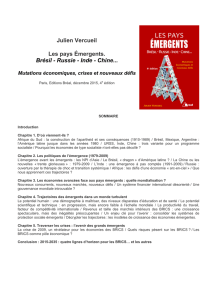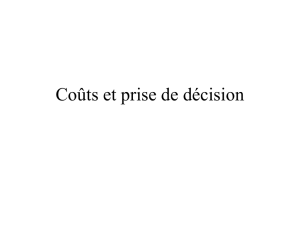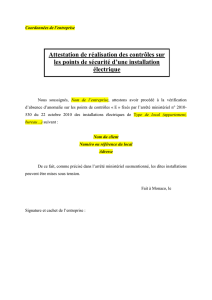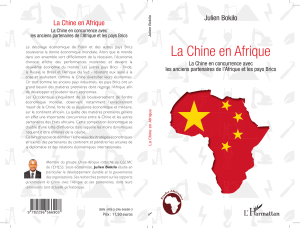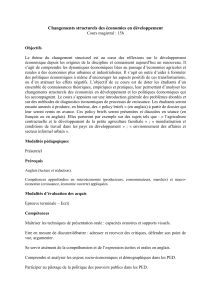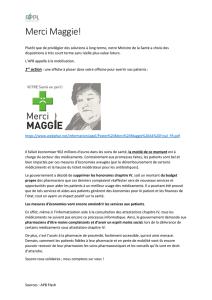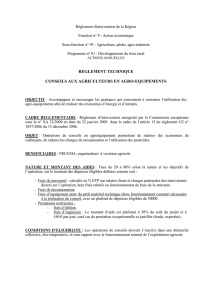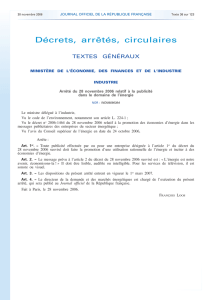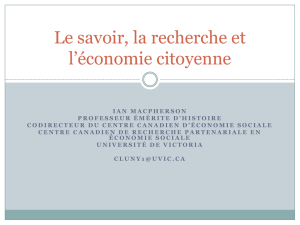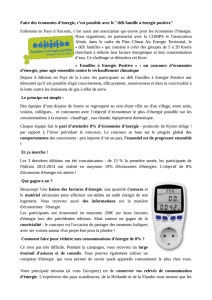Télécharger l`article ici - Professeur Moustapha Kassé

1
Cohérences institutionnelles et réhabilitation de l’Etat, de la planification
et du partenariat.
Professeur Moustapha Kassé
Il a échappé à notre presse comme aux observateurs avisés de la vie économique et
politique du pays, les nouveaux dispositifs de management public décidé par le Chef de l’Etat
et décliné par son Directeur de cabinet lors du dernier remaniement ministériel. Sans doute,
le débat sur l’efficience des institutions de gouvernance est loin d’être clos. Mais des
avancées consistantes sont opérées en direction de la reconstruction et du réarmement d’un
Etat malmené durant des décennies par les pratiques d’un jacobinisme politique caractérisé
par le fameux slogan «moins d’Etat et mieux d’Etat».
Au-delà des fantasmes, les théories et pratiques néolibérales étriquées n’ont jamais
montré que la gestion publique de certains secteurs de production est obligatoirement plus
mauvaise que la gestion privée ni même que la planification est à la fois non nécessaire et
illusoire. Au demeurant, la mise en œuvre de politiques sectorielles pertinentes avec une
allocation optimale des ressources en faveur des activités productives, la promotion d’un
secteur privé dynamique par création d’un environnement assaini des affaires, la
mobilisation de la communauté internationale dans le cadre d’un nouveau partenariat, sont
des objectifs majeurs qui appellent impérativement la construction d’un Etat fort, réactif et
efficient pour réaliser le bien-être et la qualité de vie de toutes les couches sociales. Pour
atteindre ces objectifs, il faut à juste titre, des réformes structurelles de l’économie et de
l’Etat afin qu’il dispose d’une panoplie d’instruments d’action pour l’élaboration et
l’application de sa stratégie de développement. En prenant l’exemple de la Chine, à la fin du
maoïsme (1980), les dirigeants ont abandonné la confrontation directe, pour s’engager dans
la voie du développement par « la réforme et l’ouverture». Lors du dernier remaniement
ministériel, des jalons importants sont posés en direction de l’opérationnalité des
institutions et de leur mise en cohérence. Quelle est la portée et les limites des nouveaux
dispositifs?
1°) L'Etat est plus utile que jamais, toutefois, il doit être fortifié et
inséré dans jeu économique et social par des institutions fonctionnelles. Il faut
dépasser la focalisation sensationnaliste sur la taille gouvernementale et le personnel qui
l’anime pour aller aux questions de fonds relatives à sa vision stratégique, son
fonctionnement et ses instruments d’action. En termes techniques, au-delà de la vision, face
à la complexité croissante de notre société, à la diversité des espaces territoriaux, l’Etat doit
être fortifié, adapté et capable d’agir efficacement sur l’économie et le social. Il lui faut alors
dépasser les modes bureaucratiques et poncepilatistes d’action pour privilégier deux
principes : premièrement l’imposition d’un système méritocratique où chacun peut grimper
l’échelle sociale et politique en faisant la preuve de sa valeur et deuxièmement l’obligation
de l’évaluation permanente qui est un acte stratégique. En termes de fonctionnalité, l’Etat
doit se rapprocher du modèle «d’Etat Pro» (producteur, promoteur, programmeur et
prospecteur). Cette institution est l’architecte des énormes succès en Asie. Sans cet acteur
essentiel pas de sécurité des biens et des personnes, pas de marchés organisés, pas de
production de biens publics porteurs d’externalités positives sans lesquelles aucune
économie ne peut se développer durablement, à commencer par une éducation garantie et
obligatoire ou un système de santé de qualité.

2
2°) Réhabiliter la planification en la plaçant au cœur de l’architecture
économique. Les néolibéraux avaient supprimé la planification en imposant partout (et en
tout domaine) la logique des marchés. Ils avaient sciemment occulté le fait que le marché
laissé à lui-même est non seulement myope mais parfois même aveugle : il ne voit pas les
faibles, les pauvres, les inorganisés (J. Delors). Le marché en soi est dépourvu de conscience
active et ne connait pas la vision à long terme et la recherche de l’intérêt général (holisme).
Or, on sait « qu’il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va » (Sénèque) et on
sait également que «l’avenir appartient à ceux qui ont la mémoire la plus longue »
(Nietzsche). Une fois la stratégie adoptée, la planification devra être cet instrument qui fixe
le système normatif des choix économiques et sociaux ainsi que le cheminement reliant le
court, le moyen et le long terme. En conséquence, elle doit centraliser les projets et
programmes (techniquement évalués et priorisés), éclairer les processus décisionnels et
conforter la pertinence et la cohérence des choix économiques et sociaux. Dans tous les pays
émergents particulièrement en Chine et en Inde la planification occupe une place centrale
dans le dispositif économique et financier. La Chine a, depuis 2005, publié le projet pour
2050 dans lequel il est écrit « pour être un peuple respecté, il faut appliquer pour l’essentiel
ce qu’on annonce….Cela revient à participer complètement au grand jeu mondial et à s’en
donner les moyens ».
Dans notre pays, les limites antérieures du processus de planification résidaient dans
le caractère trop formaliste des plans qui prétendaient embrasser à la fois tous les secteurs
d’activité économique, dans l’agrégation de projets mal évalués, dans l’absence de
mécanismes institutionnels permettant de relier la gestion courante à court terme (budget)
et la programmation à moyen et long termes, dans la très faible mobilisation des acteurs et
enfin dans l’instabilité institutionnelle et le caractère constamment changeant de la politique
gouvernementale. C’est dire que la planification, aujourd’hui, est un vaste chantier à
reconstruire et cela, au moins, dans deux directions : d’abord, celle de la mise en cohérence
des quatre documents d’orientation stratégique que sont le Plan National, le Document des
Politiques Stratégiques, la Stratégie de Croissance Accélérée et le Programme du Yoonou-
Yokouté et ensuite celle de l’élaboration et de l’évaluation des projets des ministères
techniques et des administrations décentralisées conformément aux techniques préconisées
par la Déclaration de Paris des partenaires (2002).
3°) Exploiter les nouveaux partenariats du monde multipolaire pour mettre
en valeur les potentialités du Sénégal. De la Déclaration du Millénaire des Nations
Unies au plaidoyer en faveur du NEPAD, la communauté internationale avait engagé, en
2000, toutes les institutions de développement notamment l’ONU, l’OCDE, le FMI et la
Banque Mondiale à faire de la croissance des économies africaines le fondement commun
de leurs actions et de leurs programmes. Cette posture découlait de la nouvelle
configuration des rapports de puissance dans la mondialisation. En effet, l’hégémonie de
l’Occident construite pendant deux siècles à partir de la révolution industrielle du 19ème
siècle et de la prédation des matières premières (découlant du Congrès de Vienne de 1815)
semble prendre fin avec la montée des puissances émergentes notamment les BRICS dont
l’âge d’or commence. Ces pays constituent, aujourd’hui, un nouveau pôle de puissance,
d’attractivité et de croissance et sont à la base de l’embellie des économies africaines
(croissance d’environ 5%) depuis plus d’une décennie. Ils ont permis les modifications du
fonctionnement des marchés internationaux des matières premières et contribué à

3
l’amélioration des termes de l’échange. Pour rappel, la Chine est le premier partenaire
commercial de l’Afrique et son principal bailleur de fonds.
Ce nouveau contexte économique, financier et technologique mondial se traduit par
une remise en question de l’ancienne coopération Nord-Sud et la constitution de nouveaux
partenariats en faveur de l’Afrique : l’AGOA et le MCA pour les Etats-Unis, la TIGAD pour le
Japon, le Plan d’Action de Beijing avec la Chine, la Coopération indo-africaine et les multiples
révisions des conventions UE-ACP. Même le secteur privé international, lors de sa deuxième
rencontre à Dakar les 16 et 17 avril 2002 regroupant plus de 500 entreprises, avait manifesté
un intérêt pour le continent.
Manifestement, d’énormes opportunités sont entrouvertes par ces diverses offres de
partenariat économique et financier. Toutefois, ces nouveaux accords ne profiteront qu’aux
Etats capables de définir, de formuler et d’appliquer des politiques sectorielles économiques
et financières pertinentes. D’ailleurs, des pays comme le Maroc, la Namibie et le Cameroun
ont élaboré des stratégies de moyen et long terme vis-à-vis de leurs partenaires des pays
émergents. En effet, les BRICS disposent d’environ 72% des réserves financières du monde
et un potentiel scientifique et technologique appréciable. Ils peuvent transférer, à des
conditions douces les capitaux et les technologies pouvant permettre à nos opérateurs
économiques de disposer de moyens financiers et autres pour construire des usines et des
pôles commerciaux à la place des étals qui structurent actuellement notre secteur informel
commercial.
En définitive, les initiatives en cours rendent possible une véritable contractualisation
du développement avec l’acceptation par les parties concernées d’une stratégie à long
terme pertinente, cohérente et « gagnant-gagnant ». Cette perspective commande un
nouvel élan à l’intégration régionale qui souffre du manque de volonté politique claire, de
définition et d’exécution de projets intégrateurs, et de structures de commandement
(leadership). Une chose est sûre, il faut créer de nouveaux outils de coopération avec les
partenaires et veiller à leur application dans une approche communautaire par organisation,
par exemple, de pôles de compétitivité dans les secteurs vitaux comme ceux retenus par le
NEPAD (infrastructures, énergie, technologie, agriculture, ressources humaines, etc.). Les
ZES (Zones Economiques Spéciales) répondent parfaitement à ces préoccupations.
4°) Une structure de gestion autonome des défis énergétiques. La création d’une
structure ministérielle en charge de la question de l’énergie est hautement positive. Les
multiples et complexes problèmes actuels du secteur et la perspective dans les prochaines
décennies, d’une augmentation de la demande induite par l'expansion démographique et
l’accès au développement, oblige à trouver des solutions sérieuses. D’ou la nécessité de
repenser complètement la production et la consommation pour un pays pauvre et peu doté
en pétrole. Dans ce contexte, il s’impose à faire de la modification des modes de production
et de consommation ainsi que du développement des énergies renouvelables un enjeu de
premier plan. D’ailleurs, sur ces deux points, les progrès technologiques et les outils offerts
par l’électronique programmable permettent d’optimiser la consommation et la production
dans le temps et dans l’espace. Aujourd’hui, il est possible de réaliser d’importantes
économies en contrôlant la consommation par des réseaux intelligents et en modifiant les
comportements des utilisateurs (surtout publics), de veiller à l’efficacité énergétique des
équipements et d’investir dans le développement des énergies renouvelables. Les
techniques de transformation de l’énergie solaire ou éolienne en électricité sont maintenant

4
bien maitrisées, il faut sortir de l’état de projet-gadget et passer à la production comme
solutions d’appoint et de proximité, permettant de répondre à des situations spécifiques.
En conclusion.
Les chantiers des réformes économiques et institutionnelles sont lancés pour
participer à la stratégie de transformation de la société et doivent donner une priorité
effective aux objectifs sociaux d'éradication de la pauvreté, du chômage et de la précarité.
Pour cela, il importe de mobiliser (tout autrement) les moyens disponibles pour diversifier et
dynamiser tous les secteurs de production afin d’octroyer à l'économie une plus grande
efficience en libérant les initiatives individuelles et collectives. Le credo, pour répondre à ces
multiples défis est de réussir la croissance, encore la croissance et toujours plus de
croissance. En fait, il n’existe pas de mystère : il faut travailler dur pour réussir, travailler
encore plus et toujours mieux, un travail patient et de longue haleine dans lequel il faut
engager la société toute entière.
Toutefois, l'expérience de l'Afrique a été assez édifiante sur la faillite du modèle
néolibéral d’ajustement structurel imposé comme un modèle de développement clé en
mains : plus l'on parlait de croissance, plus la pauvreté se répandait. Dès lors, les populations
avaient fini par se demander à quoi sert une « croissance » qui broie les êtres humains et
accroît la misère et l'exclusion? L’alternative est une croissance qui profite équitablement à
tous, aux femmes et aux hommes de toutes les conditions, aux jeunes et aux personnes
âgées. Nous pouvons nous en sortir si nous parvenons à revitaliser la citoyenneté par
recréation d’une véritable citoyenneté de développement et à maîtriser nos « démons »
internes qui ont nom impatience et corruption, laxisme (« thiakhneries » dénoncées par le
Président Senghor), incivisme et libertinage, cérémonies familiales innombrables et
dispendieuses, pollution et encombrement, forte tendance à nombriliser nos problèmes etc.
1
/
4
100%