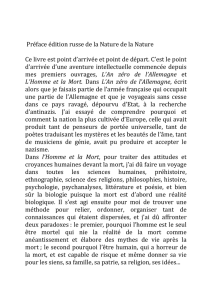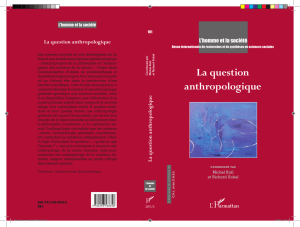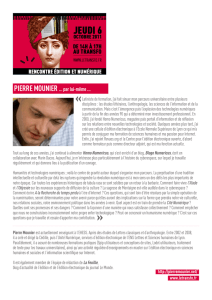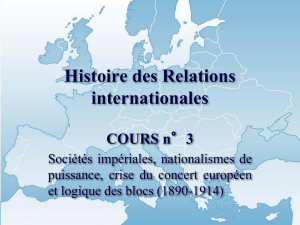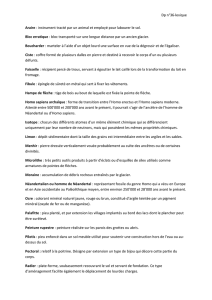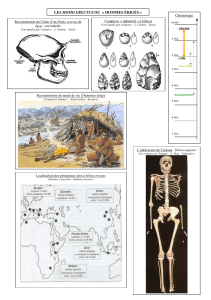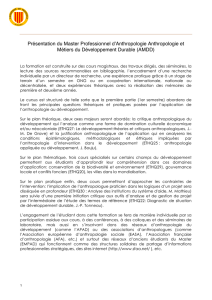Etre_ou_ne_pas__tre_balkanique_

Appel à contributions
C i v i li s a t io n s
vol. 60 (2)
A paraître à l’automne 2011
Être ou ne pas être balkanique
Les péripéties historiques d'une aire culturelle
Dossier coordonné par Marianne Mesnil et Vintilà Mihailescu
Pourquoi ce questionnement sur un Homo Balkanicus ?
Le syntagme mobilise des stéréotypes bien ancrés en Occident : que l'on pense à la poudrière
des Balkans, expression apparue lors des premières « Guerres Balkaniques » (1912-1913), et
resurgie en Occident lors des nouveaux conflits qui ont mis à feu et à sang les régions de l'ex-
Yougoslavie durant la décennie 1991-1999. Mais les désignations de Balkans et balkanique
ont également resurgi et interpellé de manière significative les intellectuels de ces régions, dès
la chute des régimes socialistes. S'interroger sur la légitimité de l'expression n'est donc pas le
fait du monde occidental (dont l'ignorance concernant cette partie de notre continent se
confirme, même après l’« Entrée dans l'Europe » de bon nombre de ces pays), mais d'abord le
fait de ces pays eux-mêmes.
Un programme de recherche annoncé dans l'Entre Deux Guerres
Dans le court intervalle entre les Traités qui ont suivi la Première Guerre (Versailles et Sèvres
1919-20), et le début de la Seconde Guerre Mondiale, s'est dégagé un bref moment de
réflexion comparatiste au sein des « jeunes nations » de l'Est. C'est durant cette période que
l'historien roumain V. Papacostea, a lancé l'expression de Homo Balkanicus, désignant ainsi le
thème de ses préoccupations: définir ce que nous pourrions appeler, en anthropologie, une
« aire culturelle », fondée, pour l' essentiel, sur une très longue histoire commune, un « vivre
ensemble », dirait-on aujourd'hui, pour reprendre une expression (un peu trop) à la mode
1
.
C'est après 1989 qu'on a vu resurgir avec force, dans les régions concernées, la « question
balkanique ». Mais les termes en sont, bien entendu, réactualisés et participent de l'inflation
généralisée des discours identitaires dont la discipline anthropologique a fait l'un de ses objets
privilégiés. Par ailleurs, au moment où cette problématique identitaire rencontre la question
du rapport entre « local et global », entre particularismes et unité planétaire; à l'heure,
également, où l'Europe, après avoir favorisé un « tout à l'économique » et s'être élargie à l'est,
sans autre plate-forme commune, a du mal à se trouver d'autres légitimités sur lesquelles
construire son unité, on peut s'interroger sur le bien fondé d'un questionnement à propos d'une
unité régionale dont les bases historiques ont été sapées dès la fin du XIXe siècle, avec les
« grands chambardements » décidés par les grandes puissances. Sans compter que, mal
interprétée, cette problématique d'une « unité balkanique » peut amener rapidement à
réactiver la querelle du Schisme entre Byzance et Rome et faire le lit de thèses que l'on a vu
fleurir sous la formule fallacieuse de « choc des civilisations ».
1
Voir Papacostea,V. "La Péninsule balkanique et le problème des études comparées (1938, en français) . Et un
inédit : "Balcanologia"; deux textes publiés ou republié en 1996 dans Sud-Est si Contextul Européan, Institutul
de studii sud-est europene, Buletinul Institutlui de Studii Sud-Est Europene, VI pp. 69- 78 et 133-138.

En utilisant la désignation de Homo Balkanicus, quelque peu provocatrice et controversée, vu
les connotations multiples qui lui sont attribuées, tant à l'est qu'à l'ouest, nous avons voulu
susciter ce débat anthropologique autour d'une identité mise à mal par l'accélération de
l'histoire qu'ont subi les pays ex-socialistes confrontés au déferlement sans contrôle des
influences néo-libérales, et aux phénomènes qui en ont découlé et que l'on a qualifié,
improprement sans doute, de « transition ».
Nous pourrions résumer la problématique sous-jacente à ce projet de publication autour des
questionnements suivants :
1. Homo Balkanicus et son histoire. Pax Ottomana et conflits balkaniques. Au moment
du drame de l'ex-Yougoslavie, il s’agit de comprendre la nature d’un « vivre
ensemble » séculaire que d'aucuns avaient qualifié de pax ottomana et comment celui-
ci a pu faire place à de telles manifestations de haine interethnique.
2. Homo Balkanicus et sa réputation. Géographie symbolique et jeux de pouvoir.
Comment le stigmate du balkanisme a-t-il vu le jour et comment cette image de
l’Autre est-elle devenue une image du Soi ? Autour de cette question, il s’agit aussi de
suivre le destin de cette représentation sociale, ses usages et clivages à l’intérieur et à
l’extérieur de la région.
3. Homo Balkanicus et son identité. Y a-t-il une aire culturelle balkanique ? Se
trouvant au coeur d'une problématique anthropologique profonde, cette question
concerne le concept tant discuté et disputé d’aire culturelle et son utilité dans ce cas
particulier. Quel est l’héritage de ce millénaire de cohabitation dans ces régions ?
Qu’en est-il à présent ? Les dernières décennies de bouleversements politiques et
l’instauration récente d’une économie de marché mondialisée ont-elles eu raison de
cet héritage culturel commun ?
Dans ce numéro, nous voudrions regrouper différentes recherches qui contribuent à présenter
une argumentation précise, à partir d'études de terrains qui s'articulent autour de cette
interrogation sur l'existence et la persistance d'une unité « balkanique », au-delà de sa
diversité et des récentes influences subies.
Les propositions d'articles, en anglais ou en français (un titre et un résumé de
300 mots), sont à envoyer avant le dimanche 20 juin 2010 au secrétariat et à un
éditeur de la revue ([email protected] et [email protected]), ainsi qu’aux
Vintilà Mihailescu ([email protected]).
Civilisations est une revue d’anthropologie à comité de lecture publiée par l'Institut de
Sociologie de l'Université libre de Bruxelles. Diffusée sans discontinuité depuis 1951, la
revue publie, en français et en anglais, des articles relevant des différents champs de
l’anthropologie, sans exclusive régionale ou temporelle. Relancée depuis 2002 avec un
nouveau comité éditorial et un nouveau sous-titre (Revue internationale d’anthropologie et de
sciences humaines), la revue encourage désormais particulièrement la publication d’articles
où les approches de l’anthropologie s’articulent à celles d’autres sciences sociales, révélant
ainsi les processus de construction des sociétés.
Pour plus de détails, voir http://civilisations.revues.org
1
/
2
100%