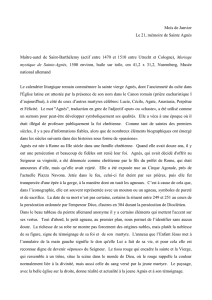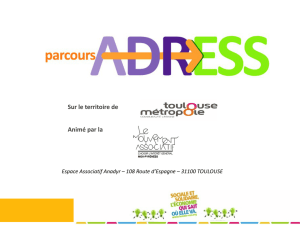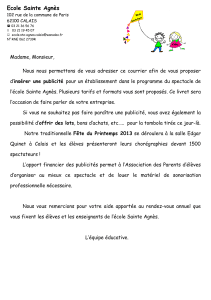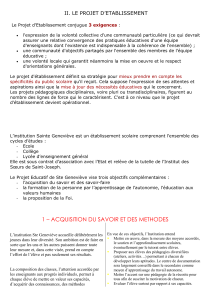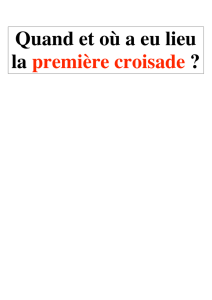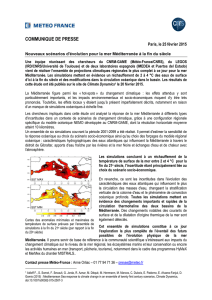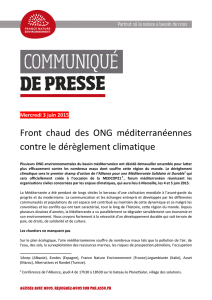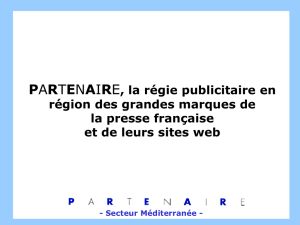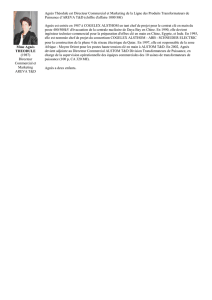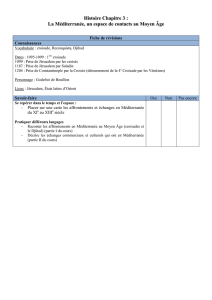SVT/DS/sujet Méditerranée

D’après Agnès Emond-Després, Lycée Sainte Geneviève, Versailles 1 / 12
Composition du 25 Mars 2017, BCPST2A
GEOLOGIE
Epreuve B
Durée : 2 heures
------
L'usage d'une calculatrice est interdit pour cette épreuve
Merci de composer sur des copies séparées de celles de biologie
Expédition en Méditerranée
15 documents sont donnés en annexe. Utilisez-les pour répondre aux différentes questions.
Les documents peuvent être insérés dans la copie, à condition d'être exploités.
Certains schémas sont explicitement demandés, mais vous êtes libres d'en ajouter d'autres dans la mesure où ils
aident à la compréhension.
Les 4 parties sont indépendantes.
A\ Image actuelle de la Méditerranée occidentale
1-a) Quelle est la gamme classique de profondeurs pour un plancher océanique (en mètres) ?
1-b) D'après les profondeurs visibles sur la figure 1, hachurez les parties de la « mer » Méditerranée dont le plancher est de la
croûte océanique.
On s'intéresse maintenant à la frontière entre les plaques Europe et Apulie (l'Apulie correspond à une protubérance de la plaque
Afrique) au niveau de l'Italie, et particulièrement dans la région de la Calabre et de la Sicile.
2) Utilisez les figures 2, 3 et 4 pour déterminer – en le justifiant – le type de frontière de plaque ainsi que sa géométrie.
Les Îles Eoliennes, situées au Nord de la Sicile (figure 5), sont des îles dont le volcanisme est encore actif actuellement.
3-a) Définissez ce qu'est une série magmatique.
3-b) Placez les roches volcaniques échantillonnées dans les Îles Eoliennes sur la diagramme de Cox (figure 6) et déterminez à
quelle série elles appartiennent. Vérifiez la logique de votre réponse avec la question 2.
3-c) A quoi correspondent de ce fait les Îles Eoliennes ?
La figure 7 présente une modélisation analogique du fonctionnement d'une zone de subduction, à partir d'un montage associant
une plaque de silicone (lithosphère plongeante) et du sirop de glucose (manteau).
4-a) Décrivez le processus visible sur la figure 7.
4-b) En imaginant que le même processus a lieu au niveau de la frontière de plaque Europe – Apulie étudiée précédemment,
quelles sont alors les contraintes appliquées sur la région située en arrière des îles Eoliennes ?Dessinez les flèches des
contraintes sur la figure 2.
4-c) En quoi cela peut-il expliquer la présence de la mer tyrrhénienne située entre l'ensemble Corse-Sardaigne et les îles
Eoliennes ?

D’après Agnès Emond-Després, Lycée Sainte Geneviève, Versailles 2 / 12
5) Commentez la géométrie de la plaque plongeante à grandes profondeurs (au-delà de 400 km) en utilisant les figures 3 et 7.
6) Bilan : réalisez une coupe schématique selon un axe Est-Ouest (comme sur la figure 3) résumant vos réponses aux questions
1 à 5.
B\ Zoom sur la mer Ligure
Le processus expliquant l'ouverture de la mer tyrrhénienne est le même qui a permis la formation du plancher océanique de la
mer Ligure entre les îles Corse-Sardaigne et la côte Sud-Est française.
7-a) Comment appelle-t-on une région telle que celle étudiée sur la figure 10 ?
7-b) Notez sur la figure 10 les grandes zones identifiables et réalisez une coupe schématique selon le trait pointillé noir en
notant à nouveau la position de ces zones.
7-c) Que représentent les structures bathymétriques telles que celle entourée sur la figure 10 ?
On cherche à déterminer l'âge de formation de la mer Ligure. On dispose pour cela d'un profil de sismique réflexion (figure 9)
dans la région Nord-Est du bassin (cf figure 8).
8-a) Notez sur la figure 9 :
– en rouge la position de la faille, ainsi que son jeu
– en bleu les sédiments ante-rift
– en jaune les sédiments syn-rift
– en vert les sédiments post-rift
8-b) Donnez le nom de la structure identifiée à la question 8-a.
8-c) Concluez concernant l'histoire de l'ouverture de la mer Ligure dans sa partie Nord-Est.
L'ouverture de la mer Ligure s'est faite « en éventail » avec des vitesses d'accrétion plus élevées au Sud-Ouest qu'au Nord-Est.
Il n'y a pas de dorsale bien nette, mais le magmatisme est du même type que celui connu dans les océans plus classiques.
9-a) Donnez la vitesse moyenne maximale d'expansion de la mer Ligure, sachant que la distance entre Argelès-sur-mer (au
pied des Pyrénées) et Sassari (en Sardaigne) est de 500 km (cf figure 1), et que l'ouverture océanique dans cette partie du
bassin date d'il y a 20 Ma. Cette vitesse vous paraît-elle faible ou élevée ?
9-b) D'après vos connaissances concernant le fonctionnement des dorsales rapides et lentes, que pouvez-vous proposer comme
type de structure de la croûte océanique au niveau du bassin Ligure ?
Dans la question suivante, on s'intéresse à la profondeur du plancher océanique dans le bassin Ligure.
10-a) Commentez la figure 11 donnant la profondeur du MOHO dans la région du bassin Ligure. Quelle est la profondeur
minimale mesurée ?
10-b) En utilisant la profondeur minimale de la question 10-a, déterminez – schéma à l'appui – la profondeur du plancher
océanique à cet endroit de la mer Ligure.
– la colonne de référence sera prise au niveau de la côte, pour une altitude zéro
– le manteau sera vu comme un seul bloc (pas de différence entre MSL et MSA)
– la profondeur du MOHO sur la figure 11 est la profondeur – par rapport à l'altitude zéro – de la base de la croûte.
Données :
deau = 1
dCContinentale = 2,8
dCOcéanique = 3
dManteau = 3,3
10-c) Le fond océanique, par sonar, a été évalué à 6,5 km de profondeur. Commentez le résultat obtenu à la question 10-b et
proposez une ou plusieurs explication(s) concernant les différences obtenues entre le calcul et la réalité.
C\ Sédimentation en mer Méditerranée
La figure 12 présente un profil de sismique réflexion dans le golfe du Lion.

D’après Agnès Emond-Després, Lycée Sainte Geneviève, Versailles 3 / 12
11-a) Identifiez les 2 grands types de corps sédimentaires visibles sur ce profil, en décrivant la géométrie des réflecteurs
propre à chacun.
11-b) En estimant que l'apport sédimentaire provenant de la côte était constant, quelles sont les variations du niveau marin
déductibles de ces géométries ?
En 1971, une campagne de sondages profonds dans la Méditerranée a permis de mettre en évidence la présence, sous les
sédiments actuels, d'une épaisse couche d’évaporites composées de halite (NaCl) et d’anhydrite (CaSO4).
Ces évaporites, dont l’âge est compris entre 6 et 5 Ma, sont localement épaisses de 3 km. Une flore fossile de Cyanophycées
indique que ces sels ont précipité en milieu peu profond.
La Méditerranée s’est donc asséchée entre 6 et 5 Ma : c’est la crise "messinienne", du nom du détroit séparant l’Italie de la
Sicile. Dans ce détroit, les évaporites, remontées sous l’action de la tectonique, sont visibles au-dessus du niveau marin actuel.
Ces mouvements tectoniques résultent de la lente remontée de la plaque lithosphérique africaine qui, entre 6 et 5 Ma, ferme
sporadiquement le détroit de Gibraltar.
12-a) Déterminez le volume total d'évaporites qu’engendrerait l’évaporation instantanée de la Méditerranée actuelle.
Données :
Volume actuel de la Méditerranée Vmed = 4.1018 L
Salinité = 37,5 g.L-1
Masse volumique des évaporites ≈ 2.103 g.L–1
12-b) Justifier que l'épaisseur de la couche d'évaporites déposée serait alors de 30 m.
Données :
Surface de la Méditerranée SMed = 2,5.1012 m2
12-c) La quantité d’évaporites rencontrée par les sondages de 1971 est équivalente à une couche de 250 m répartie sur toute
la surface de la Méditerranée. Comment expliquer alors une telle épaisseur ?
D\ Dynamique atmosphérique en Méditerranée occidentale
Le Sud-Est de la France est régulièrement soumis à des épisodes de fortes précipitations automnales, nommés « épisodes
cévenols » ou « méditerranéens ». Dans cette partie, on cherche l'origine de ces épisodes orageux extrêmes.
Durant les mois de septembre à novembre 2014, une dizaine d'épisodes de fortes pluies se sont succédés dans la région de
Montpellier et de Nîmes. Dans les zones les plus touchées, plus de 800 mm de pluie sont tombées durant cette période,
aboutissant à la crue de nombreux cours d'eau et à des inondations historiques (figure 13).
La figure 14 donne un exemple de situation météorologique telle que celle pouvant aboutir à des épisodes orageux intenses.
13-a) Notez sur la figure 14 les centres de haute et basse pression atmosphérique en surface.
13-b) Si la Terre n'était pas en rotation, quel serait le trajet horizontal des masses d'air dans la situation de la figure 14 ? (ne
les dessinez pas)
13-c) Du fait de la rotation terrestre, les masses d'air en mouvement sont déviées vers leur droite dans l'hémisphère Nord.
Dessinez alors sur la figure 14 les mouvements des masses d'air autour du centre anticyclonique situé dans l'Atlantique et
autour du centre dépressionnaire situé sur l'Espagne.
13-d) Quelle est alors la direction des vents au niveau de la côte méditerranéenne française dans cette situation ?
On admet pour la suite que cette direction des vents n'est modifiée par aucun autre paramètre. La figure 15 donne les valeurs
de la température de surface le 8 septembre 2005.
14-a) Quels sont les échanges ayant lieu entre l'eau et les masses d'air lorsque celles-ci circulent au-dessus de la mer
Méditerranée ?
14-b) Quels sont alors les caractéristiques (T°, humidité) des masses d'air arrivant sur les côtes françaises ?
Au Nord des régions touchées par les épisodes méditerranéens se trouvent la chaîne alpine et le Massif Central, reliefs
imposants.
15) Utilisez la carte de la figure 15 ainsi que la remarque précédente pour expliquer la forte pluviométrie lors des épisodes
cévenols.
En réalité, les précipitations sont intensifiées par la rencontre entre les masses d'air de surface vues précédemment et des
masses d'air particulièrement froides, situées en altitude.
16) En quoi la présence d'air froid en altitude peut-elle accentuer les précipitations ?
17) Résumez vos observations sous forme d'un schéma-bilan.

D’après Agnès Emond-Després, Lycée Sainte Geneviève, Versailles 4 / 12
ANNEXE : DOCUMENTS DU SUJET
Figure 1 : topographie et bathymétrie en Méditerranée occidentale (source : Geomap)
Le nom des mers est donné, de même que quelques localités et les chaînes de montagne (en italique)
L'encadré localise la carte de la figure 10.
Figure 2 : Carte de répartition des séismes en Europe de l’Ouest et en Méditerranée occidentale
(magnitude comprise entre 3 et 7, séismes enregistrés entre 1964 et 2009)

D’après Agnès Emond-Després, Lycée Sainte Geneviève, Versailles 5 / 12
Trait rouge : position des frontières de plaques. La couleur des séismes donne leur profondeur.
Figure 3 : Carte (en haut) et coupe (en bas) de tomographie sismique en Méditerranée occidentale
Figure 4 : Caractéristiques du séisme du 29 août 2015 au Nord de la Sicile
Magnitude 4,3 ; profondeur 8 km
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%