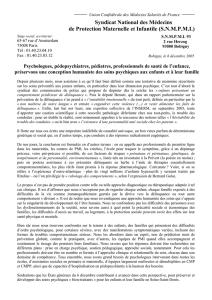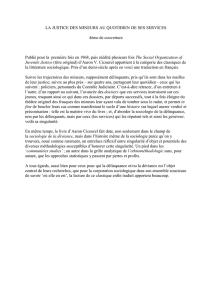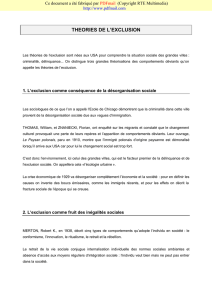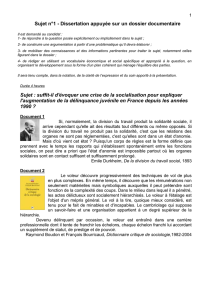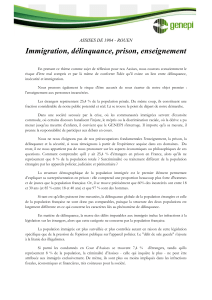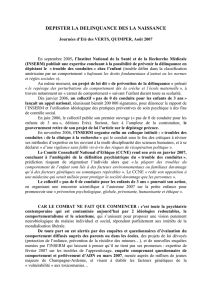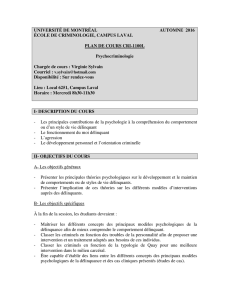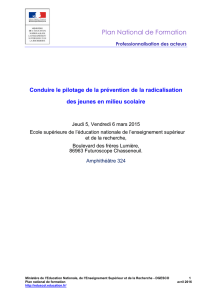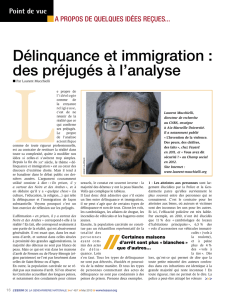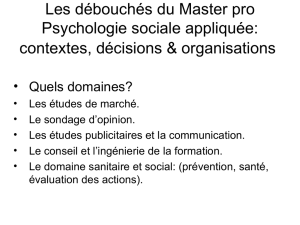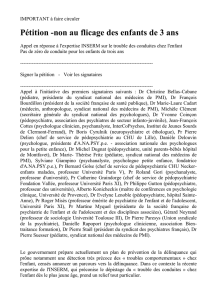2. La construction de l`objet

Rémi Labed Séance 2 : La construction de l’objet
Jean Claude Chamboredon,
« La délinquance juvénile, essai de construction d’objet »
Revue Française de sociologie, 1971.
J-C. Chamboredon : Proche collaborateur de P. Bourdieu (Le Métier de sociologue, 1967) de
qui il s’éloigne en 1981. A travaillé avec Robert Castel. Enseignant à l’ENS, membre du centre de
Sociologie Européenne.
Revue française de sociologie : revue trimestrielle fondée en 1970 par Jean Stoetzel
(normalien, chercheur à l’INED, fondateur de l’IFOP dont il démissionne en 1979, première chaire
de sociologie à la Sorbonne pendant 23 ans).
THESE : La délinquance juvénile est un objet pré-construit, dont l’unité
substantive ne reflète pas nécessairement une unité de substance. L’analyse
de construction sociale de cet objet est un préalable nécessaire son étude
sociologique.
Rompre avec l’étiologie commune
Nécessité de comparer le comparable
Rapporter les stats des jeunes délinquants aux stats des jeunes de la même commune,
pas à celles de tous les jeunes.
Rompre avec l’analyse fonctionnaliste traditionnelle
Fondée sur l’image du choix moral rationnel, déterminé par les chances de réussite dans
les voies légitimes et le degré d’intériorisation des buts légitimes.
Une seule délinquance ?
C- : surreprésentés dans la population délinquante, + %vols, + d’actes collectifs, âge + étalé,
délinquance endémique, conséquence des conditions de vie et de loisirs + que d’une crise
d’éducation.
C moy. et + : délinquance anomique concentrée sur l’âge de la « crise d’adolescence ».
L’anomie familiale, cause première ?
Chiffres de l’anomie familiale pas supérieurs chez les délinquants d’une classe sociale par
rapport à la population de la même commune.
C- : Part de récidivistes et de précoces + grandes parmi les sujets issus de ménages
ordinaires.
Rôle privilégié de la désunion familiale observable seulement chez les Cmoy.
Anomie familiale est une caractéristique générale des C-, surreprésentés dans la
population délinquante, pas un facteur explicatif de la délinquance juvénile.
Rompre avec l’hypothèse implicite d’une socialisation uniforme.
≠ des formes de socialisation explique la précocité des jeunes des classes populaires.
Définition ≠ des âges car différences dans l’éducation (plus de régulation et de contrôle
des conduites dans les C+), les cursus scolaires, l’âge d’entrée au travail.

La construction de la délinquance : un processus de sélection
Influence du contexte et de la composition de la population
Les taux de délinquance culminent dans les zones où l’hétérogénéité sociale est la plus
forte. Grand ensemble vs. Reste de la commune. Le groupe en position dominante peut imposer
ses normes comme référence commune.
Rôle et importance de l’éthos de classe
Tous les comportements contraires à la loi ne sont pas signalés (tolérance de certaines
classes, habitudes de police). Un comportement doit susciter le scandale pour que la police
intervienne (réaction du sous-groupe nécessaire).
La police recueille un jugement collectif, occasion d’une confrontation des morales de classe.
Chaque classe définit les limites du licite et de l’illicite (ex : bagarre nécessaire ou coups
et blessures ?).
Préjugés renforcent l’attention sur des groupes particuliers + de chance que leurs
délits soit reportés. Rapports entre les classes influe sur le choix du mode de résolution des
conflits (processus informel ou recours aux institutions spécialisées).
Les C+ disposent de + de cercles de socialisation préalables, médiations avant l’entrée dans
le domaine public. Ce n’est pas le cas des C-.
Rôle des agents et des institutions de détection et de traitement de la délinquance.
Police occupe une place importante : intervient en 1ère, décide de donner suite juridique
ou non. Elle retient des comportements isolés et abstraits de leur signification à l’intérieur
du groupe de référence, les rendant disponibles pour une autre interprétation (cf.
terminologie policière). + Construction d’un jugement total sur le délinquant, faisant intervenir
des jugements moraux liés à l’éthos de classe.
L’enquête définit un « caractère psychologique » du délinquant plutôt que des
comportements (influence de la vulgate psychologique, surinterprétation moralisante).
Récriture de l’histoire personnelle comme menant inéluctablement à l’acte
délictueux.
L’interprétation substantialiste répond à une nécessité sociale. La caractérisation de la
délinquance comme naturelle et dotée d’essence permet à la société de justifier ses lois comme
nécessaires et naturelles.
Le traitement de la délinquance est un effort d’inculquer ou d’imposer la vision dite
objective de l’institution sur l’acte considéré comme délictueux. Les institutions imposent aux
délinquants une image d’eux-mêmes qui, en raison de leur âge, a de fortes chances de les marquer
profondément.
Disparités selon les classes sociales et leurs capitaux culturel, juridique et économique
quant à la possibilité de refuser ou relativiser la vision de l’institution.
1
/
2
100%