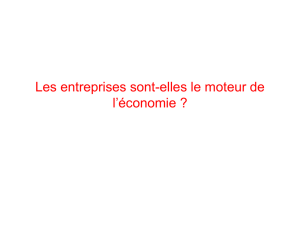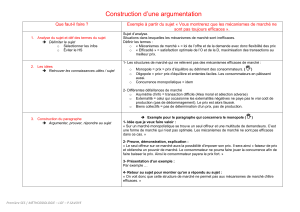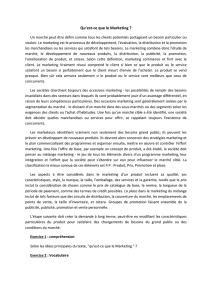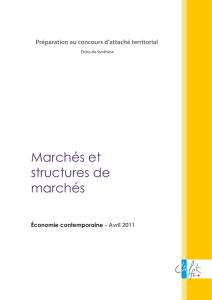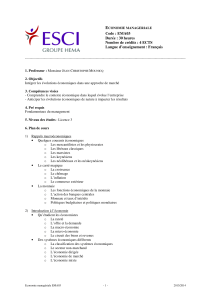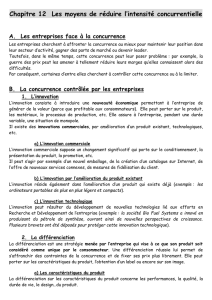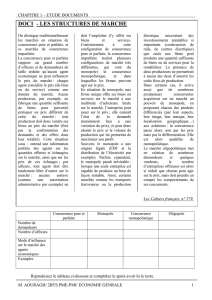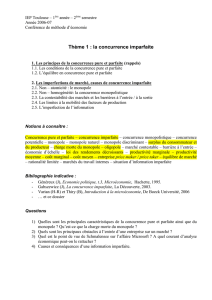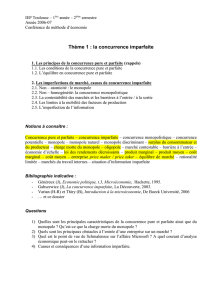1 POLITIQUE ET STRATEGIE D`ENTREPRISE Chapitre 1

1
POLITIQUE ET STRATEGIE D’ENTREPRISE
Chapitre 1 : « Concept Et Définition »
Section 1 : « Notion d’Entreprise »
Selon la comptabilité Nationale, l’entreprise est un centre autonome de profit soumis à l’impôt
sur la société.
Pour un juriste, l’entreprise est une personne morale autonome et qui a un statut (des règles qui
la régissent), et organisant des procédures pour régler les conflits.
Pour un sociologue, l’entreprise est comme une organisation hiérarchisé, c’est un lieu d’intérêt,
de confrontation et de duel. C’est aussi un ensemble de procédure de négociation et d’arbitrage. Elle
est définit aussi comme un ensemble de valeurs partagé par un groupement de personne.
Pour un gestionnaire, l’entreprise est un ensemble de fonctions à coordonner et à ordonner afin
de réaliser un profit.
D’après ces trois approche, le mot entreprise à une définition diverse et multiple parce que
l’entreprise est une entité juridique autonome capable de ce faite de conclure par un contrat avec les
partenaires.
L’entreprise est ainsi une entité administrative reconnue et indispensable qui est géré par les
dirigeants identifiés. Et enfin, l’entreprise est une entité qui rassemble les ressources physiques et
financiers mais aussi un ensemble de savoir faire indispensable à son activité.
Il fut en tête l’entreprise comme élément fondateur la recherche de profit. On peut qualifier ces
approches du mot disciplinaire, par opposition aux approches qui sont pluri-disciplinaire.
I. L’approche néoclassique (approche pluridisciplinaire) :
Une firme ou une entreprise transforme les input (entrant) en output (sortant), et cela selon une
technologie donné dans le cadre d’un environnement donné. Ces règles fixées intervient à un
comportement de maximisation qui détermine les quantités de facteur qui peuvent être utilisé pour
produire une quantité de produit afin de mener l’entreprise à faire des profits.
L’entreprise devient un point algébrique d’exploitation de la technologie qui permet de
transformer les input en output ayant une valeur sur le marché.
Finalement, l’entreprise ne fait que s’adopter de manière mécanique à un environnement à la
cléf, c’est la maximisation de profit.
C’est la fonction technique de production qui est considéré comme essentiel, et le comportement
économique de l’entreprise découle logiquement des fondements technologiques de son existence.
Pour l’entreprise néo-classique c’est une adaptation aveugle à un environnement connu.

2
Pour les néo-classiques, l’entreprise est une organisation économique de forme juridique
déterminé réunissant des moyens humains matériels, immatériels et financiers pour produire des
biens et services destiné à être vendus sur un marché pour réaliser un profit.
Pour les néo-classiques, l’entreprise se distingue par trois caractéristiques :
L’objectif et les moyens qu'elle met en œuvre pour réaliser ses objectifs et la recherche de profit.
Mais disant que limiter l’entreprise par une simple expression économique c’est faire l’impasse sur
un certain nombre d’aspect qui rend complexe la définition même de l’entreprise, car l’entreprise est
aussi une entité autonome et qui modifie son environnement, et enfin l’entreprise est une
organisation social qui rassemble des hommes et des femmes autour de valeur commune et
d’objectif définie par les dirigeant de l’entreprise.
En plus, l’entreprise est un système complexe car il s’agit d’un système ouvert. L’entreprise est
constamment en relation avec un nombre important de partenaires vers lesquels elle échange des
biens et services, mais également des informations et des compétences. Donc on a l’idée que
l’entreprise est une interaction perpétuelle par l’environnement sans aller à lui donner un caractère
humain. L’entreprise entant qu’entité autonome doit être analysée dans toute sa diversité.
II. L’approche néo-institusionnelle (théorie des coûts de transaction) :
Cette approche représentée par Oliver Williamson a pour but d’expliquer comment se forme les
institutions économiques capitalistes. Deux hypothèses à cette approche :
Hypothèse 1 :
Principe de nationalité limité.
L’incomplétude des contrats est inévitable.
L’exécution du contrat prend une grande importance et le degré d’adaptabilité d’une
firme est un aléas dans l’exécution du contrat.
Hypothèse 2 : Le comportement opportuniste des économistes, c’est-à-dire la recherche d’un
intérêt personnel en recourant à la ruse et aux différents formes de triches.
A l’origine de la théorie des coûts de transaction, on trouve un article célèbre de 1938 de Renald
Coause, sur la nature de la firme. Pourquoi dans une économie de Marché au sein de laquelle les prix
sont sensés d’assurer la coordination de l’activité économique caractérisée par la suppression des
mécanismes des prix.
Pour cause, le Marché et la firme sont des formes alternatives de coordination et de la
production. La raison pour laquelle il est avantageux de situer une entreprise est l’existence de
l’économie des coûts de transaction. Selon lui, l’entreprise se caractérise par des coûts de production
mais également des coûts de transaction.
Les coûts de transaction ont pour cause deux choses :
En l’absence des coûts de transaction, la négociation entre les agents économiques conduit
à une location efficiente qui nous permet d’atteindre un efficient optimum sociale.
En la présente des coûts de transaction, la location des ressources est moins optimale.

3
III. L’approche managériale de l’entreprise :
Cette approche reflète les évolutions du système capitaliste dans lequel nombreux entreprises se
trouvent confrontées à une distinction entre d’une part la propriété d’une entreprise détenue par les
actionnaires et d’autres part la gestion d’une entreprise qui est dévoué au manager. En
conséquence, les actions de l’entreprise sont analysées comme étant le fruit ou les conséquences
d’une coalision de groupe d’agent économique n’ayant pas nécessairement les mêmes objectifs.
D’une part, on a les actionnaires qui recherche les profits et les managers qui ont un motif
différent qui est l’obtention d’une rémunération importante et égale à un pouvoir plus accru.
Donc l’approche managériale de l’entreprise définie celle-ci comme un lieu de confrontation entre
ces deux groupes à savoir le manager et le gestionnaire.
IV. L’approche comportementale (théorie de comportement) :
C’est une approche qui insiste encore plus sur l’aspect humain de l’entreprise en élargissant la
notion de coordination d’intérêt à l’ensemble des groupes présents dans l’entreprise. En plus, les
groupes des actionnaires et celui des ménages. Les théoriciens du comportements identifient le
nouveau groupe qui vont agir sur les décisions de l’entreprise : il s’agit des salariés, des fournisseurs,
des bailleurs de fonds (banque) et les actionnaires.
Le comportement de différents groupes sera analysé selon les critères de la motivation :
motivation personnelle et motivation professionnelle. C’est la possibilité d’accroître son pouvoir et
d’obtenir une promotion au sein de l’entreprise.
En conséquence, le comportement de la firme ne peut plus être focalisé sur la recherche du profit
maximal, mais répond à des objectifs multiples résultats d’un comportement globale de satisfaction
et des acteurs qui participe à la vie d’entreprise. De plus en plus, l’entreprise ne ressemble plus à cet
espace formel structuré autour d’un objectif majeur (maximisation du profit) mais cette entreprise
est représenté par une structure plus informelle dont la stratégie dépend des objectifs poursuivis par
les différents membres qui la compose.
V. L’approche systèmatique de l’entreprise :
Malgré leurs différences, toutes les entreprises peuvent être représentées selon le principe d’un
système, et cela à travers quatre notions :
Notion d’interaction : c’est-à-dire les éléments du système interagissent les uns envers les
autres.
Notion de globalité : c’est-à-dire l’ensemble contre l’ensemble des parties qui le compose.
Notion d’organisation qui définie l’état du système : c’est-à-dire son organigramme et son
processus de fonctionnement c’est-à-dire son organisation.
Notion de complexité : c’est-à-dire le système est à la fois compliqué et incertain.
L’entreprise comme étant un système est :
1) Concrête : elle constitue un ensemble d’élément concret (machine, …) et aussi d’élément
abstret (image de marque, valeur, …).

4
2) Une structure organisée : c’est-à-dire doté d’une structure de fonctionnement
permettant d’assurer la coordination des éléments du système.
3) Ouvert.
4) Finalisé : ayant un objectif qui nécessite la mise en place d’une stratégie.
5) Dynamique : c’est-à-dire en constante évolution du faite de la modification de son
environnement.
6) Régulé : de manière à essayer d’atteindre constamment ses objectifs grâce à la prise de
décision.
Donc, l’entreprise est un système organisé, concré, ouvert, finalisé, dynamique et régulé. Cette
approche de l’entreprise permet de mieux comprendre l’organisation interne de l’entreprise pour
ainsi mieux représenter les systèmes ou les sous-systèmes de l’organisation dans l’organigramme de
l’entreprise.
VI. Approche de Porter (intensité concurrentielle) :
L’identification des forces qui agissent sur la position concurrentielle d’une entreprise permet de
mesurer l’intensité concurrentielle du marché dans lequel l’entreprise intervient. Dans la définition
de l’intensité concurrentielle, Porter identifie cinq facteurs :
Figure 1 « Approche de Porter : Intensité concurrentielle »
Pouvoir des fournisseurs : plus de founisseurs, plus de liberté.
Pouvoir des clients : moins de clients, plus de clarté.
Existance de produits de substitution : l’entrée de nouveaux concurrents.
Degré de concurrence du marché : menaces d’entrants potentiels.
Barrières à l’entrée : système capitalisé, barrière législative, …

5
Section 2 : « Notion de Marché »
Le marché est un lieu de rencontre des offreurs de biens et services avec des demandeurs de
biens et services.
Le phénomène de rencontre des offreurs et des demandeurs de biens et services peut s’avérer
plus complexe à expliquer ou à décrir, lorsque le nombre de partenaire que l’on veut considérer est
quelconque. C’est ce que nous allons voir dans la plupart des marchés. Par exemple : marché de
monopole, oligopole, …
Mais avant tous, il y a une notion importante à définir et à comprendre c’est la notion de
l’équilibre sur le marché liée à la loi de l’offre et de la demande. De plus, cette notion doit s’étudier
en considérant les différentes structures du marché.
Paragraphe 1 : « Marché : Définition Et Concepts »
Le marché d’un bien (produit) comme un service ou un facteur est la rencontre d’une ensemble
d’offre et de demande de ce bien donnant lieu à un échange sur la base d’un prix.
Pour avoir un échange, il faut deux agents économiques qui doivent se mettre d’accord sur les
quantités échangées et sur les prix pratiqués. Par conséquent, tous marchés est donc nécessairement
le lieu d’un comportement collectif de divers agent économique à l’égard d’un bien.
D’un point de vue pratique, il s’agit de répondre à deux questions concernant des variables : les
quantités échangées et les prix pratiqués.
o Comment expliquer le niveau de quantité et le prix pratiqué ?
o Qui choisit ces prix et ses quantités ?
Les éléments résultant de ces phénomènes d’échange font le fruit de la loi de l’offre et de la
demande.
La loi de l’offre er de la demande est le mécanisme par lequel le prix et la quantité échangée d’un
bien sont déterminés sur ce même marché, lorsque seul intervient les offreurs et les demandeurs.
Tout cela sous l’hypothèse que chaque agent choisit librement la quantité qui veut vendre ou acheter
et aucun agent n’est forcé à acheter ou à vendre plus qu’il ne désire. C’est ce qu’on appelle « Le
Principe de Liberté et d’Initiative ».
Dans le cas des prix, on a quatre possibilités :
1) Quand les offreurs sont pricemakers et les demandeurs sont pricetakers.
2) Quand les offreurs sont pricetakers et les demandeurs sont pricemakers (marché
d’épargne).
3) Prix résultant de la négociation.
4) Les prix sont déterminés à l’extérieur des marchés, c’est-à-dire ni par les offreurs, ni par les
demandeurs (par l’Etat : prix d’eau et d’élèctricité).
Quelles sont les caractéristiques qui déterminent la structure du marché ?
Il existe quatre caractéristiques :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%