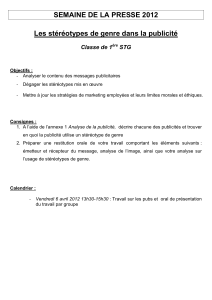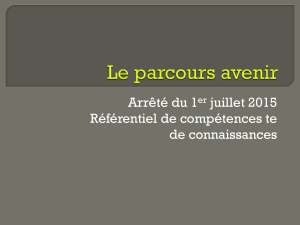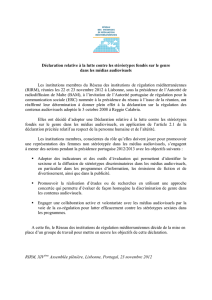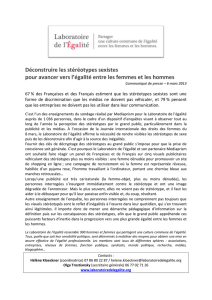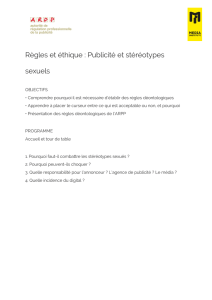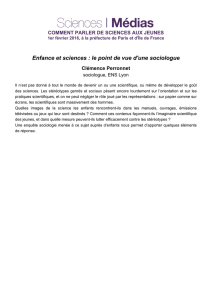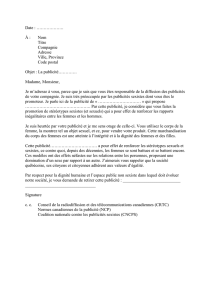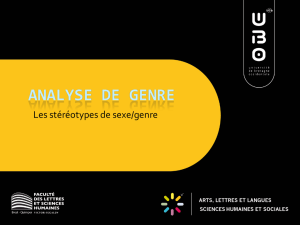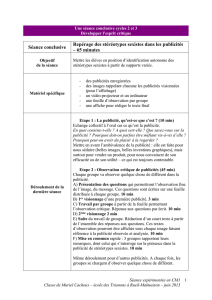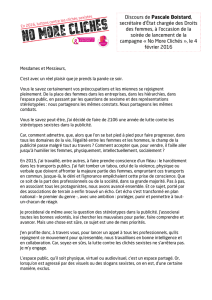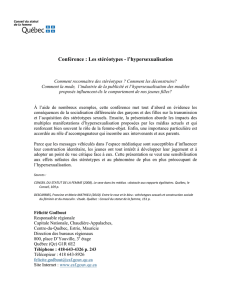Première partie: Mise en Contexte

2013
Vers la mise en œuvre de la «Déclaration de Lisbonne en faveur de la
promotion de l’égalité homme-femme et de la lutte contre les stéréotypes
fondés sur le sexe»

2
Version finalisée le 1 Juillet 2014
RESEAU DES INSTANCES DE REGULATION MEMBRES
Vers la mise en œuvre de la «Déclaration du RIRM en faveur de la
promotion de l’égalité homme-femme et de la lutte contre les stéréotypes
fondés sur le sexe» du 23 novembre 2012
--------------
Plateforme
Coordonnée par le CAA, Andalousie et la HACA, Maroc
20 OCTOBRE 2013
présentée à la 15ème Assemblée plénière du Réseau des institutions de régulation méditerranéeennes
Limassol, Chypre

3
Version finalisée le 1 Juillet 2014
Sommaire:
Première partie: Mise en contexte
I. Problématique et rôle du régulateur
II. Les atouts du RIRM
III. Historique du processus
IV. Résumé de l’enquête sur la régulation face aux stéréotypes sexistes dans les
medias AV, en Méditerranée.
V. Vers un plan d’action: Concepts et cadre normatif
Deuxième partie: Indicateurs et procédures d'évaluation de stéréotypes de genre dans
les contenus diffusés par les services de communication audiovisuelle.
I. Introduction
II. Démarches et actions de régulation, d’autorégulation et de co-régulation
III. Programme d’information
IV. Prévention et élimination de la violence à l’égard des femmes
V. Communications commerciales
VI. Programmes de divertissement
Troisième partie: recommandations
En direction des instances de régulation
En direction du RIRM

4
Version finalisée le 1 Juillet 2014
Première partie: Mise en Contexte
I. Problématique et rôle du régulateur
Les médias jouent un rôle de premier plan dans la socialisation des individus. Cette vérité n’est
plus à démontrer. Elle a nourri depuis des décennies toute une branche de la sociologie dédiée
à la question. L’idée selon laquelle les médias influencent les perceptions du masculin et du
féminin et la manière dont leurs identités sont construites a aussi fait son chemin». Il semble
aujourd'hui admis que les médias, audiovisuels en particulier, en promouvant une présentation
presque exclusive de schémas de soumission/domination, contribuent à là consécration d’une
vision stéréotypée et réductrice des rôles des femmes et à la reproduction d’attitudes et de
comportements discriminatoires à leur égard. Les sociologues soulignent toutefois que cette
influence ne se fait pas selon « un mode explicite », qu’il s’agit plutôt « d’une violence invisible
qui s’exerce par les voies purement symboliques de la communication et de la connaissance » et
qui s’infiltre « insidieusement dans les discours, (…) dans les films, les programmes de télévision
ou la publicité».
1
Les stéréotypes finissent ainsi par s’imprimer « inconsciemment dans les
esprits», renforçant les résistances mentales aux évolutions des statuts et vécus des femmes de
par le monde.
Cet état de chose a interpelé les militants de droits humains. Car si les médias de masse et les
médias audiovisuels en particulier, constituent, « après le droit, la morale et la politique, la
dernière frontière de l’inégalité »,
2
l’impact qu’ils peuvent avoir sur les récepteurs est à double
sens, ils peuvent consacrer les inégalités, ils peuvent tout aussi bien les combattre. Les mobiliser
pour consolider, à travers leur pouvoir didactique et leur impact de masse, les droits individuels
et collectifs est d’ailleurs le fondement de base du mandat de service public des diffuseurs
audiovisuels.
Les législations nationales et les recommandations internationales sont venues confirmer ce
postulat et légitimer le principe selon lequel les médias audiovisuels ont un rôle à jouer pour
conforter une culture de droit et d’égalité. En tant que gardiennes du temple, les autorités de
régulation ont, également, de ce fait, une responsabilité dans la mise en œuvre effective de ces
dispositions. La problématique de l’égalité hommes-femmes les interpelle ainsi au rang des
obligations issues de la garantie de la liberté d'expression et des principes généraux relatifs au
respect de la dignité humaine et à la lutte contre toutes les formes de discrimination ou
violence. Les autorités de régulation du pourtour méditerranéen disposent pour ce faire d’une
une large palette de missions partagées et d’un espace de concertation et d’action communes :
le Réseau des institutions de régulation méditerranéennes (RIRM).
1
Pierre Bourdieu, La domination masculine.
2
Rapport sur l’image des femmes dans les medias, Michèle REISER, Brigitte GRESY, sep.2008, p :7.

5
Version finalisée le 1 Juillet 2014
Si les instances de régulations méditerranéennes
3
disposent d’un socle de valeurs partagées qui
leur permet d’agir de concert et de manière homogène à travers le réseau,
4
quelles actions
peuvent-elles mener en faveur de l’égalité, en vertu de leurs postures institutionnelles et de
leurs mandats? Afin de répondre à cette question, le présent document passe en revue, les
atouts du réseau, le processus tel qu’engagé jusqu’à présent, le cadre de référence conceptuel
et juridique et enfin les outils de travail développés pour la mise en oeuvre de la déclaration en
faveur de la promotion de l’égalité homme-femme et de la lutte contre les stéréotypes fondés
sur le sexe, adoptée à Lisbonne le 23 novembre 2012.
II. Les atouts du RIRM
Le RIRM est en priorité un cadre de réflexion pour développer un référentiel de base sur
différentes thématiques, de manière à consolider une approche régulatrice intégrée du paysage
audiovisuel méditerranéen. Les enjeux qui interpellent les régulateurs, de manière individuelle
ou collective, sont multiples et évolutifs. Ils suivent les mutations du secteur audiovisuel lui-
même et les bouleversements que l’avènement du tout-numérique ne cessent d’engendrer :
effacement des frontières, mondialisation des marchés, éclatement de l’audience, prolifération
des services, uniformisation des contenus… Ils sont également dictés par les effets conjugués
de la mondialisation et de la crise sur le secteur audiovisuel en particulier et qui vont des
exigences de garantir pour les citoyens des deux rives le droit d’accès au divertissement, à
l’expression culturelle propre, collective et universelle et à une interprétation crédible et
factuelle du monde dans lequel nous vivons à un niveaux local, national et mondial, dans le
respect des exigences de libre concurrence et de compétitivité.
Les instances de régulations sont toutes soucieuses de promouvoir la diversité et le pluralisme
dans la communication et les contenus audiovisuels et d’y mettre en pratique le référentiel
universel des droits de l’Homme. La consolidation de l’éthique et de la déontologie et la
promotion des droits qui sont le fondement des missions de régulation y sont ainsi appréhendés
de par les questions qu’elles soulèvent et à la lumière des contextes individuels et des
expériences éprouvées dans la mesure où celles-ci, sont, sans préjudice pour les référents
nationaux et culturels de base, et facilement transposables d’un contexte à un autre.
Leurs principaux atouts sont:
1. Leur positionnement institutionnel (autonomie).
2. Leurs pouvoirs (puisés dans leurs propres fondements constitutifs et les constitutions
nationales autant que dans la charte du RIRM
5
), qui leur donnent la possibilité, dans leurs
domaines de compétences respectifs de :
3
http://www.rirm.org/fr/instance-liste
4
http://www.rirm.org/fr/presentation-rirm
5
http://www.rirm.org/medias/_documents/fr/144.1.Charte%20du%20RIRM_FR_novembre%202012.pdf
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%