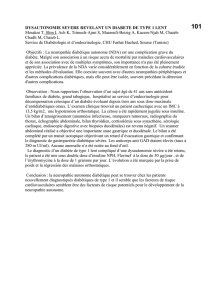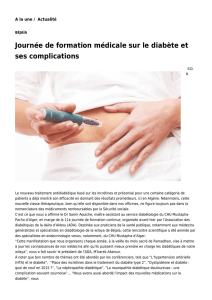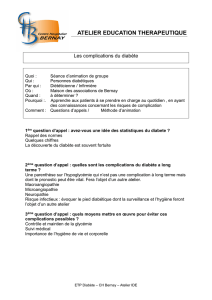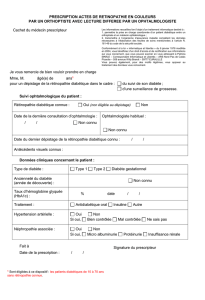Tube digestif et diabète

GASTROENTÉROLOGIE
ET COLOPROCTOLOGIE
99
POST’U(2016)
Tube digestif et diabète
;Philippe Ducrotte1,Chloé Melchior1,2
(u)Hôpital Charles Nicolle, 1, rue Germont,76031 Rouen Cedex
1. Service d’Hépato-Gastroentérologie/ADEN InsermUMR1703
2. Service de Physiologie DigestiveetUrinaire/ADEN InsermUMR1703
E-mail :philippe.ducrotte@chu-rouen.fr
Objectifspédagogiques
–Connaîtrelesdifférentespathologies
digestivesassociées au diabète
–Connaître lesmécanismes provo-
quantles troubles moteurs
–Connaître la prise en charge de la
gastroparésie diabétique
Résumé
L’incidence du diabète augmente en
Francecommedanslerestedu monde.
Les complicationsdigestivesdela
maladie,principalementliéesàlaneu-
ropathie secondaire àlamicro-angio-
pathie, altèrentconsidérablementla
qualité de vie du diabétiqueetparti-
cipentaudéséquilibre glycémique.
Elles peuvent toucher l’ensembledu
tractus digestif.Leur prévalence est
d’autant plus élevée que le contrôle
glycémique est imparfait. Cependant,
des études de cohorte montrentque
des facteurs indépendants de l’hyper-
glycémie,environnementauxetnutri-
tionnelsinterviennentdanslaphysio-
pathologie de la neuropathie. On
observechezlesdiabétiquesauniveau
de l’œsophage une prévalence accrue
detroublesmoteurs,sourcededyspha-
gie et de reflux.La gastroparésie est la
complication digestive la plus invali-
dante. Avec la diarrhéeetl’inconti-
nencefécale,cettegastroparésiealtère
considérablementlaqualité de vie du
patientetcontribue au mauvais équi-
libredu diabète.Despathologiesauto-
immunes peuvent égalementêtre
associéesaudiabètedetype1etdoivent
êtrerecherchées.Lessymptômesdiges-
tifs sontsouvent intriqués ce qui rend
le diagnostic difficile. Fréquemment
un traitementsymptomatique doit
êtreassocié àlarestauration de l’équi-
libreglycémiquepour améliorer la
symptomatologie et éviter que l’at-
teinte digestive soitpar elle-même
source de déséquilibre du diabète.
Introduction
Le diabète,qu’il soitdetype 1ou 2,est
unemaladiedeplusenpluspréva-
lente. En France, la population diabé-
tiqueestchiffréeactuellementà3mil-
lions d’individus. Avec 400 nouveaux
casdiagnostiquéschaquejour,ellesera
voisine de 5millions àl’horizon 2022.
Lediabètepeutaffecterletubedigestif
àtous lesniveaux [1]. Cette gastro-
entéropathie diabétique peutconcer-
ner jusqu’à 75 %des patients dans
certaines séries. Certaines manifesta-
tions, tellequ’une gastroparésie, vont
affecterl’histoirenaturelledelamala-
die diabétique en compromettant
l’équilibre du diabèteavecunimpact
sur la mortalité et la morbidité de la
maladiediabétique. D’autres, comme
lestroubles du transit, altérent avant
toutlaqualité de vie des malades.
Toutes ces manifestations sontàl’ori-
ginededépensesdesanté notablesen
raison deshospitalisations trèsfré-
quentes qu’elles provoquent.
Les conséquences du diabète sur le
tubedigestifetl’augmentationd’inci-
dence de la maladie vont amener les
hépato-gastroentérologues àêtre de
plus en plus confrontés auxconsé-
quences digestivesdelamaladie
diabétique.
Nous n’aborderons pas dans ce cha-
pitre deux aspects particuliers:a) les
modificationsdu microbioteintestinal
quipeuvent conduireàl’apparition
d’un diabète de type 2,b)leproblème
général de l’apportdelachirurgie
bariatrique et de ses conséquences
fonctionnelleslorsqu’elleestproposée
comme traitementdefondd’un
diabète de type 2.
Quelle estla
physiopathologie
de l’atteinte digestive
au coursdudiabète ?
Elleest multifactorielle.

100
L’atteinte nerveuse [26]
Elleconcerne àlafois le réseauneuro-
nalentérique (SNE), riche réseauneu-
ronal organisé sous la formededeux
plexus(myentériqueetsous-muqueux)
etcomportantdesneuronessensoriels
et moteurs ainsi que des interneu-
rones, et le système nerveux extrin-
sèque. Dans lesconditions normales,
l’échange d’informations sensitiveset
motricesentreleSNEetlesystèmener-
veux central via le système nerveux
extrinsèqueconditionnelefonctionne-
mentnormal du tube digestif, notam-
ment lors de la prise alimentaire. Au
cours de la maladie diabétique, ces
2systèmes peuvent être touchés et la
perturbation de leur échange d’infor-
mations contribueàlasurvenue de
troubles moteurs et/ou àl’altération
de la sensibilité digestive.
La neuropathie autonome [23]
Elleestlamieuxconnuecarelleaffecte
près d’un malade diabétique sur deux
après20ansd’évolutiondu diabète.Les
lésions concernentles petites fibres
amyéliniquesdes systèmes sympa-
thique et parasympathique, ainsi que
lepneumogastriqueetlesganglionset
lestroncs nerveux sympathiques. Elle
est liée àune microangiopathie. Des
phénomènesinflammatoiresetisché-
miquesmicro-vasculairessecondaires
àdes altérations des vasa vasorum
déterminentl’apparitiondecetteneu-
ropathiequi est entretenue et même
aggravéeparundiabètemaléquilibré.
Sur le plan digestif, la neuropathie
autonomesetraduitavanttoutparune
gastroparésieetdestroublesdu transit,
constipation ou diarrhée. L’atteinte
autonomeprovoqueaussidestroubles
cardio-vasculaires (tachycardie de
repos,incapacitédes’adapteràl’effort,
hypotension orthostatique), des
troubles de l’érection, une mauvaise
adaptationpupillaireàl’obscurité,une
dysurie et une incapacitéàressentir
correctementles symptômes d’une
hypoglycémie.
Cetteneuropathieautonomeestasso-
ciée àune surmortalité avec une mor-
talité à 10 ans de 29 %, contre seule-
ment 6%chez lespatients indemnes.
La mortalité est avanttoutenrapport
avec lestroubles cardio-vasculaires.
L’atteinte du SNE [46]
Elleest de description plus récente.
Les modèles expérimentauxd’ani-
maux,rendusdiabétiquesparinjection
de streptozotocine, révèlent que le
diabète s’associe précocementàune
dégénérescence neuronale àtousles
niveauxdutube digestif. Les pertes
neuronales initiales concernentprin-
cipalementlesneuronesàeffetmoteur
inhibiteur via la libération de subs-
tances,avanttoutlemonoxyded’azote
(NO) mais aussi le VIPouleneuro-
peptide Y. Inversement, lesneurones
excitateurs àacétylcholine ou àsubs-
tance Psontpréservés.Chez l’homme,
des lacunes plus ou moins étendues
dans le maillage neuronal, la perte de
neuronesnitrergiquesetlararéfaction
descellulesdeCajalontétérapportées
chezlesdiabétiquesdetype1et2souf-
frantd’une gastroparésie.Ces anoma-
lies étaient d’autantplusmarquées
que le diabèteétaitsévère. Un stress
oxydatif accru provoquant la produc-
tion de radicaux libres, une inflam-
mation d’origine gliale, la réduction
de certains facteursneurotrophiques
(neurotrophine-3,facteurdecroissance
d’origineinsulinique)sontautantd’élé-
mentscontribuantauxaltérationsneu-
ronales et àune apoptose excessive.
L’atteinte intestinale
proprement dite
L’augmentation de la perméabilité
intestinale [7]
La qualité de la barrièreintestinale,
notammentsaperméabilité,estessen-
tiellepourque l’interaction entrele
milieu luminal et le système immuni-
taire intestinal se fasse de façon opti-
male.Une augmentation de la per-
méabilité intestinale,essentiellement
para-cellulaire, existe dans le diabète
de type 1et 2.Elleest mise en cause
dansl’apparitiondudiabète1et2mais
égalementdanscelledelagastroenté-
ropathiedu diabétique.Cesanomalies
précèdentl’apparitiondessymptômes
digestifs.
Les anomalies du microbiote [8]
L’importance du microbiote intestinal
est de plus en plus mis en avantdans
denombreusespathologiesdigestives.
Desmodifications du microbiote
existent au cours du diabète, surtout
de type 2,avecnotammentune dimi-
nution des Bactéroidetes et une aug-
mentation des Firmicutes.Ces modifi-
cations paraissentfavorisées par un
apportalimentairelipidiqueélevé.Les
changementsdansl’écosystèmeintes-
tinal pourraientégalementjouer un
rôle via la modification des acides
biliaires endo-luminauxqu’ils entraî-
nent. Lorsquedes troublesmoteurs
intestinauxapparaissent,unepullula-
tionmicrobienneestsouventdétectée.
Les perturbations hormonales [910]
Uneraréfactiondescellulesendocrines
etunediminutiondeleursécrétionont
étémisesenévidencechezlesujetdia-
bétique.Ces sécrétions hormonales
anormalescontribuentauxtroublesde
la motricitéetdel’absorption. Le rôle
d’une réduction du pooldes cellules
sécrétant de la ghréline estnotam-
mentmis en avant[10].
Le rôle du mauvais équilibre
glycémique [1]
Le mauvais équilibre glycémique, qui
peutêtrefavoriséparl’existenced’une
gastroparésie, est un élémentmajeur
dans la survenue de la gastro-entéro-
pathie diabétique.
L’équilibreglycémiqueauneffetdirect
surlamotricitédigestivepardesméca-
nismesmalélucidés,aumoinspartiel-
lementhormonaux.Quandlaglycémie
s’élèveau-dessusde8mmol/Llamotri-
citéantro-pyloro-duodénaleestaltérée.
L’hyperglycémie contribue également
àl’agression des neurones entériques
en induisantunstress oxydatif et une
apoptose qui affectentles voies méta-
boliquesintracellulairesetlefonction-
nementdelaglie.Ceseffetsdel’hyper-
glycémie contribuentàla fois aux
troubles moteurs et sensitifs digestifs
observés chez lesdiabétiques [6,11].
Lesdifférentes atteintes
digestives et leur traitement
L’atteinte digestive haute
Elleest particulièrement délétère car
ellealtèrelaqualitédeviemaiscontri-
bueaussi au mauvais équilibre du
diabète.
La gastroparésie diabétique [1214]
Le diabète,qu’il soitdetype 1ou 2,est
la cause dans 30 %des cas d’un ralen-
tissementobjectif de la vidange gas-
trique, en l’absence de toutobstacle
mécanique(définitiond’unegastropa-
résie).Dans le diabète de type 1,l’inci-

GASTROENTÉROLOGIE
ET COLOPROCTOLOGIE
101
dence cumulée de cette gastroparésie
sur10ansestde4,8%,avecunesurve-
nueparticulièrementfréquente chez
lesmalades atteints d’une néphropa-
thie, d’une rétinopathie et/ou d’une
neuropathie diabétique. L’incidence
cumulée de la gastroparésie est seule-
mentde1%dans le diabète de type 2.
Sontévocateurs des vomissements
réguliers qui soulagentuninconfort
épigastrique,une plénitude épigas-
trique post-prandialeavecsensation
de digestionprolongée, une satiété
précoceet/ou nausées. Le déclenche-
mentoul’aggravation de la symp-
tomatologie par la prise alimentaire
renforce la suspiciondiagnostique.
Cependant,seulement40 %desmalades
décrivantdetelssymptômessouffrent
réellementd’une gastroparésie. Dans
certainscas,lesmêmessymptômespeu-
vent même témoigner d’une vidange
anormalementrapide. Une douleur
abdominaleépigastrique ou péri-
ombilicale, volontiers quotidienne,
parfoispermanente,estunautremode
de révélation d’une gastroparésie.
Nocturnedansprès de2/3descas,elle
perturbe le sommeil d’un malade sur
deux.Chezcertainsmalades,ladouleur
est décrite comme un ballonnement
gênant,de siège sus-ombilical.
Parmilesmaladesgastroparétiques,les
diabétiques ontune particularité:la
gastroparésie peutêtrepaucisympto-
matiqueetlesvomissementssontsou-
vent absents. Dès lors,il est important
d’évoquer la gastroparésie devant des
signes indirects :perte de poids mal
comprise, symptomatologie de reflux
gastro-œsophagien malcontrôléepar
un traitementanti-sécrétoire bien
suivi,difficultésd’équilibrationdudia-
bète.Dans le diabète de type 1,lagas-
troparésiedésynchronisel’horairedes
pics glycémiques post-prandiaux par
rapportaux horairesproposésdes
injections d’insuline et favorise les
accidents hypoglycémiques. Dans le
diabètedetype2,lagastroparésiefavo-
rise la mauvaisebiodisponibilitédes
anti-diabétiquesoraux,sourced’hyper-
glycémies.
Du faitdel’absence de corrélation
entrelessymptômesetlaréalitéd’une
gastroparésie, une mesure objective
de la vidange gastrique est utilepour
assoir le diagnostic. Si la méthode de
référence demeure la scintigraphie,
une étude de cette vidangeavecun
test respiratoireàl’acide octanoïque
marqué par le 13C, isotope stable du
carbone,est envisageable.
La prise en charge efficace de la gas-
troparésiedemeureunchallengepour
le clinicien.
Lapremièrelignedemesuress’appuie
sur des recommandations hygiéno-
diététiques (fragmentation de la prise
alimentaire, réduction de la fraction
lipidique et de l’apportenfibres), la
suppressionlesmédicamentsralentis-
santlavidange gastrique, la normali-
sation de la glycémie et le recours aux
prokinétiques [12,15].
Lemétoclopramideestefficacemaisla
fréquencedeses effetssecondaires
(20 %) en limite l’utilisation. L’utili-
sation deladompéridone estdésor-
mais déconseillée en raison du risque
de troubles du rythmequi n’est pas
contre-balancée parune efficacité
symptomatique démontréeàmoyen
terme.L’érythromycineetl’azithromy-
cine ontdes propriétés prokinétiques
quidépendentdeladose administrée
etdu moded’administration:parvoie
intraveineuse, l’érythromycine doit
être infuséeàla dose de 3mg/kgen
20 à30 minutes pourdéclencher des
contractionsantralesalorsque250mg
toutesles6à12heuresestla dosepré-
coniséepouruneadministrationorale
d’érythromycine. L’azithromycine a
ététestéeàladosede250mgenintra-
veineux.Ilfautsavoir pour l’erythro-
mycine, que l’hyperglycémie diminue
son efficacité, qu’un phénomène de
tachyphylaxie est problématique lors
d’une utilisationprolongée et que
l’érythromycine,substratetinhibiteur
du cytochrome P450 3A4,interagit
avec le métabolismehépatique de
nombreux médicamentstelsque le
fluconazole,lekétoconazole,levérapa-
mil ou le diltiazem. La co-administra-
tiond’érythromycineavecdesmédica-
ments allongeantl’espace QT est à
éviter de façon formelle car l’érythro-
mycine augmente le risque d’allonge-
mentdel’intervalleQTetdetorsadede
pointe,surtoutdansles4jourssuivant
l’institutiondu traitementetencasde
cardiopathie sous-jacente. Le prucalo-
pride, agoniste 5-HT4,peutêtre testé
mais son effet moteur gastrique est
moinsnetqueceluidécritauniveaudu
côlon.Lesanaloguesdelaghrélinesont
en cours d’évaluation.
L’échec de ces mesuresdepremière
intention conduitàdiscuter l’option
d’un traitementendoscopiqueou
une stimulation électrique àhaute
fréquence de l’estomac (SEG). Un
spasmepyloriquepeutexpliquercer-
taines gastroparésies diabétiques.
Maisl’utilitédedilatationspneuma-
tiques pyloriques ou d’injections
intrasphinctériennesdetoxinebotu-
lique demeure àdémontrer [16]. La
difficulté clinique réside dans la dif-
ficultéd’identifierdans la pratique
lesmalades diabétiques gastroparé-
tiques ayantunspasme pylorique.
L’effetsymptomatiquedelaSEGaété
décritdansdesgastroparésiesdiabé-
tiques,sévères(vomissementspluri-
quotidiens avec retentissement
nutritionnel)etréfractairesàtousles
traitementsavecungainpondéralet,
dans certaines séries, une équilibra-
tion plus faciledudiabète avec une
baisseduchiffre d’hémoglobine
glycosylée[17].
Quand la perte de poids excède 10 %,
le recours àl’alimentation artificielle
se discute.Du faitdesamoindre mor-
bidité et de sa meilleure efficacité, la
nutritionentérale,ensiteduodénalou
jéjunal, est àpréféreràla nutrition
parentérale. L’intérêt d’une solution
chirurgicale, tellequ’une diversion
duodénale,est très discuté [15].
L’atteinte œsophagienne
Les troubles moteurs œsophagiens au
cours du diabète sontnon spécifiques
[18-20].Ils seraientretrouvés chez
plus d’un diabétiquesur deux décri-
vant des symptômes orientantvers le
tube digestif haut,même en l’absence
dedysphagiecaractérisée.Lescontrac-
tionssontmalounonpropagéeset/ou
d’amplitude réduite, parfois répéti-
tives. Un défaut de relaxation du
sphincterinférieur de l’œsophage est
possibleavec,aumaximum,untableau
manométrique d’achalasie. L’atteinte
œsophagienne,encontrariantlaprise
alimentaire, est délétère pour l’équi-
libre du diabète.
Unrefluxgastro-œsophagien(RGO)est
décritpar 14 %des maladesdiabé-
tiques, plus volontiers dans le diabète
detype2(prévalenceentre25et41 %),
notammentpar lesmalades dontle
diabète évolue depuis plus de 10 ans
[21]. Il peutêtre favorisé par une
gastroparésiequiaugmentelecontenu
gastriquesusceptiblederefluer.L’alté-
ration du péristaltisme œsophagien
retarde la clairance acide œsopha-
gienne et accroît le risqued’œso-
phagite. Dans certaines séries, la neu-
ropathie viscéraleest apparue un
facteur indépendantderisque d’œso-
phagite liée àune moindre sensibilité
muqueuseœsophagienneauxépisodes

102
dereflux[19].Plusde20 %desmalades
avecneuropathiepériphériqueétaient
porteurs d’une œsophagite ulcérée
asymptomatique.Lapriseenchargedu
RGOetdes troubles moteurs de l’œso-
phage chez lesdiabétiques n’a rien de
spécifique.
L’atteinte du tube digestif bas
Ellecontribue de façon importante à
l’altérationdelaqualité de vie des
malades.
Les troubles du transit
La Diarrhée [22]
Une diarrhée chronique survientchez
3à22 %des diabétiquesselon les
études. Cliniquement, il s’agitd’une
diarrhée plutôt motrice, explosive,
volontiers intermittente. Les selles
sont abondantes,plutôtaqueuses,
fréquentes (plus de 10 selles par jour),
souventnocturnes.Unestéatorrhéeest
possible.Ladiarrhéepeutêtreassociée
àune incontinence fécaleetdoitêtre
distinguée d’une fausse diarrhée de
constipation,égalementfréquente.
Toutes lescauses de diarrhée des non
diabétiques peuvent être retrouvées
chezlesdiabétiques,maisilfautsysté-
matiquementéliminer une diarrhée
provoquéepar la prise de Biguanides
(GLUCOPHAGE®,STAGID®…),unediar-
rhée avec stéatorrhéedue àune pan-
créatitechronique,unediarrhéesecon-
daireàunehyperthyroïdieassociéeau
diabète ou encore une diarrhée dueà
unemaladiecœliaqueàlaquelleferait
penserunsyndromedemalabsorption.
La diarrhée diabétique elle-même
est une diarrhée hydrique, fécale, non
sanglante, indolore, présentantdeux
caractéristiquescliniquesessentielles:
la fréquence des selles allant de 10 à
30 selles par jour, impérieuses,sur-
venant souventaprèsles repas et
parfois la nuit ou àl’occasion d’une
hypoglycémie.Elles’accompagnedans
50 %descas,d’uneincontinencefécale.
L’évolutionsefaitparpousséesdequel-
quesjoursàquelquessemaines,suivies
d’un retourdutransit àlanormale
ou même assez fréquemment d’une
constipation.Cetterythmicitéestdonc
bien différente de celle de la fausse
diarrhéedes constipés.Faitparticulier,
cettediarrhées’accompagnedans50 %
descas d’une stéatorrhée modérée,
sansdéficit pancréatique externeou
atrophie villositaire et sans syndrome
de malabsorptionmajeur ni amai-
grissement.
La diarrhée du diabétique est souvent
multifactorielle. Cellespécifiquement
rattachée àune complicationdudia-
bèteestmajoritairementprésentechez
lesdiabétiques de type 1,notamment
leshommes (sexe ratio:3/2), surtout
lorsqueladuréed’évolution de leur
diabète insulino-dépendantdépasse
8ans,etqu’uneneuropathieautonome
existe. La neuropathie autonome ou
viscéralediabétiquealtèrelesmotrici-
tés grêlique (interdigestive et post-
prandiale) et colique :disparition des
complexes migrants moteurs absents,
activité de type Phase II continue,
contractions non coordonnées et non
propagées,absencederéponsemotrice
du grêleàlaprise alimentaire, dimi-
nution des contractions propulsives
duodénales, et augmentation des
contractions rétrogrades. Ces anoma-
lies motrices provoquentsouvent une
pullulationbactérienneendo-luminale
qui aggrave la diarrhée [23,24]. Au
niveau du côlon, la perte des méca-
nismes inhibiteursdecontrôle (VIP,
NO) secondaire au diabète accroît la
motricité. L’effetdiarrhéogènedeces
troubles moteurs est accentué par
l’altérationdes capacités d’absorption
hydro-électrolytique coliques.
Surle plan thérapeutique,lesralentis-
seurs du transitd’utilisation courante
sontpréconisésenpremièreintention.
Encasd’échec,lacolestyramine(1sachet,
troisfoisparjour avantlesrepas)peut
être essayée. Cette résine permet de
séquestrer lesacides biliaires synthé-
tisés en excès par l’absence de régula-
tionentérocytaire.Une autre résine,le
colesevelamseraitplusefficace mais
le médicamentest pour l’instant
réservéenATU dans certaines hyper-
cholestérolémies.
La pullulation microbienne :une
cause ànepas méconnaître [23].
Elleexpliqueraitprès d’une diarrhée
chroniquesur deuxchezlediabétique.
En cas de pullulation, le nombre de
selles quotidiennes et le nombre de
symptômesgastro-intestinaux aug-
mentent.Saprésencen’estpascorrélée
avec la durée du diabète. Elleest favo-
riséeparlestroublesmoteursdu grêle,
notammentl’absencedecomplexes
moteurs migrants [24].
Le diagnosticdemeure difficile.Le
tubageduodénalprotégéestréservéà
quelquescentresetnedétectepasune
pullulation iléale. Un test respiratoire
àlarecherche d’une production d’hy-
drogène précoce aprèscharge orale
en glucose est une alternativedispo-
nibledans quelques centres. Le plus
souvent,lediagnostic est envisagé de
principeetuntraitementantibiotique
d’épreuve est proposé àlafois comme
test diagnostique et comme traite-
ment. Les fluoro-quinolones repré-
sententl’antibiothérapie de choix, en
raison de leur pouvoir bactéricide sur
la majoritédes entérobactéries et de
leur spectre épargnant lesbactéries
anaérobies.Enpratique,lamono-anti-
biothérapie orale de 7à10 jours est
l’attitude conseillée par la plupartdes
auteurs. Ellepeutêtre répétée ou réa-
lisée en alternance avec une autre
classethérapeutiqueencasderechute.
Un antibiotique très peu absorbé, la
rifaximine est une nouvelleoption
[25], qui ne pourraêtre pour l’instant
utilisé qu’hors AMM puisque le médi-
camentestindiquédanslaprévention
ou le traitementdel’encéphalopathie
hépatique. Avec l’antibiothérapie, la
réduction des apports en lactose peut
être bénéfique.
Lorsque la pullulation est liée àla
disparitiondes phasesIIIdanslegrêle,
il est logiqued’essayer d’en induire
pharmacologiquement:latrimébutine
(dose minimale:600 mg/jour), l’éry-
thromycine àfaibledose (40 à50 mg)
ousurtoutl’octréotide(50à100µgpar
voie sous-cutanée, 1à3fois par jour)
[26],sontdessolutionsthérapeutiques
potentielles.
La constipation
20 à44 %des sujets diabétiques souf-
friraientdeconstipation ou auraient
recours àl’utilisation de laxatifs [1].
Cette constipation peutêtre autant
une constipation de transitque la
conséquenced’untroubledel’évacua-
tion rectale.
Les mécanismes qui favorisentle
ralentissementdutransitcoliquechez
le diabétique sont la diminution du
réflexegastro-coliqueprécoceettardif,
la diminutionduréflexe péristaltique
paratteintedu SNE,l’augmentationde
l’amplitudedes contractions coliques
segmentairesspontanéesparlalibéra-
tion en excès de neurotransmetteurs
excitateurs et/ou un défaut de neuro-
transmetteursinhibiteurs,etlamoindre
réponsedesmécanorécepteurscoliques
àladistension,secondaireàl’hypergly-
cémie [27]. Parallèlement, la diminu-

GASTROENTÉROLOGIE
ET COLOPROCTOLOGIE
103
tion de la sensibilité rectalecontribue
àdes troubles de l’évacuationrectale
en émoussantlebesoin exonérateur
[28,29].
D’unpointdevuethérapeutique,outre
l’équilibre glycémique optimal et les
règleshygiéno-diététiqueshabituelles,
la prise en charge n’a rien de spéci-
fique.Danslesconstipationsdetransit
résistantaux laxatifs usuels,le pruca-
lopride,agonistesélectifdesrécepteurs
sérotoninergiques de type 5-HT4peut
êtreessayé,avecuneprisequotidienne
unique de 2mg,réduite à 1mg en cas
d’insuffisance rénale. Un ralentisse-
mentdistal sur le tempsdetransitdes
marqueurs amène àproposer un trai-
tementadapté, éventuellementdis-
cuté àpartir des résultats de la mano-
métrie ano-rectale.
L’incontinence fécale [1]:
Environ 10 %des diabétiques se
plaignentd’une incontinence fécale
active ou passive.L’incontinence est
àdifférencier de la diarrhée, qu’elle
peutmasquer ou aggraver.Elleest
une source majeure d’altérationde
la qualité de vie chez lesmalades,
notammentlorsquelesaccidentssont
nocturnes,interrompantlesommeil.
La physiopathologie de l’incontinence
analen’est pas encore très claire.Les
études d’hyperglycémie provoquée
chez lessujets sains suggèrentque
l’hyperglycémiealtèrelebesoinexoné-
rateur [28,29]alors que la contraction
volontairedusphincteranalestconser-
véechezcespatients.L’existenced’une
neuropathie autonome qui augmente
leseuildesensibilitérectaleaugmente
le risque d’incontinence [2].
Conclusion
L’atteintedigestiveaucoursdu diabète
peutrevêtirplusieursaspects,souvent
associés. Son traitementrepose en
premièreintentionsurlestraitements
symptomatiques usuelsetl’optimi-
sation de l’équilibre glycémique.Une
approchepluridisciplinaire associant
le diabétologue, le gastroentérologue
et le nutritionniste est souvent néces-
saire. En cas de difficultés, desthéra-
peutiquesplusspécifiquessontàenvi-
sager.Lesdonnéesphysiopathologiques
lesplusrécentes, mettantenavant le
rôle du microbiote et la perméabilité
intestinaleaccrueoffrentdenouvelles
cibles thérapeutiques.
Références
1. Krishnan B, Babu S, Walker J, et al.
Gastrointestinal complications of diabetes
mellitus. World JDiabetes 2013;15:5163.
2. Vinik AL,Braxton D, et al. Diabetic Autonomic
Neuropathy. Diabetes Care 2003;26:
155379.
3. Gatopoulou A, PapanasN,Maltezos E.
Diabetic gastrointestinal autonomic
neuropathy:current status and newachieve-
mentsfor everyday clinical practice.Eur J
InternMed 2012;23:499505.
4. Chandrasekharan B, Srinivasan S. Diabetes
and the enteric nervous system. Neuro-
gastroenterol Motil 2007;19:95160.
5. Ordog T. Interstitial cells of Cajal in diabetic
gastroenteropathy. Neurogastroenterol Motil
2008;20:818.
6. Frokjaer JB, Andersen SD, et al. Gutsensa-
tionsindiabeticautonomic neuropathy. Pain
2007;131:3209.
7. De Kort S, Keszthelyi D, Masclee AM. Leaky
gut and diabetes mellitus: what is the link?
Obes Rev2011;12:44958.
8. Wu H, Tremaroli V, Backhed F. Linking micro-
biota to human diseases: asystems biology
perspective.Trends in Epidemiol Metabolism
2015; doi.org/10.1016/j.tem2015.09.011.
9. El-SalhyM.The possible role of the gut neu-
roendocrine system in diabetes gastroente-
ropathy. HistolHistopathol 2002;17:115361.
10.El-SalhyM,Rauma J. Lowdensityofghrelin
cells in the oxyntic mucosa correlated to
slowgastric emptying in patientswith type 1
diabetes. Mol Med Rep2009;2:8936.
11. Bytzer P, TalleyN,et al. GI symptoms in dia-
betes mellitus areassociated with both poor
glycemic control and diabetic complications.
Am JGastroenterol 2002;97:60411.
12.Camilleri M. Clinical practice. Diabetic gastro-
paresis. NEngl JMed 2007;356:8209.
13. Camilleri M, Bharucha AE,Farrugia G.
Epidemiology,mechanismsand manage-
ment of diabetic gastroparesis, Clin Gastro-
enterol Hepatol 2009;9:512.
14. Choung RS, LockeGR, Schleck CD, et al. Risk
of gastroparesis in subjects with type 1and
2diabetesinthe general population. Am J
Gastroenterol 2012;107:828.
15.Abell TL,Berstein RK.Treatment of gastro-
paresis: amultidisciplinaryclinical review.
Neurogastroenterol Motil 2006;18:26383.
16.Coleski R, Anderson MA,Hasler WL.Factors
associated with symptom response to pylo-
ric injection of botulinum toxin in alarge
series of gastroparesis patients. Dig Dis Sci
2009;54:263442.
17.McCallum RW,Lin Z, ForsterJ,et al. Gastric
electrical stimulation improvesoutcomes of
patientswith gastroparesisfor up to 10 years.
Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:3149.
18. FarajJ,Melander O. Oesophageal dysmoti-
lity, delayedgastric emptying and gas-
trointestinal symptoms in patientswith dia-
betes mellitus. Diabet.Med 2007;24:12359.
19.GustafssonRJ, Littorin B, Berntop K, et al.
Esophagealdysmotilityismorecommon
than gastroparesis in diabetes mellitus and
is associated with retinopathy. RevDiabet
Stud 2011;8:26875.
20.Roman S, MarjouxS,Thiolet C, Mion F.
Oesophageal function assessedbyhigh-
resolution manometryinpatientswith dia-
betes andinadequateglycaemic control.
Diabet Med 2014;31:14529.
21. Lluch I, AscasoJF, MoraF,et al. Gastro-
esophageal reflux in diabetes mellitus. Am J
Gastroenterol 1999;94:91924.
22.LysyJ,Israeli E, Goldin E. The prevalence of
chronic diarrheaamong diabetic patients.
Am JGastroenterol 1999;94:216570.
23. Virally-Monod M, Tielmans D, Kevorkian JP,
et al. Chronic diarrheaand diabetesmellitus;
prevalence of small intestinal bacterial over-
growth. Diabetes Metab 1998;24:5306.
24.Husebye E. Gastrointestinal motilitydisor-
dersand bacterial overgrowth. JInternMed
1995;237:41927.
25.PimentelM.Reviewofrifaximin as treatment
forSIBO and IBS. ExpertOpin Investig Drugs
2009;18:34958.
26.Meyer C, O’Neal DN, Connell W, et al.
Octreotide treatment of severe diabetic diar-
rhoea. Inter Med J2003;33:6178.
27.Sims MA,Hasler WL, et al. Hyperglycemia
inhibitsmechanoreceptor-mediated gastro-
colonic responsesand colonic peristaltic
reflexesinhealthyhumans. Gastroenterology
1995;108:3509.
28. Russo A, Botten R, Kong MF, et al. Effectsof
acutehyperglycaemia on anorectalmotor
and sensoryfunctionindiabetes mellitus.
Diabet Med 2004;21:17682.
29.CheyWD, KIM M, et al. Hyperglycemiaalters
perception of rectal distension and blunt
the recto-anal inhibitory reflexinhealthy
volunteers. Gastroenterology 1995;108:
17008.
 6
6
1
/
6
100%