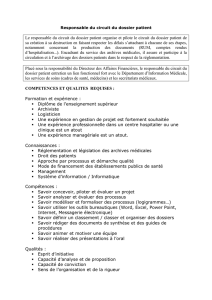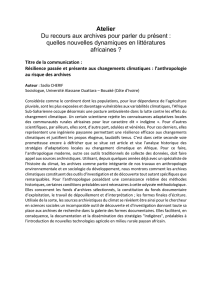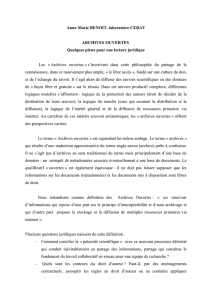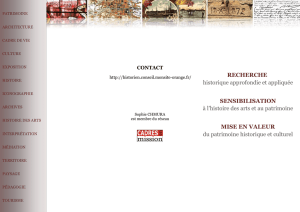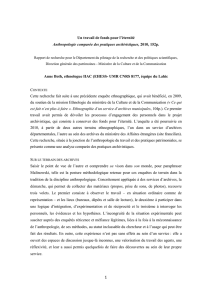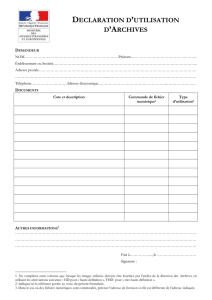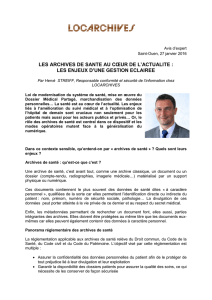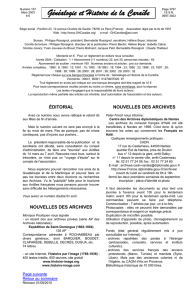Presentation_Gilles

Intérêt scientifique de l’archivage des sciences sociales.
(Gilles Laferté)
Pourquoi faut-il conserver des archives de l’activité en sciences sociales ?
Poser ainsi, la question peut paraître provocatrice mais aujourd'hui, face à l’absence de
politique de conservation et à la destruction progressive et continue des archives des sciences
sociales, force est de constater que la conservation n’est pas une évidence, ni pour l’ensemble
des chercheurs et encore moins pour nombre de nos organismes de tutelle, laboratoires,
universités, instituts de recherche.
Nous pourrions présenter en trois points les intérêts d’une conservation des archives des
sciences sociales :
- la préservation de données multiples, hétérogènes sur les sociétés étudiées
- la possibilité de revisite renforçant la scientificité de nos disciplines
- le moyen d’écrire non pas une histoire intellectuelle des disciplines mais bien une
histoire sociale des sciences sociales.
I. La préservation de données diversifiées actuellement non conservées
Si aujourd’hui on ne peut que se féliciter de l’archivage des enquêtes et données statistiques
notamment au sein du Centre Quételet, la conservation des enquêtes directes ou qualitatives
fait cruellement défaut. Monographies leplaysiennes, géographie de plein vent, anthropologie
de terrain dans les colonies et en métropole, puis sociologie qualitative et histoire orale, sont
autant de courants importants de la recherche autour desquels il convient aujourd’hui de
constituer des outils pour conserver les données recueillies. Or sur ce dernier point, il y a
urgence à organiser un sauvetage d’archives menacées puisque ces archives scientifiques
échappent largement à la diligence des Archives publiques ou des bibliothèques. Ni les
Universités, occupées à accueillir un nombre grandissant d'étudiants, et qui n'avaient ni le
temps ni la place pour cette conservation, ni le CNRS, dont les équipes de recherche étaient
temporaires, ni les organismes financeurs, publics ou privés, ne s'y sont vraiment intéressés.
Ils les ont très rarement demandées, n'ont guère encouragé les producteurs à les conserver, et
n'allaient donc pas se préoccuper de leur devenir. Les archives de ces données ont pour
certaines disparues et pour d’autres, restent conservées au sein des archives personnelles des
chercheurs eux-mêmes, sans solution pérenne. De sorte que nous assistons, impuissants, à la
disparition d'une grande partie de cette moisson. Des enquêtes que d’autres chercheurs
auraient voulu lire sont difficiles à localiser, plus difficiles encore à consulter, souvent
égarées, voire détruites. Sans parler des enquêtes dont l'existence est pratiquement inconnue
de la communauté scientifique, parce que n'ayant fait l'objet que d'une « publication grise ».
Cette situation est dommageable, c'est un gâchis considérable de sources encore rares et qui
constituent un matériau précieux pour le développement de l'ensemble des sciences sociales.
Conserver ces données représente un enjeu évident de cumulativité pour nos sciences.
Cette situation prévaut pour l’ensemble des sciences sociales et elle est dramatique pour tous
les courants fondés sur l’enquête directe. Or réutiliser aujourd’hui les matériaux issus de ces
enquêtes directes, à condition de les resituer dans le contexte de leur production, présente
l’intérêt d’offrir un accès à des pratiques non officielles, mal cernées par les enquêtes
statistiques et administratives, donnant souvent la parole à des individus ordinaires et non à

des personnages socialement reconnus. L'intérêt de ces enquêtes dépasse souvent le projet
pour lequel elles ont été menées, et elles peuvent être utilisées plus tard pour étayer des
problématiques différentes, souvent inattendues. Une nouvelle lecture conduit à porter un
autre regard sur ce qui a été dit, parce que le temps a passé, et que les questions qu'on se pose
se sont déplacées. Les données de ces enquêtes constituent un fond utile aux diverses
disciplines, quelle que soit la formation de la personne qui les a produites. Ne pas se limiter
aux enquêtes statistiques et conserver toutes les enquêtes issues de toutes les méthodes de
recherche, permet de sauvegarder des moyens diversifiés de réinterroger sous divers angles le
passé des sociétés.
II. La revisite
La question des archives nous ramène à une interrogation sur la réflexivité à partir de
l’activité scientifique elle-même. Le travail à mener est une étape essentielle dans la réflexion
sur la pérennité des données. Il ne s’agit pas seulement de conserver des documents pour
l’histoire des disciplines mais aussi de mettre au point des propositions pour l’archivage futur
des recherches et de rendre possible la revisite des travaux. En effet, seules des enquêtes
conduites avec toute la rigueur nécessaire peuvent être revisitées au sens anglo-saxon du
terme. L’archive devient ainsi l’un des enjeux de la recherche elle-même en offrant un
magnifique outil de controverse dont l’anthropologie anglo-saxonne est dotée depuis
longtemps, ce qui a permis le développement de recherches particulièrement novatrices qui
posent la double question de l’historicité des sociétés étudiées et de l’historicité du regard
scientifique. Ce fut le cas dès 1960 avec la célèbre controverse, jamais traduite en français,
entre Robert Redfield et Oscar Lewis sur le village mexicain de Tepotztlan, enquêté à trente
ans de distance par ces deux anthropologues. Plus récemment, des terrains ethnographiques
majeurs ont été revisités, comme les Iatmul de Nouvelle Guinée après Gregory Bateson
1
ou
les îles Trobriand après Malinowski
2
. Il faudra se demander pourquoi de telles pratiques sont
absentes des sciences sociales françaises et tenter de les promouvoir dans l’avenir.
Derrière ces possibilités de controverses scientifiques permises par les archives, c’est
également au statut de la preuve et donc à la scientificité de nos disciplines que l’on
s’intéresse. Les sciences sociales étant des disciplines largement interprétatives, elles
souffrent souvent d’un manque de légitimité plus elles s’éloignent des expressions les plus
canoniques des sciences dures comme les données chiffrées. Toutes les sciences sociales se
fondent en partie sur un récit les rapprochant plus ou moins du roman, de la littérature, du non
scientifique. Détruire les archives, c’est alors faire disparaître le statut de la preuve, la
construction des données, coupant définitivement les œuvres de leur armature scientifique.
Les archives des enquêtes permettent de constamment réinterroger la scientificité des résultats
que ce soit pour la confirmer ou l’invalider. Elles offrent des outils irremplaçables pour
définir des critères d’acceptation des résultats en sciences sociales et pour ainsi défendre la
scientificité de nos disciplines.
III. Histoire sociale des sciences sociales
1
Pour une analyse en français de ces données de terrain revisitées par l’anthropologie de langue anglaise, voir
Michael Houseman, Carlo Severi, Naven ou le donner à voir, Paris, CNRS/MSH, 1994.
2
Cf. entre autres, Annette Weiner, Women of Value, Men of Renown: New Perspectives in Trobriand Exchange,
Austin, Univ. Of Texas Press, 1976.

On peut essayer de distinguer plusieurs approches dans l’histoire des sciences sociales telle
qu’elle se pratique aujourd’hui, approches ayant chacune un rapport distinct aux archives.
Sans prétendre connaître l’ensemble de la production d’histoire des sciences sociales, il nous
semble toutefois important de distinguer entre trois démarches :
- une histoire intellectuelle et souvent interne à chaque discipline ;
- une histoire de l’institutionnalisation des disciplines ;
- une histoire sociale des sciences sociales.
L’histoire intellectuelle et interne aux disciplines correspond en général à un premier effort
d’histoire sur une discipline. Ces histoires par discipline des sciences sociales, écrites
généralement par les plus institutionnels de chacune de ces disciplines, doivent
prioritairement se lire comme une lutte pour produire des généalogies évolutionnistes tendant
à conforter les positions intellectuelles victorieuses instituées et choisies de la science
délaissant les entreprises vaincues. Ces histoires des sciences sociales consistent souvent à
écrire la « bonne science », à tracer la « bonne filiation », soit dans une visée pédagogique,
soit pour ennoblir sa science, ou encore pour affermir la scientificité d’un courant de la
discipline contre un concurrent. Ces histoires n’ont nullement besoin d’archives et se
contentent de sélectionner les œuvres choisies pour constituer la bonne vision de la science. Il
s’agit de mettre en perspective dans une histoire intellectuelle de la discipline quelque peu
déconnecter des évolutions sociales politiques et économiques rendant possible la marche
d’une science.
Une seconde approche, celle que l’on qualifie de l’institutionnalisation des disciplines,
tranche avec la première puisqu’elle comprend les sciences sociales comme une activité
interdépendante des autres activités sociales. En s’écartant des histoires intellectuelles des
disciplines fondées sur la stricte analyse des écrits des chercheurs, il importe d’entrer dans
l’histoire sociale des sciences sociales en décrivant leurs inscriptions institutionnelles (science
amateur versus science professionnelle ; financement public, privé, national, régional,
municipal, projet de recherche national ; rôle de l’expertise pour les sciences sociales), leurs
liens aux mondes politiques (par exemple les impératifs de la construction de l’Etat-nation
pour la géographie ou l’histoire au début du XXe siècle, le contexte colonial pour l’ethnologie
exotique ou plus généralement l’engagement politique des chercheurs), économiques (par
exemple le rôle des régions économiques pour la géographie dans l’entre-deux-guerres ou la
modernisation agricole pour la sociologie rurale dans les années soixante) ou encore culturels
(les avant-gardes artistiques pour l’ethnologie de la France dans l’entre-deux-guerres). Dans
cette perspective, la réussite scientifique est le fruit d’une lutte de pouvoir qui
s’institutionnalise en mobilisant des réseaux scientifiques mais également des réseaux
politiques et économiques dégageant progressivement des trajectoires ascendantes de courants
scientifiques et des personnages qui les incarnent. Cependant ce modèle, qui est aujourd’hui
très largement dominant, a tendance à réduire les trajectoires des sciences à des étapes sur une
ligne d’évolution dont le point d’aboutissement est la science instituée bénéficiant de tous les
critères de l’institutionnalisation. Dans ce cadre, le chercheur s’intéresse principalement au
cœur des disciplines, c’est-à-dire aux quelques institutions centrales, souvent parisiennes, qui
ont été le théâtre de la consécration des courants victorieux des disciplines. Ainsi l’histoire
sociale des sciences sociales se concentre généralement sur la science nationale conduite dans
les institutions centrales (la Sorbonne, le Collège de France…) ou sur l’analyse des politiques
nationales universitaires. Ainsi, on ne trouve pratiquement aucune étude sur les universités

provinciales. L’historiographie est donc particulièrement lacunaire en ce qui concerne les
sciences sociales en province. Or, il apparaît que l’ensemble de ces lieux périphériques de la
science ne sont pas à négliger tant ils éclairent sur la structuration des disciplines et sur les
raisons sociales explicatives de l’émergence et des inflexions d’une science, dans ses objets,
dans ses techniques, dans ses institutions. Par exemple, dans l’entre-deux-guerres, en
enquêtant au cœur des réseaux de pouvoirs locaux, au sein des municipalités, des chambres de
commerce de Dijon et de Beaune, de la région économique Bourgogne, de l’Université
dijonnaise, de l’Académie de Dijon et des sociétés savantes… il est apparu que plusieurs
liens, nés d’une dépendance institutionnelle ou simplement d’une sociabilité bourgeoise,
unissaient les élites économiques, politiques et culturelles pour promouvoir la région
Bourgogne nourrie d’une idéologie régionaliste républicaine partagée, véritable sens commun
de la période. L’État comme la science “ en pratique ” ne sauraient se conformer à la volonté
de leurs institutions centrales et il faut en passer par une analyse plus détaillée, plus étendue et
plus périphérique au sein des réseaux sociaux pour en saisir leur réalité protéiforme. Ou
encore, c’est dans l’analyse des travaux des savants amateurs, des folkloristes et des
universitaires en province, scientifiques contemporains de l’école durkheimienne et de l’école
des Annales, que l’on trouve à la fois que la science républicaine se révèle une conception
anachronique dans beaucoup des milieux scientifiques de l’entre-deux-guerres, et que des
formes instituées et héritées de périodes plus ou moins reculées de la science se superposent
et entrent en lutte pour une bataille indécise, toujours révisable. Les institutionnalisations des
sciences sociales ne sont pas unilinéaires mais multiples, concurrentes, conflictuelles,
hiérarchisées, en interaction, héritées de répertoires, de possibles eux-mêmes produits
d’institutionnalisations précédentes des sciences. Il faut donc démultiplier les fonds
d’archives, archives d’institutions centrales évidemment mais également archives
d’institutions plus périphériques ; archives d’institutions mais aussi archives personnelles des
chercheurs.
Bien plus, le découpage des objets de recherche sur l’histoire des disciplines scientifiques est
très couramment une projection des champs disciplinaires aujourd’hui institués sur le passé,
découpage d’objet qui lui est anachronique. Or de la même manière que sur un axe verticale,
toutes les strates d’une science interagissent ensemble, sur un axe horizontal, il convient de
veiller à ne jamais produire une histoire interne des disciplines selon notre découpage
contemporain des sciences puisque la discipline elle-même dont on fait l’histoire n’existe pas
dans le passé étudié. Garder les archives préserve alors de toutes tentations évolutionnistes à
rebours que ce soit pour réduire la science d’une période à l’école victorieuse ou encore pour
réduire la science d’une période aux disciplines qu’elle deviendra. Conserver les archives
offre ainsi le moyen de comprendre finement l’avènement des disciplines que les scientifiques
portent plutôt que faire sans archives des histoires dont l’objectif est beaucoup plus la lutte
pour des positions contemporaines que la compréhension de la constitution des savoirs et
donc des effets de cette constitution sur la production des savoirs. Une science ne maîtrisant
pas son passé est une science qui ne connaît pas la construction socialement et historiquement
datée de ses techniques, de ses méthodes, ignorant ses forces et ses faiblesses, freinant ainsi
considérablement ses progrès.
C’est bien une sociologie historique des mondes des sciences sociales qu’il s’agit d’engager,
ne réduisant pas l’histoire de la science à celle de la science aujourd’hui instituée, dernière
histoire qui priverait les chercheurs de la compréhension de l’avènement des disciplines qu’ils
portent. L’état de la science dans une période est un feuilletage concurrentiel de différentes
entreprises scientifiques héritées de temps plus ou moins reculés, mobilisant des réseaux plus

larges que les strictes professions scientifiques, entreprises scientifiques dans des états de
cristallisation divers, dotées de pouvoirs de contrainte différenciés. Cette histoire transversale,
ouverte sur les univers non scientifiques dans lesquels se développent les sciences sociales,
histoire que l’on nomme « histoire sociale des sciences sociales », suppose de pouvoir accéder
à des fonds d’archives larges embrassant les chercheurs sur l’ensemble des scènes sociales
dans lesquels ils s’investissent.
1
/
5
100%