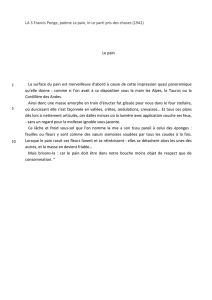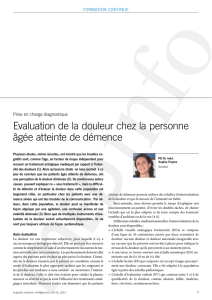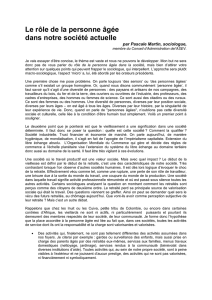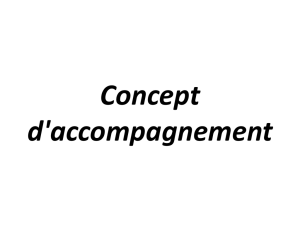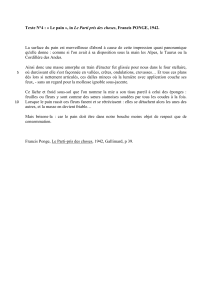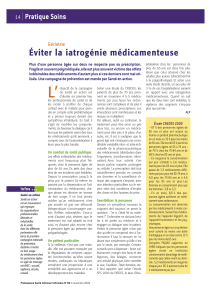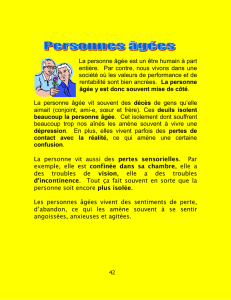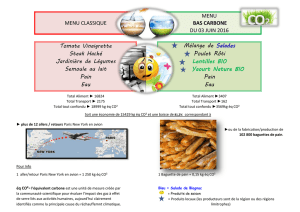Prise en charge de la douleur chronique chez la

Prise en charge de la douleur chronique chez la personne âgée
Article de S. Pautex N. Vogt-Ferrier
La douleur chronique est très fréquente chez les personnes âgées et ses
conséquences sont souvent graves. Plusieurs études ont montré que la douleur est
dans bien des cas insuffisamment contrôlée chez les personnes âgées parce qu’elles
ont tendance à banaliser la douleur, mais aussi parce que le personnel soignant
sous-estime leur douleur. Tous les antalgiques sont utilisables chez la personne
âgée à la condition de commencer à de faibles doses en tenant compte de la
fonction rénale et de la malnutrition et de titrer ensuite l’augmentation des doses
selon l’effet antalgique obtenu et les effets secondaires. Certaines autres
particularités de la prise en charge de la douleur chronique chez les patients âgés
seront décrites dans l’article.
Introduction
Les personnes âgées représentent environ 15% de la population suisse et sont le sous-groupe
dont la croissance est la plus forte. La prévalence des douleurs chroniques est de 25 à 50%
pour les personnes âgées vivant chez elles, et peut atteindre 80% pour celles vivant en
institution.1,2 L'appareil locomoteur est particulièrement touché, mais les maladies
cardiovasculaires, cancéreuses et neurologiques provoquent aussi souvent des douleurs. Par
ailleurs, une douleur chronique a souvent un impact plus grand sur le fonctionnement
physique et psycho-social chez la personne âgée.3 Malgré cette prévalence élevée et la gravité
des conséquences, peu d'articles sont publiés sur la douleur et la personne âgée. En effet, sur
4000 articles traitant de la douleur recensés chaque année dans Medline®, seulement 1%
concerne la personne âgée.4
Plusieurs auteurs ont démontré que les patients âgés sont souvent insuffisamment traités par
rapport à l'intensité des douleurs qu'ils présentent.5,6 Les préjugés sont probablement la cause
principale d'une analgésie insuffisante dans la population. Les personnes âgées négligent
souvent leur douleur, car elles la considèrent comme un fait inéluctable survenant avec
l'avance en âge. De plus, les soignants (infirmiers, paramédicaux et médecins) identifient mal
les plaintes douloureuses, souvent en raison d'une formation insuffisante sur l'évaluation de la
douleur et sa prise en charge chez la personne âgée.
Principes de base de l'antalgie médicamenteuse
Ils sont les mêmes que chez les patients jeunes : préciser les causes de la douleur, les
mécanismes impliqués (douleur nociceptive-neurogène), évaluer l'intensité de la douleur,
fixer les objectifs et déterminer un «programme» thérapeutique si possible avec un seul
médecin prescripteur.7 L'objectif ne peut malheureusement que rarement être la suppression
totale de la douleur, mais doit être fixé conjointement avec le patient selon les critères
«SMART» par exemple (tableau 1). Une évaluation de la douleur doit être faite de façon
systématique chez tous les patients âgés vu la prévalence élevée de la douleur dans cette
catégorie d'âge. Toutes les échelles d'auto-évaluation de la douleur peuvent être utilisées
(échelle visuelle analogique, verbale, numérique ou faciale), à la condition de prendre le
temps d'expliquer son fonctionnement au patient et de choisir celle qui est adaptée aux
éventuels troubles d'audition ou de la vue qu'il présente (tableau 2).


Quelques particularités du patient âgé
L'impact physique et psychosocial de la douleur chronique
Le retentissement de douleurs chroniques peut vite être catastrophique pour le malade âgé,
qui, dans 60% des cas, ne pourra pas effectuer seul les actes de la vie quotidienne, et qui peut
présenter des troubles du sommeil, de l'appétit, des chutes, des difficultés de mobilisation.8,9
La dépression est souvent associée à la douleur. En effet, la douleur implique chez une
personne âgée dans de nombreux cas des changements et pertes (physiques, psychiques,
affectives, sociales), nécessitant une prise en charge globale avec une mise en contexte des
traitements médicamenteux.10
Propriétés pharmacologiques
La pharmacocinétique médicamenteuse est modifiée par l'avance en âge. Ainsi, le volume de
distribution des médicaments hydrosolubles et liposolubles est modifié et les débits cardiaque,
hépatique et rénal diminuent. La malnutrition a divers effets sur la pharmacocinétique : elle
peut s'accompagner d'un petit poids corporel avec risque de surdosage à dose standard par
modification du volume de distribution total, d'une altération de la phase de distribution en
raison des changements proportionnels des différents compartiments du corps (par exemple
diminution du volume du tissu adipeux et médicaments lipophiles) et finalement d'une
hypoalbuminémie. L'introduction d'un médicament fortement lié à l'albumine (par exemple,
acide acétylsalicylique, bromazépam, buprénorphine) en présence d'autres médicaments peut
alors conduire, surtout en début de traitement, à une concentration élevée de la fraction libre
active du médicament, si la posologie habituelle du médicament est prescrite.
Ainsi, les patients âgés sont sujets à des grandes variations interindividuelles de distribution et
de métabolisme des médicaments. Ils sont à risque d'accumuler les médicaments et d'avoir
plus d'interactions médicamenteuses. La créatininémie étant un mauvais reflet de la fonction
rénale chez les personnes âgées dont la masse musculaire est diminuée, il est recommandé
d'utiliser la formule de Cockroft pour estimer la clairance de la créatinine. Les doses de
médicaments éliminés par le rein ayant une marge thérapeutique étroite doivent être
adaptées.11
Les comorbidités et la polypharmacie
La polypathologie fréquente avec l'avance en âge entraîne une polymédication et la
prescription d'un traitement antalgique peut être une bonne occasion de revoir l'ensemble des
traitements prescrits et de bien étudier le risque d'interactions.12 Vu le risque élevé
d'interactions médicamenteuses, il convient d'éviter les prodrogues comme la codéine,
d'ajuster les posologies, et d'être attentif aux effets secondaires additifs, comme la
somnolence, les états confusionnels ou le syndrome sérotoninergique. Un patient âgé qui
prend six médicaments a quatorze fois plus de risques de faire un effet secondaire qu'une
personne jeune avec le même nombre de médicaments.13
La non-observance médicamenteuse
Elle existe à tout âge, mais la plurimédication est un facteur de risque important pour une
mauvaise adhésion thérapeutique. Par ailleurs, les patients âgés ont souvent de nombreuses
représentations sur les opiacés comme la peur de perdre le contrôle, l'impression d'avoir

atteint le dernier recours, l'association de la morphine à la mort imminente et finalement la
peur de la toxicomanie. Il vaut la peine d'expliciter avec le patient ses priorités, de l'informer,
de l'impliquer dans la conduite du traitement et de reformuler ses craintes. La «non-
compliance» peut aussi être due à des problèmes pratiques quotidiens. Par exemple, certains
traitements antalgiques, qui doivent être pris toutes les huit heures, ne sont pas compatibles
avec le semainier classique du patient. Un deuxième semainier est souvent nécessaire ou une
adaptation des voies d'administration.
Les troubles cognitifs
La démence est une pathologie fréquente chez la personne âgée. Dans une étude de
prévalence faite à Genève, 2,7% des personnes âgées de 65 et 69 ans et 3,6% de celles âgées
de 75 à 79 ans sont atteintes de démence. Par la suite, le risque de développer une démence
double tous les cinq ans pour atteindre 25% à plus de 90 ans.14 Plusieurs études ont également
montré que les troubles cognitifs sont comme l'âge, un facteur de risque indépendant pour
recevoir un traitement antalgique inadéquat par rapport à l'intensité des douleurs présentées.
Vu les troubles mnésiques et la désorientation temporo-spatiale, l'évaluation de la douleur est
plus difficile chez les patients atteints de démence. Différentes échelles d'hétéro-évaluation de
la douleur ont été validées chez les patients atteints de démence au cours de ces dernières
années, néanmoins, il faut se rappeler que ces échelles doivent être réservées aux patients
atteints de démence sévère ne pouvant pas communiquer. En effet, nous avons montré que
plus de 90% des patients atteints de démence (légère (n = 64), modérée (n = 81) et sévère (n =
15)) étaient capables d'utiliser une échelle d'auto-évaluation (échelle verbale, visuelle
analogique verticale et horizontale et échelle faciale) de façon fiable et reproductible.15 Par
ailleurs, il faut se rappeler qu'une douleur peut se manifester chez un patient peu ou non
communiquant uniquement par des troubles du comportement par exemple.
Les traitements antalgiques médicamenteux
Pratiquement tous les antalgiques sont utilisables chez la personne âgée, si l'on respecte les
règles de prudence d'adaptation des traitements en tenant compte de la fonction hépatique,
rénale et de la malnutrition.16,17
Les non-opiacés ou médicaments du premier palier de l'échelle de l'OMS sont les traitements
de première ligne pour les douleurs légères à modérées. Le paracétamol est le traitement de
premier choix en raison de son profil relativement sûr chez les patients âgés. Malgré le fait
que les AINS puissent être extrêmement utiles dans certaines situations (arthrite, douleurs
osseuses sur métastases par exemple), il faut être prudent lors de leur administration chez les
personnes âgées, en particulier chez les patients diabétiques, hypertendus ou avec une
insuffisance cardiaque. Les AINS de courte demi-vie sont préférables (ibuprofène ou
diclofénac par exemple) et doivent être prescrits sur une courte période. Il faut être
particulièrement attentif aux effets secondaires classiques (insuffisance rénale, toxicité
gastrique), mais aussi penser à la décompensation cardiaque, à l'hypertension ou à l'état
confusionnel.
La plupart des opiacés peuvent être utilisés à la condition d'être instaurés à faibles doses
initiales, qui seront ensuite rapidement titrés sous contrôle de l'effet analgésique et des effets
indésirables. Pour des douleurs modérées surtout non cancéreuses, des opiacés dits «faibles»
du 2e palier comme le tramadol, la dihydrocodéine ou la codéine peuvent être utiles. Les
médicaments combinés (opiacés associés au paracétamol) sont à éviter, à cause du risque de

surdosage au paracétamol fréquemment décrit. Plusieurs études ont montré la «sous-
utilisation» des antalgiques du 3e palier chez les patients âgés. Parmi ceux-ci, la morphine, en
raison des différentes formes galéniques et voies d'administration à disposition et de sa courte
demi-vie, reste l'opiacé de référence pour les douleurs modérées à sévères. La voie orale doit
être privilégiée. L'idéal pour débuter est d'effectuer une titration de la posologie avec une
forme immédiate avant d'avoir recours à une forme prolongée. Il est fortement conseillé
d'initier le traitement avec 2,5 mg (en présence d'une insuffisance rénale modérée) ou 5 mg
(chez le sujet âgé en bon état général) de solution de morphine toutes les quatre heures et de
toujours prévoir des doses de réserve en cas de douleurs incidentes prévisibles (mobilisation
par exemple) ou non.
Les effets secondaires des opiacés, identiques à ceux décrits dans la population adulte
(nausées, somnolence, constipation, globe urinaire...) doivent être bien sûr traités, mais aussi
anticipés. La constipation, déjà très fréquente dans cette catégorie d'âge, doit être traitée de
façon active et continue. Les effets neurotoxiques des opiacés doivent être dépistés
(myoclonies, hallucinations, état confusionnel) à l'aide d'une anamnèse détaillée et d'un test de
dépistage des troubles cognitifs comme le Mini Mental Status Examination de Folstein. En
cas d'apparition d'un état confusionnel, si le patient est adéquatement hydraté, une rotation
d'opiacés est souvent indiquée. Il faut néanmoins se rappeler qu'une douleur mal contrôlée
peut également rendre les patients confus et éviter les associations avec des substances
sédatives comme les benzodiazépines. Le passage d'un opiacé à un autre impose une
connaissance de la pharmacologie de la substance et le respect des doses équianalgésiques7
(tableau 3). L'hydromorphone, plus puissante que la morphine, mais avec une efficacité et un
profil de sécurité très proches de la morphine, disponible sous forme à libération immédiate et
retard, est une bonne alternative si une rotation d'opiacés est nécessaire. Si l'on désire
employer du fentanyl percutané, il est recommandé de procéder à une titration avec un
opioïde à brève durée d'action et de suivre le patient de près après l'administration percutanée
de fentanyl. En effet, la cinétique de ce médicament peut être modifiée par les changements
de la composition corporelle d'eau et de graisse du tissu sous-cutané liés au vieillissement. La
méthadone doit être utilisée avec prudence en raison de sa longue demi-vie et de ses
interactions potentielles. Il convient également d'éviter les opiacés ayant des métabolites actifs
toxiques à longue demi-vie comme la péthidine ou le propoxyphène. Si la clairance à la
créatinine calculée est inférieure à 30 ml/min, la buprénorphine dont le métabolisme est
principalement hépatique et qui n'a pas de métabolites actifs peut être l'opiacé de choix.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%
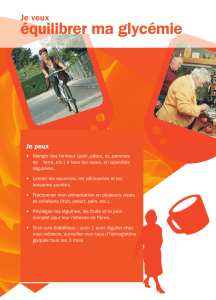
![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)