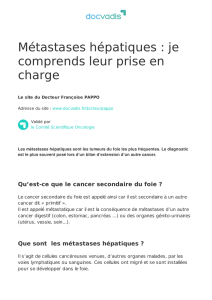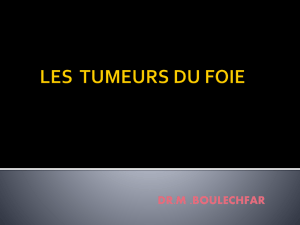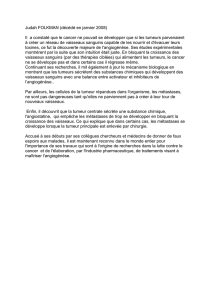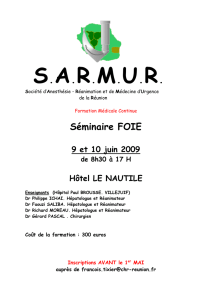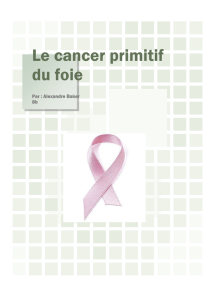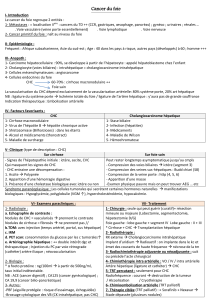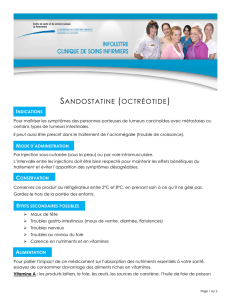Tumeurs du foie - polys-ENC

Tumeurs du foie (151) 55
QS151 Tumeurs du foie, primitives et secondaires
- Diagnostiquer une tumeur du foie primitive et secondaire
Voir aussi chapitre anapath du poly +++
Il faut distinguer les tumeurs malignes des tumeurs bénignes.
I - Les tumeurs malignes comprennent les tumeurs primitives et les métastases
II - Les tumeurs bénignes comprennent les kystes et les tumeurs solides
L'identification de la nature et du caractère malin ou bénin des tumeurs hépatiques est un problème fréquent
et parfois difficile. Le contexte clinique et les examens d'imagerie ont une grande valeur d'orientation. La
ponction dirigée sur laquelle repose le diagnostic histologique formel n'est pas toujours indispensable. La
collaboration entre cliniciens, radiologues et anatomo-pathologistes est capitale pour parvenir à un diagnostic
précis et rapide.
Chez un patient atteint d'une cirrhose, l'apparition d'un nodule dans le foie évoque en premier lieu un
hépatocarcinome. Chez un patient atteint d'une tumeur primitive extra-hépatique, la mise en évidence de
nodules hépatiques oriente vers des métastases. Chez une femme jeune et en bon état général, la
découverte d'une tumeur hépatique solide évoque avant tout une hyperplasie nodulaire focale ou un
adénome du foie. Les kystes biliaires du foie et les angiomes sont le plus souvent de découverte fortuite lors
d'un examen échographique et leurs caractéristiques d’imagerie sont habituellement suffisantes pour poser
le diagnostic. En l'absence de contexte clinique d'orientation ou en cas d'imagerie atypique, le diagnostic
étiologique des tumeurs solides repose principalement sur la ponction biopsie dirigée.
Carcinome hépatocellulaire
I - Epidémiologie et étiologie
Prolifération néoplasique d’origine hépatocytaire, le carcinome hépatocellulaire (CHC) est le plus fréquent
des cancers primitifs du foie. Les autres tumeurs primitives sont rares (cholangiocarcinome) ou très rares
(angiosarcome, carcinome fibro-lamellaire, hépatoblastome, hémangioendothéliome). Le CHC survient
presque toujours sur une maladie hépatique, une cirrhose dans plus de 90 % ou une hépatite chronique
virale préexistante, au terme d’une évolution de 2 ou 3 décennies. C’est la tumeur maligne la plus fréquente
dans le monde. Il existe toutefois une grande disparité géographique. Le CHC est le cancer le plus fréquent
en Afrique et en Asie du Sud-Est en raison de l’infection endémique par le virus B. Dans ces régions, un
grand nombre de sujets sont contaminés à la naissance et deviennent porteurs chroniques du virus. Le CHC
se développe habituellement chez l’adulte jeune au stade de cirrhose virale. Le CHC est beaucoup moins
fréquent dans les pays occidentaux. En France, le CHC se développe surtout sur cirrhose alcoolique après
l'âge de 50 ans. La cirrhose virale C est devenue la deuxième cause de CHC et sa fréquence devrait encore
augmentée au cours des deux prochaines décennies. La cirrhose est un “état précancéreux” mais le risque
de CHC est variable selon la cause (risque plus élevé dans cirrhose virale, alcoolique et hémochromatose
génétique) et selon le degré de la cirrhose. Globalement, l'incidence annuelle de dégénérescence est de 1 à
5 %. Certains agents étiologiques joueraient un rôle dans la carcinogénèse indépendamment de l'état de
cirrhose, notamment le virus de l’hépatite B. Le CHC est plus fréquent chez l’homme que chez la femme.
Différents facteurs ont été incriminés : hormonal, génétique, facteur carcinogène plus fréquent chez l’homme
(ex. : alcoolisme en France).
Le CHC se développe à partir d’un foyer initial localisé, envahit les vaisseaux portes et provoque des
métastases dans le foie lui-même par l’intermédiaire des branches portales. Cela explique le caractère
souvent multiloculaire du cancer et la tendance à la thrombose néoplasique des branches, puis du tronc de
la veine porte.
II - Clinique
1. Le CHC peut compliquer une cirrhose connue ou révéler une cirrhose jusqu'alors compensée et
méconnue:
- hémorragie digestive liée à l'aggravation d'une hypertension portale
- apparition ou aggravation d'une ascite
- ictère ou encéphalopathie secondaire à une insuffisance hépato-cellulaire

Tumeurs du foie (151) 56
La survenue d'une décompensation sans cause déclenchante chez un cirrhotique alcoolique abstinent est
particulièrement évocatrice de dégénérescence.
2. Le CHC peut être révélé par des douleurs de l'hypocondre droit et de l'épigastre du fait de l'extension et de
la nécrose tumorale.
3. Parfois, le CHC est dépisté par une échographie chez un patient cirrhotique en l'absence de tout
symptôme.
4. Il faut distinguer à part le CHC développé sur foie sain. C’est une situation très rare. Il se déclare soit par
des signes généraux (asthénie, amaigrissement), soit par des signes hépatiques, isolés ou associés, de
façon variable : masse volumineuse, douleurs de l'hypochondre droit, ictère, hypertension portale. En France,
le CHC sur foie sain est parfois d’un type histologique particulier, très rare, le cancer fibro-lamellaire qui est
de meilleur pronostic que le CHC classique.
III - Examens complémentaires
A - Examens biologiques
1)Biologie hépatique
Les anomalies biologiques hépatiques sont celles de la cirrhose sous-jacente selon sa cause et son degré de
sévérité. Aucune n'est spécifique.
2) Alpha-fœto-protéine (AFP)
C'est un constituant normal des protéines sériques du foetus humain, qui apparaît dès la 6 ème semaine de
vie intra-utérine et qui disparaît quelques semaines après la naissance. De ce fait, le taux d'alpha-
foetoprotéine est physiologiquement augmentée chez la femme enceinte.
Un taux supérieur à 500 ng par ml chez un sujet cirrhotique signifie la présence d'un CHC avec une
spécificité de 100%. Ce taux est observé dans environ 30 % des formes patentes de CHC. Dans 20 % des
cas, le taux d'AFP est normal. Dans les autres cas, il est intermédiaire et ne permet aucune conclusion. En
effet, une élévation modérée de l'AFP est possible en cas d’hépatite chronique en l'absence de toute
dégénérescence (cette élévation est liée à la régénération hépatocytaire liée au processus hépatitique
chronique).
3) Syndrome paranéoplasiques
Hypoglycémie, polyglobulie, pseudo-hyperparathyroïdisme, pseudo-hyperthyroïdie sont très rares mais
possibles, parfois révélateurs.
B - Examens morphologiques
Ils permettent de suspecter le diagnostic, en mettant en évidence le syndrome tumoral :
- l'échographie hépatique montre une image nodulaire hypo ou hyperéchogène ou un aspect hétérogène
mal limité. L'étude Doppler Couleur permet de préciser la vascularisation des nodules suspects (le CHC
est hypervascularisé) et de mettre en évidence une thrombose du système porte ou sus-hépatique (le
développement endo-veineux du CHC est très fréquent)
- le scanner hépatique et l’IRM sont utiles pour préciser la localisation et le nombre de nodules intra-
hépatiques; leurs indications sont liées aux performances de l'échographie et aux options thérapeutiques
envisageables. Le scanner hélicoïdal met en évidence l’hypervascularisation artérielle du nodule. Le
contraste disparaît au temps portal. Ces caractéristiques sont très évocatrices du diagnostic de CHC.
- Le bilan d'extension inclue une radiographie pulmonaire.
- Une scintigraphie osseuse et un scanner thoracique sont réalisés en cas de point d'appel clinique ou si
on envisage un traitement à visée curative (transplantation ou hépatectomie)

Tumeurs du foie (151) 57
C - Diagnostic anatomo-pathologique
Lorsqu'il existe une cirrhose, un nodule hypervascularisé et une augmentation de l'AFP au-delà de 500
ng/ml, le diagnostic est certain. Sauf protocole thérapeutique particulier, une ponction dirigée pour obtenir
une confirmation histologique n'est pas justifiée compte tenu des complications possibles liées au geste
(risque hémorragique selon le bilan d'hémostase et l'existence ou non d'une ascite).
Lorsque l'AFP n'est pas augmentée, le diagnostic de CHC est évoqué sur un faisceau d'arguments cliniques
et morphologiques. Les examens les plus utiles sont l'échographie, l'échographie doppler et le scanner
hélicoïdal. Dans cette situation, les indications de la ponction dirigée sont plus larges. Elle se discute selon
les options thérapeutiques. Outre le risque hémorragique, elle expose au risque d'ensemencement sur le
trajet (risque évalué à 2 % avec une microbiopsie et à 1 pour 10 000 après ponction à l'aiguille fine). Ce
risque contre-indique pour certains auteurs la ponction percutanée si on envisage un traitement curatif, en
particulier une transplantation. Le diagnostic repose alors sur des arguments d'imagerie typique (tumeur
hypervascularisée à l’échodoppler et au scanner hélicoïdal dans un foie de cirrhose) ou sur un prélèvement
effectuée au cours d'une coelioscopie.
IV – Diagnostic différentiel
1.Autres tumeurs primitives :
- la moins rare : le cholangiocarcinome intrahépatique ; cette tumeur se développe à partir des canaux
biliaires intrahépatiques, dans la majorité des cas sur foie sain. Elle complique parfois une cholangite
sclérosante. Il s’agit d’une tumeur fibreuse (opacification tardive au scanner assez évocatrice de
fibrose). Ces tumeurs peuvent poser un diagnostic différentiel difficile avec des métastases d’un
adénocarcinome (pancréas, côlon, sein à rechercher systématiquement dans cette situation).
- Les autres :
- angiosarcome :tumeur exceptionnelle, parfois induite par l’inhalation de monomère de chlorure
de vinyl ; en fait le plus souvent secondaire à un angiosarcome extrahépatique. Mauvais
pronostic.
- carcinome fibro-lamellaire : c’est en fait une variante du CHC (donc limite du diagnostic
différentiel – peut être aussi présenté comme une forme clinique) . C’est une tumeur rare
développée à partir des hépatocytes avec un important stroma fibreux, apparaissant le plus
souvent avant 50 ans sur foie sain, et d ‘évolution lente. Noter la possibilité de calcifications dans
la tumeur.
- hépatoblastome : Tumeur primitive touchant l’enfant avant 3 ans, typiquement avec syndrome
paranéoplasique (puberté précoce) et AFP très élevée.
- hémangioendothéliome épithélioïde : c’est une tumeur développée à partir des cellules
endothéliales. Elle touche le plus souvent le sujet jeune (< 40 ans). Elle est souvent
diagnostiquée au stade métastatique (poumons, peau). L’évolution tumorale est très lente.
2.Métastases : cf infra
V - Pronostic
Il dépend de la taille de la tumeur et de son extension, de la cirrhose sous-jacente et de l’état général du
patient.
Il est particulièrement péjoratif puisque la médiane de survie des patients ayant un CHC parvenu au stade
symptomatique est de quelques mois.
VI - Traitement
Le traitement dépend :
- de l'extension tumorale: taille et nombre des nodules, localisation dans le foie, métastases,
- de la cirrhose sous jacente
- des autres affections associées.
La transplantation hépatique et la résection chirurgicale sont des traitements à visée curative mais sont
rarement possibles :

Tumeurs du foie (151) 58
- La transplantation a l'avantage de traiter la tumeur et la cirrhose sous-jacente. Les indications sont les
suivantes : 1 nodule unique de moins de 3 cm de diamètre ( 5 cm pour certaines équipes) ou bien 3
nodules maximum de moins de 3 cm chacun.
- L’exérèse chirurgicale n’est possible qu’en cas de tumeur unique de petite taille (moins de 3 cm ou 5 cm
selon les équipes) chez des malades ayant une cirrhose Child A. La probabilité d’une récidive sur le foie
restant est élevée.
Depuis quelques années se sont développés des traitements percutanés qui ont pour objectif de détruire la
tumeur soit par alcoolisation (injection d'alcool absolu dans le nodule tumoral pour le nécroser), soit plus
récemment par radiofréquence (destruction thermique par une sonde). Ces techniques sont indiquées chez
des patients ayant 1 à 3 nodules ne dépassant pas 3 à 5 cm de diamètre. Aucune étude randomisée n'a
comparé l'efficacité de la résection chirurgicale et des techniques percutanées.
Les traitements médicamenteux sont palliatifs (c’est-à-dire sans perspective de guérison)
a - la chimiothérapie systémique n'a pas fait la preuve de son efficacité. L'intérêt du tamoxifène n'a pas été
confirmé par les études récentes. Il n'y a donc pas d'indication à une chimiothérapie générale ou à une
hormonothérapie en dehors d'un protocole.
b - la chimioembolisation lipiodolée consiste à injecter directement dans l’artère hépatique un agent
antinéoplasique (le plus souvent Adriamycine®) mélangé à du lipiodol qui se fixe préférentiellement sur les
cellules tumorales puis à emboliser les petites artères tumorales avec du spongel. Les contre-indications
sont la thrombose portale et l’insuffisance hépatocellulaire. La chimioembolisation peut parfois entrainer une
nécrose tumorale partielle ou complète, mais son bénéfice en terme de survie n’est pas démontrée
c - En cas de thrombose porte, il est possible d'injecter dans l'artère hépatique du lipiodol contenant de l'iode
131 (Lipiocis) sans embolisation complémentaire.

Tumeurs du foie (151) 59
Les tumeurs secondaires du foie
Les métastases hépatiques sont les tumeurs hépatiques les plus fréquentes en France. Elles compliquent
principalement les tumeurs abdominales drainées par la circulation splanchnique (côlon, rectum, estomac et
pancréas) mais elles peuvent aussi se voir dans pratiquement tous les cancers généralisés (poumons, seins,
ovaires, rein….).
I- Clinique
1. Circonstances de découverte
Les métastases hépatiques peuvent être asymptomatiques, découvertes par l'échographie lors du bilan pré-
thérapeutique de toute tumeur (les métastases sont dites synchrones) ou lors des examens de surveillance
après traitement de celle-ci (métastases métachrones). Dans cette situation, le diagnostic est évident.
Dans d'autres cas, les métastases hépatiques sont symptomatiques, révélatrices d'une tumeur primitive pas
ou peu symptomatique. L'altération de l'état général, une gêne épigastrique post-prandiale, des douleurs de
l'hypochondre droit plus ou moins intenses sont les principaux signes.
Un cas particulier est représenté par les métastases de tumeurs neuroendocrines. Les métastases des
tumeurs carcinoïdes peuvent être révélées par un syndrome carcinoïde (flush, diarrhée). Les métastases des
tumeurs endocrines peuvent être nombreuses et volumineuses chez un malade encore en bon état général.
2. Examen physique
L'hépatomégalie est le signe le plus fréquent. Elle est sensible à la palpation et présente une surface ou un
bord inférieur bosselé ou nodulaire. La perception d'un souffle localisé est très évocatrice d'un nodule
tumoral.
L'ictère (qui témoigne d'une insuffisance hépato-cellulaire ou d'une compression des voies biliaires), l'ascite
(qui témoigne d'une hypertension portale ou d'une carcinose péritonéale associée) se voient dans les formes
avancées à un stade terminal. Ces signes sont donc exceptionnellement révélateurs. Lorsqu'ils sont
présents, ils sont plutôt évocateurs d'un CHC décompensant une cirrhose méconnue. Ce sont les examens
complémentaires et notamment la ponction dirigée qui permettent de redresser le diagnostic.
L'examen général recherche, d'une part, les signes d'un cancer primitif, d'autre part, d'autres métastases en
particulier un ganglion de Troisier par l'examen des creux sus-claviculaires et une carcinose péritonéale par
les touchers pelviens.
II - Biologie
L'apport de la biologie est limitée parce qu'aucun test ne peut résoudre de façon décisive le diagnostic des
métastases hépatiques.
La biologie hépatique est habituellement perturbée (cholestase anictérique définie par une élévation du taux
des phosphatases alcalines et de la gamma-glutamyl-transpeptidase). Dans environ 10 % des cas, elle est
strictement normale.
Les signes de cytolyse hépatique et les anomalies inflammatoires sont inconstants et n'apportent aucun
argument supplémentaire en faveur de l'existence de métastases hépatiques.
Les marqueurs tumoraux ont un intérêt limité : l'antigène carcino-embryonnaire (ACE) est à un taux
pathologique dans la plupart des cancers digestifs : colo-rectaux et pancréatiques mais il peut être élevé
dans les cancers mammaires, bronchiques ou prostatiques. Il n'a donc pas de valeur d'orientation. Une
augmentation de l’AFP oriente vers un cancer primitif du foie mais chez un homme jeune et en l’absence de
cirrhose, il faut penser à un tératome testiculaire métastasé au foie.
III - Imagerie
L'imagerie détecte les nodules hépatiques. Elle guide la ponction dirigée. Enfin, elle permet de juger du
caractère extirpable ou non de la ou des tumeurs hépatiques.
1) Echographie. C’est l'examen primordial. Cet examen permet de déceler des nodules suspects de
plus de 5 mm de diamètre, de les situer dans le foie, et d'en préciser l'échostructure, enfin de guider
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%