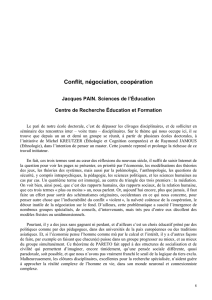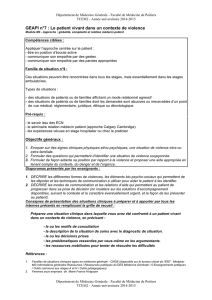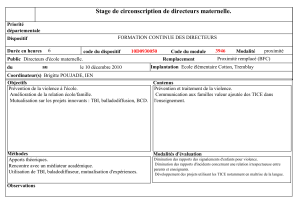la violence du non

1
PRECIS D’HUMILIATION
Toujours, l’État s’innocente au nom du Bien public de la
violence qu’il exerce. Et naturellement, il représente cette violence
comme la garantie même de ce Bien, alors qu’elle n’est rien d’autre
que la garantie de son pouvoir. Cette réalité demeure masquée
d’ordinaire par l’obligation d’assurer la protection des personnes
et des propriétés, c’est-à-dire leur sécurité. Tant que cette
apparence est respectée, tout paraît à chacun normal et conforme à
l’ordre social. La situation ne montre sa vraie nature qu’à partir
d’un excès de protection qui révèle un excès de présence policière.
Dès lors, chacun commence à percevoir une violence latente, qui ne
simule d’être un service public que pour asservir ses usagers.
Quand les choses en sont là, l’État doit bien sûr inventer de
nouveaux dangers pour justifier le renforcement exagéré de sa
police : le danger le plus apte aujourd’hui à servir d’excuse est le
terrorisme.
Le prétexte du terrorisme a été beaucoup utilisé depuis un
siècle, et d’abord par les troupes d’occupation. La fin d’une guerre
met fin aux occupations de territoires qu’elle a provoquées sauf si
une colonisation lui succède. Quand les colonisés se révoltent, les
occupants les combattent au nom de la lutte contre le terrorisme.
Tout résistant est donc qualifié de « terroriste » aussi illégitime que
soit l’occupation. En cas de « libération », le terroriste jusque-là
traité de « criminel » devient un « héros » ou bien un « martyr »
s’il a été tué ou exécuté.
Les héros et les martyrs se sont multipliés depuis que les
guerres ont troqué la volonté de domination contre celle
d’éradiquer le « terrorisme ». Cette dernière volonté est devenue
universelle depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les
tours du World Trade Center : elle a même été sacralisée sous
l’appellation de guerre du Bien contre le Mal. Tous les oppresseurs
de la planète ont sauté sur l’occasion de considérer leurs opposants
comme des suppôts du Mal, et il s’en est suivi des guerres
salutaires, des tortures honorables, des prisons secrètes et des
massacres démocratiques. Dans le même temps, la propagande
médiatique a normalisé les actes arbitraires et les assassinats de
résistants pourvu qu’ils soient « ciblés ».
Tandis que le Bien luttait ainsi contre le Mal, il a repris à ce
dernier des méthodes qui le rendent pire que le mal.
Conséquence : la plupart des États – en vue de ce Bien là - ont
entouré leur pouvoir de précautions si outrées qu’elles sont une
menace pour les citoyens et pour leurs droits. Il est par exemple
outré que le Président d’une République, qui passe encore pour
démocratique, s’entoure de milliers de policiers quand il se produit
en public. Et il est également outré que ces policiers, quand ils
encombrent les rues, les gares et les lieux publics, traitent leurs
concitoyens avec une arrogance et souvent une brutalité qui
prouvent à quel point ils sont loin d’être au service de la sécurité.
Nous sommes dans la zone trouble où le rôle des institutions
et de leur personnel devient douteux. Une menace est dans l’air,
dont la violence potentielle est figurée par le comportement des
forces de l’ordre, mais elle nous atteint pour le moment sous
d’autres formes, qui semblent ne pas dépendre directement du
pouvoir. Sans doute ce pouvoir n’est-il pas à l’origine de la crise
économique qui violente une bonne partie de la population, mais sa
manière de la gérer est si évidemment au bénéfice exclusif de ses
responsables que ce comportement fait bien davantage violence
qu’une franche répression. L’injustice est tout à coup flagrante
entre le sort fait aux grands patrons et le désastre social généré par

2
la gestion due à cette caste de privilégiés, un simple clan et pas
même une élite.
La violence policière courante s’exerce sur la voie publique ;
la violence économique brutalise la vie privée. Tant qu’on ne reçoit
pas des coups de matraque, on peut croire qu’ils sont réservés à qui
les mérite, alors que licenciements massifs et chômage sont
ressentis comme immérités.D’autant plus immérités que
l’information annonce en parallèle des bénéfices exorbitants pour
certaines entreprises et des gratifications démesurées pour leurs
dirigeants et leurs actionnaires. Au fond, l’exercice du pouvoir
étant d’abord affaire de « com » (communication) et de séduction
médiatique, l’État et ses institutions n’ont, en temps ordinaire,
qu’une existence virtuelle pour la majorité des citoyens, et
l’information n’a pas davantage de consistance tant qu’elle ne se
transforme pas en réalité douloureuse. Alors, quand la situation
devient franchement difficile, la douleur subie est décuplée par la
comparaison entre le sort des privilégiés et la pauvreté générale de
telle sorte que, au lieu de faire rêver, les images « people »
suscitent la rage. Le spectacle ne met plus en scène qu’une
différence insupportable et l’image, au lieu de fasciner, se retourne
contre elle-même en exhibant ce qu’elle masquait. Brusquement,
les cerveaux ne sont plus du tout disponibles !
Cette prise de conscience n’apporte pas pour autant la clarté
car le pouvoir dispose des moyens de semer la confusion. Qu’est-ce
qui, dans la « Crise », relève du système et qu’est-ce qui relève de
l’erreur de gestion ? Son désastre est imputé à la spéculation, mais
qui a spéculé sinon principalement les banques en accumulant des
titres aux dividendes mirifiques soudain devenus « pourris ». Cette
pourriture aurait dû ne mortifier que ses acquéreurs puisqu’elle se
situait hors de l’économie réelle mais les banques ayant failli, c’est
tout le système monétaire qui s’effondre et avec lui l’économie.
Le pouvoir se précipite donc au secours des banques afin de
sauver l’économie et, dit-il, de préserver les emplois et la
subsistance des citoyens. Pourtant, il y a peu de semaines, la
ministre de l’économie assurait que la Crise épargnerait le pays,
puis, brusquement, il a fallu de toute urgence donner quelques
centaines de milliards à nos banques jusque-là censées plus
prudentes qu’ailleurs. Et cela fait, la Crise a commencé à balayer
entreprises et emplois comme si le remède précipitait le mal.
La violence ordinaire que subissait le monde du travail avec
la réduction des acquis sociaux s’est trouvée décuplée en quelques
semaines par la multiplication des fermetures d’entreprises et des
licenciements. En résumé, l’État aurait sauvé les banques pour
écarter l’approche d’un krach et cette intervention aurait bien eu
des effets bénéfiques puisque les banques affichent des bilans
positifs, cependant que les industries ferment et licencient en
masse. Qu’en conclure sinon soit à un échec du pouvoir, soit à un
mensonge de ce même pouvoir puisque le sauvetage des banques
s’est soldé par un désastre?
Faute d’une opposition politique crédible, ce sont les
syndicats qui réagissent et qui, pour une fois, s’unissent pour
déclencher grèves et manifestations. Le 29 janvier, plus de deux
millions de gens défilent dans une centaine de villes. Le Président
fixe un rendez-vous aux syndicats trois semaines plus tard et ceux-
ci, en dépit du succès de leur action, acceptent ce délai et ne
programment une nouvelle journée d’action que pour le 19 mars.
Résultat de la négociation : le « social » recevra moins du centième
de ce qu’ont reçu les banques. Résultat de la journée du 19 mars :
trois millions de manifestants dans un plus grand nombre de villes
et refus de la part du pouvoir de nouvelles négociations.

3
La crudité des rapports de force est dans la différence entre
le don fait aux banques et l’obole accordée au social. La minorité
gouvernementale compte sur l’impuissance de la majorité
populaire et la servilité de ses représentants pour que l’Ordre
perdure tel qu’en lui-même à son service. On parle ici et là de
situation « prérévolutionnaire », mais cela n’empêche ni les
provocations patronales ni les vulgarités vaniteuses du Président.
Aux déploiements policiers s’ajoutent des humiliations qui ont le
double effet d’exciter la colère et de la décourager. Une colère qui
n’agit pas épuise très vite l’énergie qu’elle a suscitée.
La majorité populaire, qui fut séduite et dupée par le
Président et son clan, a cessé d’être leur dupe mais sans aller au-
delà d’une frustration douloureuse. Il ne suffit pas d’être la victime
d’un système pour avoir la volonté de s’organiser afin de le
renverser. Les jacqueries sont bien plus nombreuses dans l’histoire
que les révolutions : tout porte à croire que le pouvoir les souhaite
afin de les réprimer de façon exemplaire. Entre une force sûre
d’elle-même et une masse inorganisée n’ayant pour elle que sa rage
devant les injustices qu’elle subit, une violence va croissant qui n’a
que de faux exutoires comme les séquestrations de patrons ou les
sabotages. Ces actes, spontanés et sans lendemain, sont des actes
désespérés.
Il existe désormais un désespoir programmé, qui est la forme
nouvelle d’une violence oppressive ayant pour but de briser la
volonté de résistance. Et de le faire en poussant les victimes à bout
afin de leur démontrer que leur révolte ne peut rien, ce qui
transforme l’impuissance en humiliation. Cette violence est
systématiquement pratiquée par l’un des pays les plus
représentatifs de la politique du bloc capitaliste : elle consiste à
réduire la population d’un territoire au désespoir et à la maintenir
interminablement dans cet état. Des incursions guerrières, des
bombardements, des assassinats corsent régulièrement l’effet de
l’encerclement et de l’embargo. Le propos est d’épuiser les victimes
pour qu’elles fuient enfin le pays ou bien se laissent domestiquer.
L’expérimentation du désespoir est poussée là vers son
paroxysme parce qu’elle est le substitut d’un désir de meurtre
collectif qui n’ose pas se réaliser. Mais n’y a-t-il pas un désir
semblable, qui bien sûr ne s’avouera jamais, dans la destruction
mortifère des services publics, la mise à la rue de gens par milliers,
la chasse aux émigrés ? Cette suggestion n’est exagérée que dans la
mesure où les promoteurs de ces méfaits se gardent d’en publier
clairement les conséquences. Toutefois à force de délocalisations,
de pertes d’emplois, de suppressions de lits dans les hôpitaux, de
remplacement du service par la rentabilité, d’éloges du travail
quand il devient introuvable, une situation générale est créée qui,
peu à peu, met une part toujours plus grande de la population sous
le seuil du supportable et l’obligation de le supporter.
Naturellement, le pouvoir accuse la Crise pour s’innocenter,
mais la Crise ne fait qu’accélérer ce que le Clan appelait des
réformes. Et il ose même assurer que la poursuite des réformes
pourrait avoir raison de la Crise… Les victimes de cette surenchère
libérale sont évidemment aussi exaspérées qu’ impuissantes, donc
mûres pour le désespoir car la force de leur colère va s’épuiser
entre un pouvoir qui les défie du haut de sa police, une gauche
inexistante et des syndicats prenant soin de ne pas utiliser l’arme
pourtant imbattable de la grève générale.
Pousser à la révolte et rendre cette révolte impossible afin de
mater définitivement les classes qui doivent subir l’exploitation
n’est que la partie la plus violente d’un plan déjà mis en œuvre
depuis longtemps. Sans doute cette accélération opportune a-t-elle
été provoquée par la Crise et ses conséquences économiques,

4
lesquelles ont mis de la crudité dans les intérêts antipopulaires de
la domination, mais la volonté d’établir une passivité générale au
moyen des media avait déjà poussé très loin son plan. Cette
passivité s’est trouvée brusquement troublée par des atteintes
insupportables à la vie courante si bien - comme dit plus haut –
que les cerveaux ont cessé d’être massivement disponibles. Il fallait
dès lors décourager la résistance pour que son mouvement rendu
en lui-même impuissant devienne le lieu d’une humiliation
exemplaire ne laissant pas d’ alternative à la soumission. Ainsi le
pouvoir économique, qui détient la réalité du pouvoir, dévoile sa
nature totalitaire et son mépris à l’égard d’une majorité qu’il s’agit
de maintenir dans la servilité en attendant qu’il soit un jour
nécessaire de l’exterminer.
1
/
4
100%