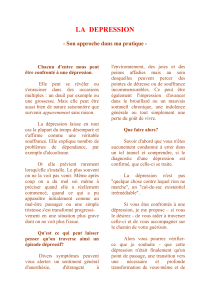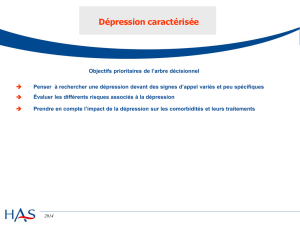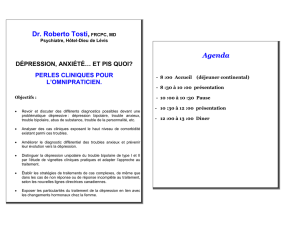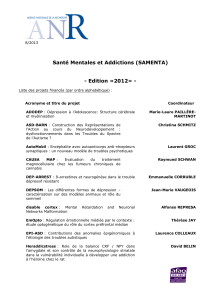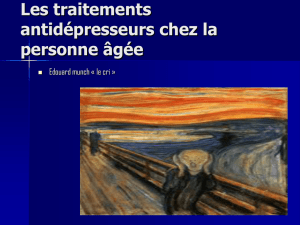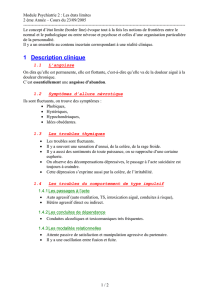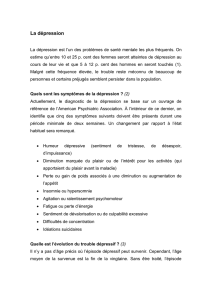Chapitre 9 – Dépression agraire et mutation

9 – La grande dépression 26/05/2017
Boris Bove, La France de la guerre de Cent Ans
1
Chapitre 9 – Dépression agraire et mutation industrielle
(XIVe-XVe siècles)
L’existence d’une grande dépression économique en France et plus généralement en
Occident à la fin du Moyen Âge fut une évidence pour les contemporains et, à leur suite, pour
les historiens. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à se pencher sur les souvenirs de jeunesse que
nous livre le chroniqueur normand Thomas Basin (né en 1412) dans son Histoire de Charles
VII qu’il acheva en 1472 :
Nous-mêmes, nous avons vu [vers 1422] les vastes plaines de la Champagne, de la
Beauce, de la Brie, du Gâtinais, du pays de Chartres, du pays de Dreux, du Maine et
du Perche, du Vexin tant français que normand, du Beauvaisis, du pays de Caux,
depuis la Seine jusque vers Amiens et Abbeville, du pays de Senlis, du Soissonnais et
du Valois jusqu’à Laon, et au-delà du côté du Hainaut, absolument désertes, incultes,
abandonnées, vides d’habitants, couvertes de broussailles et de ronces, ou bien dans la
plupart des régions qui produisent les arbres les plus drus, ceux-ci poussèrent en
épaisses forêts. Et, en beaucoup d’endroits on put craindre que les traces de cette
dévastation ne durassent et ne restassent longtemps visibles, si la divine providence ne
veillait pas de son mieux aux choses de ce monde. Tout ce que l’on pouvait cultiver en
ce temps là dans ces parages, c’était seulement autour et à l’intérieur des villes, places
ou châteaux, assez près pour que, du haut de la tour ou de l’échauguette, l’œil du
guetteur pût apercevoir les brigands en train de courir sus. Alors, à son de cloche ou de
tout autre instrument, il donnait à tous ceux qui travaillaient aux champs ou aux vignes
le signal de se replier sur le point fortifié. C’était là chose commune et fréquente
presque partout ; à ce point que les bœufs et les chevaux de labour, une fois détachés
de la charrue, quand ils entendaient le signal du guetteur, aussitôt et sans guide,
instruits par une longue habitude, regagnaient au galop, affolés, le refuge où ils se
savaient en sûreté. Brebis et porcs avaient pris la même habitude. Mais comme dans
les dites provinces, pour l’étendue du territoire, rares sont les villes et les lieux
fortifiés, comme en outre, plusieurs d’entre eux avaient été brûlés, démolis, pillés par
l’ennemi ou qu’ils étaient vides d’habitants, ce peu de terre cultivée comme en
cachette autour des forteresses paraissait bien peu de chose et même presque rien, eu
égard aux vastes étendues de champs qui restaient complètement déserts, sans
personne qui put les mettre en culture.
Thomas Basin écrit 50 ans après les faits à partir de souvenirs personnels : fils de marchands
aisés de Caudebec, il prit la fuite avec ses parents comme beaucoup de Normands devant
l’avance des Anglais en 1417, erra de ville en ville et ne revint dans son foyer qu’en 1419.
C’est l’économie du texte qui impose sa place en 1422, au moment de l’avènement officiel de
Charles VII au pouvoir : c’est un tableau de la France avant l’action qui est d’autant plus noir
que ce règne fut celui de la victoire sur les Anglais et du rétablissement de la paix et de la
prospérité. Le règne de ce roi fut donc celui de « la divine providence », par opposition à celui
de son fils avec lequel l’auteur a des comptes à régler. Son témoignage est toutefois corroboré
par les doléances des clercs (carte*), la chute du volume de la production céréalière en
Cambrésis ou des cens en pays de Caux qui sont le reflet de celle de la population. En
Normandie orientale, les cens passent de l’indice 65 à 37 au moment de l’exode entre 1418 et
1419. La ruine de la région est donc indubitable et la description de Thomas Basin d’autant
plus inquiétante que le pire est encore à venir : l’étiage démographique se situe, dans sa
région, après la reconquête française, en 1460 (voir graphique*, chap. 8). Cette impression de
désolation, qui l’a tant ému alors qu’il était enfant, contraste avec le paysage profondément

9 – La grande dépression 26/05/2017
Boris Bove, La France de la guerre de Cent Ans
2
humanisé qu’on a pu apercevoir en Île-de-France et plus généralement dans tout le royaume
en 1328. Le signe le plus évident de la crise de la fin du Moyen Âge, c’est la dépopulation et
son corollaire agricole, la réduction de la surface cultivée.
CARTE * – Dommages de guerre supportés par les diocèses français
d’après M. Bordeaux, Aspects économiques de la vie de l’Église…, fig. B
Cette carte dressée d’après les pouillés (déf*) et des décimes indique les régions les plus
ruinées. Ces sources ecclésiastiques étant nombreuses et uniformément réparties sur le
territoire elles dont une idée synthétique des destructions, dont elles soulignent l’inégale
répartition.
GRAPHIQUE * – Volume de la production de grains en Cambrésis
D’après H. Neveux, Histoire de la France rurale, Paris, 1975, II, p. 12
Si la crise est assurée, son mécanisme l’est beaucoup moins. Les historiens s’accordent
néanmoins pour constater qu’elle est grave, européenne, longue (les broussailles poussent sur
les friches les plus récentes, mais sur les plus anciennes, ce sont des forêts !) et entrecoupée de
phases de rémission. Ils s’accordent aussi à donner une place centrale à la démographie dans
ce processus. L’autre certitude, c’est qu’elle est avant tout agraire, dans un monde à 85 ou
90% rural et agricole, alors que la majeure partie de l’élite laïque (noblesse) et les gens
d’église vivent surtout des revenus de leurs seigneuries. C’est donc depuis les campagnes
qu’il faut tenter de comprendre le mécanisme de cette grande dépression qui affecte
l’économie, la démographie et la société.
Pour Thomas Basin, c’est la conquête anglaise entre 1417 et 1422 qui a provoqué la
mort, la ruine ou la fuite des gens du plat pays et une désorganisation politique engendrant de
l’insécurité. La cause est donc entendue pour lui comme pour la plupart de ses
contemporains : c’est la guerre qui est responsable de tous les maux. Les historiens modernes
en revanche sont moins certains d’avoir saisi les causes de la dépression. Le problème
principal n’est pas de comprendre pourquoi la population chute, mais pourquoi il n’y a pas de
récupération durable après chaque épreuve. On peut identifier deux facteurs structurels qui
combinent leurs effets néfastes pour entretenir une des plus graves dépressions de l’histoire de
France : un blocage de la croissance et une rupture démographique provoquée par les
épidémies et la guerre.
Le blocage de la croissance agricole
La croissance agricole des XIe-XIIIe siècles est fondée sur un cercle vertueux qui se
grippe à partir de la fin du XIIIe siècle, plongeant tenanciers et seigneurs dans la gêne, pour
des raisons différentes.
La mise en place d’un régime seigneurial aux XIe-XIIe siècles avait conduit le
tenancier à produire toujours plus, car il organisait librement son travail tout en reversant une
grande partie de sa production à son seigneur. Pour produire le surplus nécessaire à sa survie,
il était donc poussé à défricher (chap. 1). Cette croissance économique s’accompagna d’un
essor démographique lent et régulier qui en était à la fois l’effet et la cause. Le tenancier avait
aussi un autre moyen d’accroître la part qui lui revenait, c’était d’obtenir de son seigneur une
réduction des taxes qu’il lui versait et de les fixer une fois pour toute en argent. Les seigneurs
y consentirent d’autant plus volontiers au XIIe siècle qu’en réduisant leur ponction, ils
attiraient les tenanciers des seigneuries voisines et compensaient ainsi leur perte par un
accroissement du nombre d’exploitants. Par ailleurs, l’essor démographique soutenait la
demande et entraînait une augmentation régulière des prix agricoles, qui rendait intéressant le
défrichement de terres les moins fertiles.

9 – La grande dépression 26/05/2017
Boris Bove, La France de la guerre de Cent Ans
3
Au XIVe siècle, l’économie paysanne traditionnelle dominait, mais se portait mal.
Faute de nouvelles terres à conquérir, les tenanciers se trouvaient réduits à morceler leur
exploitation pour caser leurs fils. La solution à ce blocage passait par l’intensification des
cultures et certaines régions pionnières du Nord de la France, on l’a vu, exploraient avec
succès au début du XIVe siècle de nouvelles techniques agricoles. Leur diffusion est
cependant limitée par un certain nombre de freins. D’abord une limite écologique : les
techniques agricoles efficaces sur les terres lourdes des plateaux sédimentaires du Nord ne
l’étaient pas sur les sols légers et fragiles du Midi. Chaque région devait donc inventer les
solutions adaptées à son agriculture, mais l’innovation était entravée par un système
économique routinier qui ne poussait pas les cultivateurs à produire plus que le nécessaire à la
reproduction de leur exploitation ; or la croissance de la population se stabilisant vers 1300,
on peut imaginer qu’ils avaient trouvé dans la réduction, volontaire ou non, de leur
descendance une solution à la réduction de la taille de leur exploitation. Cela ne les incitait
donc pas, surtout en période d’équilibre comme au début du XIVe siècle, à risquer la disette
par des expériences hasardeuses, tandis que le système excluait le seigneur de la gestion
agricole alors qu’il était pourtant le seul capable de s’y risquer et d’investir dans des
équipements. Enfin, les tenanciers avaient trouvé une autre solution à leur paupérisation dans
l’emploi salarié saisonnier sur la réserve seigneuriale, mais ce palliatif était sans avenir, car le
seigneur s’appauvrissait aussi.
En effet l’économie seigneuriale commerciale n’est guère plus vaillante que
l’économie paysanne, car le seigneur voyait diminuer le revenu de ses redevances et de sa
réserve. Sa prospérité fondée sur l’accroissement régulier du nombre des tenanciers, se
trouvait compromise au XIVe siècle. Par ailleurs, l’inflation rampante faisait perdre
régulièrement de la valeur à ces taxes fixées en argent. Or elles représentaient 75% des
revenus seigneuriaux normands à la fin du XIVe siècle : l’arrêt des défrichements signifie
donc un appauvrissement mécanique du seigneur. Jusqu’au début du XIVe siècle, il pouvait le
compenser en vendant à bon prix l’essentiel de la production de sa réserve, mais l’évolution
des prix agricoles entra progressivement dans une phase baissière des années 1320 aux années
1460 sous l’effet de la stabilisation de la population, puis de sa baisse, de la fiscalité qui fait
baisser le pouvoir d’achat et de la contraction de la masse monétaire. Le manque d’espèces
résultait de leur usure mécanique, de perturbations dans la production minière d’argent, du
déficit commercial structurel avec l’Orient et, une fois la crise commencée, de la
thésaurisation du métal précieux sous forme de lingot ou de vaisselle précieuse. La famine
monétaire était évidente à la fin du XIVe siècle, alors que la décrue des hommes venait y
ajouter ses effets déflationnistes : on produisait moins, mais on produisait toujours trop au
regard du nombre d’enfants toujours plus faible que l’ont peut mener jusqu’à l’âge adulte et
de l’appauvrissement de la population. Le seigneur était d’autant plus pénalisé par la baisse
des prix agricoles que le prix de ce qu’il achetait (armes, vêtements, objets de luxe, services
domestiques, construction) restait stable ou augmentait sous l’effet de la hausse des salaires
après la peste. L’écart entre l’évolution des prix de produits agricoles et manufacturés
commençait à se creuser dès le début du XIVe siècle, mais s’accentua dans la seconde moitié
du siècle et dura jusqu’au milieu du XVe siècle.
GRAPHIQUE * – Evolution du prix des céréales en Europe de 1200 à 1900.
(Moyenne mobile de 7 ans, en grammes d’argent pour 100 kg.
GRAPHIQUE * – Prix du blé, du fer et salaires en Angleterre dans la seconde moitié du
XIVe siècle
(Valeur intrinsèque des sommes nominales, avec base 100 en 1301-1350)
D’après W. Abel, Les crises agraires en Europe (XIIIe-XXe siècle)…, p. 66, 88)

9 – La grande dépression 26/05/2017
Boris Bove, La France de la guerre de Cent Ans
4
GRAPHIQUE * – Salaires journalier sur le chantier de l’hôpital Saint-Jacques-aux-
Pélerins
D’après B. Geremek, Le salariat dans l’artisanat parisien, 1968, p. 123. Les salaires étant exprimés en monnaie
de compte, il est difficile d’évaluer l’influence des mutations monétaires contemporaines sur leur montant : on ne
sait si les ouvriers touchaient effectivement plus de pièces en période de dévaluation et moins de pièces en
période de réévaluation.
GRAPHIQUE * – Revenus affermés de la seigneurie du Plessis-Grammoire en Anjou
D’après M. Le Mené, Les campagnes angevines…, p. 473.
Au bout du compte, les seigneurs doivaient faire face à une réduction sévère de leurs
revenus sur la période : ainsi, ceux des dames de Nazareth en Aixois chutèrent de 40 à 60%
entre 1340 et 1424, ceux du comté de Longueville en Normandie de 70 à 75% entre 1316 et
1458, ceux de l’abbaye de Saint-Denis de 50 à 70%...
Il faut relativiser le rôle de la chute des revenus seigneuriaux dans le début de la
dépression, car leur baisse n’est qu’amorcée dans la première moitié du XIVe siècle et a été
considérablement aggravée par les perturbations démographiques qui frappèrent le pays à
partir de la seconde moitié du siècle. Toutefois cette évolution a eu son rôle dans le
mécanisme déclencheur de la dépression dans la mesure où elle a favorisé le recrutement des
armées. En effet, cette paupérisation menaçait beaucoup de nobles dans leur existence sociale,
surtout les plus modestes d’entre eux qui vivaient pour la plupart exclusivement des revenus
de la terre, sans bénéficier des profits de la seigneurie banale qui résistaient mieux. La petite
noblesse est donc beaucoup plus affectée par l’érosion des revenus seigneuriaux que la
moyenne et haute noblesse, car elle la menace directement dans son état social : comment
tenir son rang, comment justifier son appartenance à la noblesse lorsque les revenus ne
permettent plus de réparer la maison forte, de se vêtir assez richement, d’acheter les armes et
le cheval pour se battre afin d’affirmer sa distinction sociale ? Il ne leur reste plus qu’à
chercher une solde et d’hypothétiques rançons dans la guerre.
Il y a donc un ajustement au début du XIVe siècle de l’économie rurale à l’arrêt de la
croissance, mais les tenanciers peinent à fonder un nouvel essor sur l’intensification de la
production, tandis que l’appauvrissement de la petite noblesse vivant surtout des revenus
seigneuriaux laisse présager des bouleversements sociaux de grande ampleur. Ces ajustements
auraient probablement trouvé une issue moins catastrophique sans une exacerbation brutale
des contradictions propres à l’économie rurale sous l’effet de la chute démographique
provoquée par les épidémies, puis de la guerre.
Les effets des épidémies
De même que l’essor démographique a été un facteur de croissance économique, sa
chute a largement contribué à la décroissance. Or dans cette chute les épidémies, on l’a vu,
tiennent une place de choix.
La peste noire de 1347 ouvre une nouvelle ère, dans laquelle la peste revient
régulièrement, contribuant fortement à l’atonie démographique (voir chapitre*). Ce processus
était-il inéluctable ? Il est vrai que la peste arrive dans un contexte d’ajustement de la
population au plafonnement des ressources : la réapparition de graves crises de subsistance
liées à de mauvaises récoltes, comme en 1315-1317 en est le signe évident. Mais si la peste
est un effet de la surpopulation, on peut s’étonner de l’ampleur de la correction : la famine de
1315 n’a touché que l’Europe du Nord Ouest et n’a pas réduit la population de plus de 10%
dans les endroits les plus atteints, de même que celle qui frappe le Midi et la Navarre en 1347,
alors que la peste a touché toute l’Europe en enlevant au moins 35% des hommes. Il est
possible que ce contexte tendu ait accentué la létalité de la maladie, mais à n’en pas douter la

9 – La grande dépression 26/05/2017
Boris Bove, La France de la guerre de Cent Ans
5
peste est un facteur exogène : si son expansion quasi-planétaire a un sens, il ne faut pas le
chercher dans les faiblesses de l’économie française… patentes depuis 70 ans. Quant à la
récurrence du fléau, elle est d’abord due à son caractère d’épizootie : le bacille survit chez les
rongeurs et réapparaît dès que les conditions sont favorables à son développement. Il va de soi
qu’une fois le cercle vicieux de la décroissance amorcé, la faiblesse physique des populations
a été un terrain favorable pour toutes sortes d’épidémies, surtout dans la première moitié du
XVe siècle.
Quels ont été les effets économiques de la peste ? Si elle avait été une simple
correction à une situation de surpopulation, on aurait pu s’attendre à un mieux être général
après son passage. Il est vrai que la saignée a profité aux salariés qui, forts de leur nombre
réduit, ont pu imposer à leur employeur une hausse brutale des salaires, comme on peut le
constater pour les maçons parisiens, dont le salaire nominal journalier est passé de 30 à 95
deniers entre 1348 et 1359. Elle a profité aussi aux tenanciers qui purent agrandir un peu leur
exploitation par héritage s’ils appartenaient à des familles aisées, et surtout se concentrer sur
les terres les plus fertiles, ce qui permit quelques gains de productivité au sein d’une
agriculture traditionnelle. Toutefois les gens qui vivaient seulement de leur salaire formaient
une infime minorité de la population et on ne note pas une amélioration générale des
conditions de vie, bien au contraire. La récurrence des épidémies contribua à entretenir la
baisse de la population, ce qui avait un double effet pervers. La dynamique de baisse
démographique et la petite hausse de la productivité entretenaient une baisse tendancielle des
prix agricoles qui ruinait les cultivateurs commercialisant leur production, c’est-à-dire surtout
les seigneurs et une minorité de paysans riches, mais aussi par contre coup la masse des petits
paysans qui ne trouvaient plus dans le salariat saisonnier de complément de revenu.
Paradoxalement, les crises agricoles les plus fréquentes à la fin du Moyen Âge sont avant tout
des crises de mévente et de surproduction, parce que la tendance démographique, donc la
demande, est à la baisse. Si les crises de surproduction dominent, cela n’exclut pas des crises
de subsistance ponctuelles et violentes dues à des conditions climatiques inclémentes ou à des
perturbations du travail agricole par les épidémies et les guerres.
Les épidémies sont un facteur nécessaire de la dépression dans la mesure où elles sont
directement responsables de la chute de la population en 1348, alors que la guerre,
commencée une dizaine d’années avant, n’avait pas eu d’effet démographique visible. Sont
elles suffisantes à l’expliquer ? A l’évidence non, puisque la récurrence de la peste jusqu’en
1722 a été impuissante à enrayer la reprise démographique à partir du milieu du XVe siècle.
En outre, la chronologie des reprises qui ponctuent la grande dépression de la fin du Moyen
Âge varie selon les lieux, mais suit toujours de près celle des événements guerriers : en
Normandie orientale les phases d’accalmie guerrière de 1364-1410 et 1422-1435 sont propice
à une reconstruction économique et un redressement démographique (graphique*, chap.*) ;
l’Île-de-France connut aussi un répit entre 1465 et 1410, mais sombra sous les coups de la
guerre civile, de la domination anglaise et des épidémies jusqu’à la libération de la région par
Charles VII en 1441 ; en Bordelais la reprise de 1379-1403 est compromise par l’effort de
reconquête français en 1403-1405, celle de 1406-1437 annulée par les pillages de Ecorcheurs
puis la reconquête de 1438 à 1453. Il faut donc faire sa part à la guerre dans le processus de
dépression économique de la fin du Moyen Âge.
Les effets de la guerre
Autant la modification de la pathocénose médiévale fut un facteur exogène (et peut-
être accidentel), autant le développement de la guerre à l’échelle européenne était prévisible.
La guerre est en effet rendue nécessaire par le développement de l’État et de la souveraineté
royale, dont elle est une conséquence quasi mécanique. La guerre est doublement nécessaire
au développement de la monarchie française, parce qu’elle lui donne l’occasion d’éliminer ou
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%