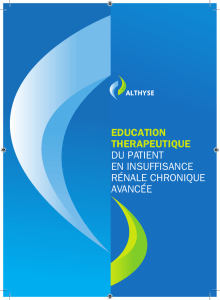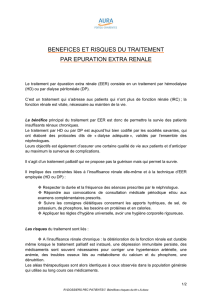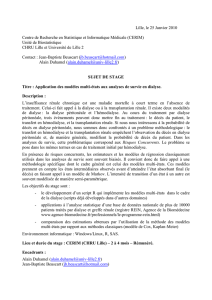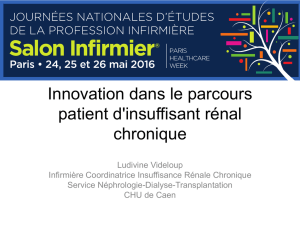4. Résultats en terme d`organisation de la prévention

B
BI
IL
LA
AN
N
D
DE
E
L
LA
A
M
MI
IS
SE
E
E
EN
N
Œ
ŒU
UV
VR
RE
E
D
DU
U
S
SR
RO
OS
S
1
19
99
99
9
–
–
2
20
00
04
4
P
PR
RI
IS
SE
E
E
EN
N
C
CH
HA
AR
RG
GE
E
D
DE
E
L
L’
’I
IN
NS
SU
UF
FF
FI
IS
SA
AN
NC
CE
E
R
RE
EN
NA
AL
LE
E
C
CH
HR
RO
ON
NI
IQ
QU
UE
E
TRAVAUX PREPARATOIRES AU SROS 3EME GENERATION
Chef de projet régional
M le Docteur Olivier JOSEPH
DRASS de Bretagne
e-mail : [email protected]

A.R.H. de Bretagne Document définitif – Octobre 2004
SROS II - Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique - Bilan 2
SOMMAIRE
1. LES ENJEUX ET LES PROBLEMATIQUES GENERALES ................................................. 3
2. ORGANISATION ET PILOTAGE DU DISPOSITIF ............................................................... 4
3. RESULTATS EN TERME D’ORGANISATION DE SOINS ................................................... 4
3.1. LES POPULATIONS PRISES EN CHARGE ..................................................................................... 5
3.1.1. Les nouveaux patients pris en charge (Patients Incidents) ............................................... 5
3.1.2. La population prise en charge une semaine donnée (Population prévalente) .................. 6
3.1.3. La population greffée ......................................................................................................... 7
3.1.4. Les mouvements entre les secteurs des populations dialysées (Taux de fuite et
d’attractivité) ............................................................................................................................... 7
3.1.5. Les différentes modalités de traitement (établies sur la base des 1.118 patients) ............. 8
3.2. LES DIFFERENTES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE ............................................................ 9
3.2.1. Les entités gestionnaires .................................................................................................... 9
3.2.2. Les Centre d’Hémodialyse et les Unités de Dialyse Médicalisée .................................... 10
3.2.3. La prise en charge de la dialyse pédiatrique ................................................................... 11
3.2.4. Les unités d’auto dialyse .................................................................................................. 12
3.2.5. Le problème particulier des séjours temporaires ............................................................ 12
3.2.6. Les Unités de suivi et/ou d’entraînement à la dialyse péritonéale .................................. 12
3.2.7. Les unités de suivi et / ou d’entraînement repli à l’hémodialyse ..................................... 13
3.2.8. Les abords vasculaires ..................................................................................................... 13
3.3. LES EQUIPES SOIGNANTES ...................................................................................................... 13
4. RESULTATS EN TERME D’ORGANISATION DE LA PREVENTION ............................ 14
4.1. PREVENTION SECONDAIRE ..................................................................................................... 14
4.2. RESEAUX ................................................................................................................................. 14
5. LES MOYENS FINANCIERS .................................................................................................... 15
6. DIFFICULTES OU FAIBLESSES DU DISPOSITIF .............................................................. 15
6.1. SUR UN PLAN GENERAL ........................................................................................................... 15
6.2. POUR CE QUI CONCERNE L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS ....................................... 15
6.3. POUR CE QUI CONCERNE L’ORGANISATION DE LA PREVENTION ........................................... 16
7. PERSPECTIVES ......................................................................................................................... 17
7.1. EN MATIERE D’ORGANISATION DES SOINS ............................................................................. 17
7.2. EN MATIERE DE PREVENTION ................................................................................................. 17
7.3. EN MATIERE D’ORGANISATION DU DISPOSITIF ...................................................................... 17

A.R.H. de Bretagne Document définitif – Octobre 2004
SROS II - Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique - Bilan 3
1
1.
.
L
LE
ES
S
E
EN
NJ
JE
EU
UX
X
E
ET
T
L
LE
ES
S
P
PR
RO
OB
BL
LE
EM
MA
AT
TI
IQ
QU
UE
ES
S
G
GE
EN
NE
ER
RA
AL
LE
ES
S
L’Insuffisance Rénale Chronique (IRC) est définie par une diminution permanente du débit de
filtration glomérulaire (DFG). Cette définition essentiellement physiologique et biologique a été
précisée par l’ANAES
1
. A l’origine de la maladie on retrouve les maladies vasculaires d’origine
athéromateuse et le diabète. Ces affections ont supplanté les causes plus spécifiquement rénales
(glomérulonéphrites), urologiques (malformations) ou congénitales.
Maladie susceptible d’évoluer de façon silencieuse pendant de nombreuses années, elle nécessite la
mise en place de thérapeutiques lourdes et contraignantes, quand la fonction rénale est durablement
et sévèrement altérée. Les thérapeutiques de suppléance de cette fonction rénale sont la greffe et les
différentes techniques d’épuration extra rénale qui font appel à l’hémodialyse et à la dialyse
péritonéale. L’hémodialyse consiste à assurer l’élimination des toxines et le maintien de l’équilibre
hydroélectrolytique au moyen d’un échange entre le sang du patient et une solution de dialyse au
travers de membrane semi-perméable utilisant un circuit extra corporel. Cette technique doit être
réalisée en moyenne à raison de 3 séances de 4 à 5 heures par semaine. Elle est assurée dans des
centres spécifiques ou au domicile du patient, voire dans des substituts de domicile comme les
unités d’autodialyse quand les patients ont été spécialement entraînés à l’auto-réalisation de la
séance.
La dialyse péritonéale consiste, sur le même principe, à utiliser la cavité péritonéale du patient en
lieu et place du circuit extra corporel, la membrane péritonéale faisant office de membrane de
dialyse. Cette technique nécessite l’utilisation de poches de solutés qui sont alternativement
introduites puis « vidangées » au sein de la cavité péritonéale soit de façon manuelle (Dialyse
Péritonéale Continue Ambulatoire ou DPCA), soit de façon automatisée à l’aide d’un cycleur
(Dialyse Péritonéale Automatisée – DPA), le rythme d’introduction des poches étant en moyenne de
4 par 24 heures.
La description des techniques de suppléances traduit en elle-même les contraintes qui pèsent sur les
malades auxquelles il faut ajouter le développement de complications non négligeables
(conséquences sur le système vasculaire, hématologique ou ostéo-articulaire).
S’ajoute à cela un coût de revient non négligeable de la maladie estimé en 2000 à plus de 1.5
milliards d’euros, soit 2 % de la totalité des dépenses de santé. Le coût moyen annuel d’un patient
dialysé représente environ 60.000 euros. Le même coût est imputable à la première année de
réalisation d’une greffe rénale pour baisser ensuite à 9.000 euros par an.
En 2003, on estimait en France le nombre de patients traités par une méthode d’épuration extra
rénale (EER) à plus de 30.000 (soit une prévalence de 513 par million d’habitants) et à plus de
20.000 le nombre de patients porteurs d’un greffon fonctionnel. Chaque année ce sont plus de 7.000
nouveaux patients qui doivent avoir recours aux différentes techniques d’EER.
Les données concernant le nombre de patients vivant avec une insuffisance rénale chronique sont
mal connues, compte tenu du caractère incertain de la définition de la maladie, de son caractère
silencieux et de l’absence de dépistage systématique. Certaines études estiment le nombre de
patients porteurs d’une IRC à plus de 2 millions de patients soit 3 % de la population française, avec
des proportions beaucoup plus importantes bien évidemment dans les catégories de populations à
risques (diabétiques, hypertendus) ou dans des groupes de populations (patients de plus de 60 ans).
1
« Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte », ANAES, septembre 2002

A.R.H. de Bretagne Document définitif – Octobre 2004
SROS II - Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique - Bilan 4
2
2.
.
O
OR
RG
GA
AN
NI
IS
SA
AT
TI
IO
ON
N
E
ET
T
P
PI
IL
LO
OT
TA
AG
GE
E
D
DU
U
D
DI
IS
SP
PO
OS
SI
IT
TI
IF
F
La prise en charge de l’IRC a fait l’objet d’un volet spécifique du SROS Bretagne de 2ème
génération publié le 30 juin 1994. Une coordination régionale, sur la base d’un Comité Technique
Régional, pour suivre la mise en œuvre du schéma et la mise sur pied d’un système d’information
régional sur les maladies rénales, était recommandée.
Le Comité Technique Régional s’est mis en place le 10 novembre 2000 et s’est doté d’un bureau
avec un président et un vice-président. Ce comité s’est réuni de une à deux fois par an en assemblée
plénière et plus fréquemment en bureau dans le but de suivre la mise en œuvre du SROS (compte
rendu des COTER disponibles sur le site internet de l’ARH).
Les premiers travaux qui lui ont été soumis ont été ceux de la préparation de la carte sanitaire
publiée le 24 juillet 2001 et révisée le 8 octobre 2003 permettant l’évolution de l’offre de soins
durant cette période encore marquée par un régime d’autorisation d’appareils assez contraignant
avant que la publication des décrets de septembre 2002 n’y mette fin.
Des groupes de travail ont été constitués autour des questions suivantes :
IRC et prévention ;
IRC et abords vasculaires ;
IRC et organisation des séjours temporaires.
Le système d’information régional concernant la population traitée par une méthode d’épuration
extra rénale s’est mis en place avec la constitution d’une association rassemblant néphrologues et
responsables d’établissements : l’association Breizh Rein [BR] (officiellement constituée le
1/07/2001). Le système de recueil et de transmission informatique via le système Mégalis est
maintenant opérationnel. L’exhaustivité du recueil est assurée depuis décembre 2003. Un comité
chargé de valider les données et de produire une synthèse en routine des informations est
opérationnel. Le système Breizh Rein a désormais rejoint le système national et un contrôle de
qualité des données sera mis en place pour l’année 2004.
3
3.
.
R
RE
ES
SU
UL
LT
TA
AT
TS
S
E
EN
N
T
TE
ER
RM
ME
E
D
D’
’O
OR
RG
GA
AN
NI
IS
SA
AT
TI
IO
ON
N
D
DE
E
S
SO
OI
IN
NS
S
Le précédent schéma faisait de la prévention une priorité absolue, confiant aux néphrologues en
coordination avec les autres acteurs (médecins généralistes, spécialistes, structures et associations)
le soin d’organiser un centre de référence, au niveau d’un centre hospitalier sur une base sectorielle,
chargé d’assurer la néphrovigilance et la coordination des acteurs. Prévention primaire, dépistage et
prise en charge précoce étaient promus par la mise en œuvre de centre de néphrovigilance (lieu de
référence), de consultations avancées et de structures pluridisciplinaires de prévention, d’évaluation
et de traitement de la maladie artérielle.
La prise en charge des soins se concevait sur la base d’une politique sectorielle et de la mise en
place d’un réseau « hiérarchisant l’offre de soins » en s’appuyant sur une typologie médico-sociale
des patients. Les notions de centres « lourds » et « allégés » étaient définies. La priorité était mise
sur le développement de la transplantation et des alternatives à la dialyse en centre dont chaque
secteur devait être doté. La problématique de la dialyse en soins de suite et en structures d’accueil
pour personnes âgées était également posée.

A.R.H. de Bretagne Document définitif – Octobre 2004
SROS II - Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique - Bilan 5
Les éléments de bilan sont issus :
Des données de Breizh Rein (BR) présentées lors du COTER du 10 décembre 2003. Ces données
faisaient état de la situation au 30 juin 2003 Des données de l’enquête CNAMTS-DHOS qui se
présentait en 2 volets, d’une part une enquête de type « patient » qui s’est déroulée sur la
semaine du 2 au 8 juin 2003 et d’autre part une enquête de type « structure » ;
Des données de la SAE dont il a été établi un bilan de 1999 à 2002 (dernière année disponible) ;
Des discussions issues des réunions du COTER et des réunions de bureau à l’occasion de la
présentation de ces bilans.
Les informations issues de ces enquêtes et/ou systèmes appellent les précautions d’interprétation
suivantes :
Les données de Breizh Rein n’étaient pas encore totalement exhaustives au 30 juin 2003. Les
informations arrêtées au 30 décembre 2003, le seront et viendront compléter le bilan actuel et
constituer le point de référence pour le suivi du présent volet. Les informations issues de BR
concernant l’incidence (les nouveaux patients) sont plus fiables que celles présentées dans
l’enquête CNAMTS-DHOS (système exhaustif dans l’enquête Breizh Rein / méthodologie
moins précise ou basée sur des extrapolations pour l’enquête CNAMTS-DHOS).
Dans le volet « patient » de l’enquête CNAMTS-DHOS les informations concernant les
appréciations des néphrologues sur les modalités de prise en charge observées et souhaitables des
patients sont d’interprétation difficile (critères de jugement très « équipe dépendante »). Il en est
de même mais à un degré moindre des simulations qui ont été construites sur ces modes de prise
en charge optimales à partir des données de co-morbidité et des niveaux de dépendance.
Les éléments des bilans relatifs au volet « structure » de l’enquête CNAMTS-DHOS ont les
mêmes limites d’interprétation que celles déjà notifiées pour l’exploitation de la SAE (absence
de définition suffisamment précise et univoque). Les informations globales retirées de ces
systèmes restent toutefois valides.
N’ont été repris dans ce document que les principales informations. L’ensemble des données de
l’enquête CNAMTS / DHOS sera publié dans un document spécifique.
Les systèmes d’informations existants et les enquêtes sus nommées ne représentent que l’activité de
dialyse. Cette dernière ne prend pas en compte la totalité des activités exercées par les néphrologues
ou les services à orientation néphrologique.
3.1. LES POPULATIONS PRISES EN CHARGE
3.1.1. Les nouveaux patients pris en charge (Patients Incidents)
Les données du système Breizh Rein révèlent un nombre de nouveaux patients enregistrés entre
juillet 2002 et juillet 2003 de 289 soit une incidence de 98 pmh. Cette estimation apparaît plus
fiable que celle de l’enquête CNAMTS / DHOS qui la retrouvait à 92 pmh (sous déclaration des
nouveaux cas et estimation sur 5 mois) et plus fiable que celle de l’EFG qui estime l’incidence en
Bretagne à 130.7 pmh (extrapolation à partir des données d’incidence de 4 régions).
La population incidente présente les caractéristiques suivantes :
- âge moyen de 65 ans,
- une biopsie rénale réalisée dans 25 % des cas,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%