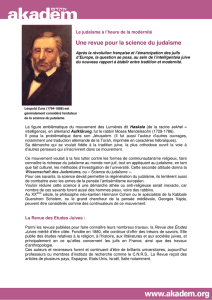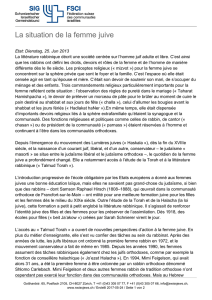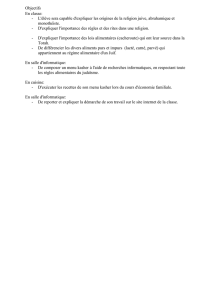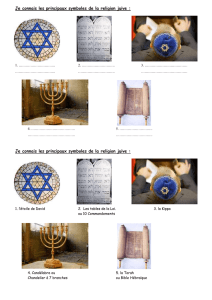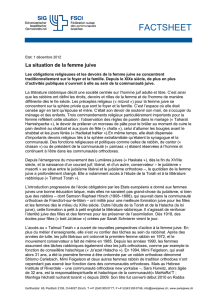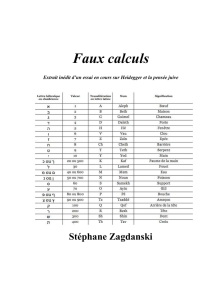La pensée éducative juive dans l`après- guerre 1914-1918

« C’EST DE L’ANGOISSE DEVANT LA
MORT QUE PROCÈDE TOUTE
CONNAISSANCE »
RÉFLEXION SUR LA PENSÉE ÉDUCATIVE
JUIVE DANS LES APRÈS-GUERRES
DENIS POIZAT1
Après l’affaire Dreyfus, la guerre de 1914-1918
constitue une expérience capitale pour le senti-
ment de réaffiliation des Juifs à la nation française.
Ce faisant, la guerre infléchit l’éducation juive qui
ne se contient pas dans la seule observance reli-
gieuse mais au cœur d’une tradition scripturaire
envisageant le monde et la connaissance sous un
tour original. Ainsi distingue-t-on diverses fa-
cettes d’une théorie de la connaissance, Saadia
Gaon précurseur de Maïmonide, est de ce point
de vue un théoricien important2. L’éducation juive
est-elle versée dans le conservatisme, obstinément
restauratrice d’un ordre ancien ? Nous pourrions le
penser tant le renouveau du judaïsme religieux
semble répondre au désordre des conflagrations.
Mais l’ordre n’a-t-il pas déjà été profondément
bousculé par le courant des Lumières juives, la
Haskalah, au cours du dix-huitième siècle ?
L’interrogation centrale de cette contribution
est la suivante : comment la guerre a-t-elle rema-
nié l’éducation juive dans le sens du renouveau du
judaïsme religieux3 ? Notre hypothèse affirme qu’il
y a eu remaniement de nature philosophique de la
pensée et de l’éducation juives ; cela s’est produit
massivement suite à la seconde guerre mais ce
mouvement était amorcé dès après la première
guerre mondiale à la faveur d’un terreau intellec-
tuel favorable, celui d’une filiation étirée que l’on
doit à des philosophes préoccupés par l’étude
juive. C’est ce dont nous débattrons ici en sollici-
tant quelques-uns de ces philosophes plus connus
pour leur affiliation au néo-kantisme et à l’école
de Marbourg que pour leur réflexion sur l’éduca-
tion juive.
La biographie autant que la pensée de ces au-
teurs nous permet de comprendre leurs choix et
leurs influences, il s’agit de Franz Rosenzweig, Ja-
1 MCF HDR, Université de Lyon.
2 Hayoun M.-R., 1996, Les Lumières de Cordoue à Berlin. Une
histoire intelllectuelle du judaïsme, T. 1, p. 142 et suiv.
3 L’expression « judaïsme religieux » n’est pas un pléonasme. L’on
peut être juif et athée.
cob Gordin, Emmanuel Lévinas, Walter Benja-
min, Gershom Sholem. Quelle relation ces « pen-
seurs de la pensée juive » ont-ils entretenu avec les
conflits du siècle passé ? En toile de fond, une
autre question : comment concilier éducation et
historicité ? La première puis la seconde guerre
ont révélé l’impérieuse exigence de l’étude dépas-
sant la seule perspective patrimoniale juive. Nous
verrons comment le concept de dissimilation em-
prunté à Franz Rosenzweig traduit cette tendance
confortée par les deux guerres. Il s’agit en effet
d’un mouvement profond de désenchantement
vis-à-vis de la culture occidentale à laquelle, pour-
tant, le judaïsme s’était largement associé sur le
plan éducatif dès la création de l’Alliance Israélite
au 19e siècle. Désenchantement mais aussi désen-
gagement car, en effet, comme y insiste Rosenz-
weig, il s’agit de se délier d’un mythe, celui d’une
alliance trompeuse parce qu’insuffisante et exclu-
sive avec la raison. À Rosenzweig encore nous
empruntons le titre de cette contribution car en
effet, éduquer et connaître ne peuvent s’affranchir
de la frayeur de la guerre. L’effroi est la réalité
pré-réflexive par excellence. Il est, nous dit Sté-
phane Moses, le symptôme de l’expérience collec-
tive de la guerre. Rosenzweig en parle
comme « d’une brèche aveugle ouverte dans nos
vies »4. C’est une épistémè donc, renouant avec la
« science de la balance5 » que sollicitent et ali-
mentent vigoureusement les mouvements d’édu-
cation juive de l’entre-deux guerres et de l’après
seconde guerre.
L’ÉPREUVE DÉCISIVE DE 1914-1918 POUR
LE SENTIMENT DE RÉAFFILIATION DES
JUIFS À LA NATION FRANÇAISE.
Les Juifs de France ont été contraints
d’attendre l’abbé Grégoire et la Révolution fran-
çaise pour obtenir la citoyenneté française. Les ré-
formes napoléoniennes (décret de Bayonne, créa-
tion du Consistoire) en ont certes amélioré l’inté-
gration sociale et intellectuelle car l’on vient de
Pologne, d’Allemagne et de Russie vérifier qu’on
peut vivre « heureux comme un Juif en France ».
Au dix-neuvième siècle, après l’affaire Mortara6,
4 Moses S., L’ange de l’histoire. Rosenzweig, Benjamin, Scholem,
Paris, Seuil, 1992, p. 37
5 J’emprunte cette expression au philosophe Dariush Shayegan,
La Lumière vient de l’Occident, Paris, L’Aube, 2001
6 Un enfant juif du Piémont fut baptisé contre l’accord des
parents, enlevé puis éduqué comme catholique. On en fit un
Ce texte est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Vous devez citer le nom de
l’auteur – Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France.

2
véritable ébranlement de la conscience juive,
l’affaire Dreyfus déchire à son tour le sentiment
d’une intégration lentement tissée. La Grande
Guerre constitue une épreuve supplémentaire
dans le processus de réappartenance des commu-
nautés juives à la nation française.
Philippe Efraïm Landau a montré les enjeux
de reconnaissance nationale des Juifs des deux cô-
tés du Rhin. Juifs de France et d’Allemagne7, tous
sont patriotes.
Au déclenchement de la Grande Guerre, l’on
compte en effet 180 000 Juifs en France, Algérie
comprise, 480 000 outre Rhin. Ils se font face
même si, marque du tropisme exercé par la
France, 600 Juifs alsaciens passent du côté fran-
çais. En France, l’engagement de 36 000 hommes,
rejoints par 8500 Juifs étrangers dont beaucoup de
volontaires est au sens propre la mise en gage de
l’allégeance des Juifs à la nation. Les engagés juifs
français combattent ainsi contre 90 000 Juifs alle-
mands. Ces derniers redoutent les pogromes
russes et ont, eux aussi, le même désir de « mériter
de la patrie ». En France, Barrès rend hommage
aux communautés juives en 1916 dans son étude
sur « les différentes familles spirituelles de la
France ». La Torah, écrit alors le Grand Rabbin,
est au service d’une cause sacrée, celle de la dé-
fense de la patrie. La femme juive, consolatrice du
combattant et ardente gardienne du sentiment na-
tional est célébrée par le Grand Rabbinat sous la
double figure de Deborah et de Jeanne d’Arc.
L’Affaire Dreyfus est, semble-t-il alors, dépassée :
les Juifs, écrit Emmanuel Levinas « gardèrent
moins le souvenir du fait qu'en pleine civilisation
une injustice ait été possible que du triomphe
remporté par la justice… De leur face émanait
comme un rayonnement ». L’éducation juive, dès
lors, une fois repris le cours de l’existence de
l’après-guerre, une fois supportées les grandes pé-
ripéties de l’Histoire, peut perpétuer son œuvre.
Mais de quelle éducation juive s’agit-il ?
L’ÉDUCATION JUIVE
Faisant appel à l’histoire ancienne, Robert
Hannoun8 en repère plusieurs traits en dépit du
manque de traces matérielles objectives. Ils se
tirent essentiellement des références scripturaires
(Talmud de Jerusalem et de Babylone, Thora) qui
présentent des affirmations de valeurs (interdits,
prêtre catholique.
7 Landau P.-E., Juifs français et allemands dans la Grande
Guerre, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, Année 1995, Volume
47, no 47, p. 70 – 76.
8 Hannoun H., L’éducation aux temps bibliques, Paris, Honoré
Champion, 2008
obligations), des affirmations d’existence (récits,
descriptions), des affirmations imaginaires (allégo-
ries) qui constituent les traces qu’une éducation
spécifiquement judéenne puis juive s’est inscrite
dans un vaste héritage que la guerre et les plaies de
l’Histoire viennent réactiver à différentes périodes.
Que sont aujourd’hui les centres d’études bi-
bliques, les Talmud Thora ? Sont-ils, ces centres,
les perpétuateurs d’une antique tradition, souvent
orale, de l’étude des textes bibliques ? Dans le ju-
daïsme primitif, rassemblements populaires pour
les fêtes et synagogues du retour d’exil de Baby-
lone sont essentiellement des lieux de rencontre
mais où le sofer, le scribe, joue également le rôle
d’enseignant et de transmetteur. Il le fait d’ailleurs
essentiellement dans des centres d’études ; « Faites
de nombreux élèves… » lit-on dans le Talmud de
Babylone. Le Beth (maison) Ha Sefer (du Livre)
créé par Siméon Ben Schatach est une école dont
le modèle va se répandre plus tard, sous le règne
d’Agrippa II (début du premier siècle de l’ère vul-
gaire), notamment lorsque pour la première fois
on oblige chaque cité judéenne à installer une
école ouverte à tous. Le Talmud de Babylone s’en
fait l’écho à plusieurs reprises. En somme, édu-
quer dans la tradition juive consiste pour le moins
à transmettre la loi mosaïque aux enfants et aux
adultes. L’éducation devient un ciment identitaire,
idéologique et spirituel d’un petit peuple. Est-il
besoin de solliciter Salomon Ben Isaac, dit Rachi,
qui enseigne bien plus tard le talmud à ses filles,
ou bien avant lui Maïmonide dont on dit qu’il est
« l’instituteur des Juifs » ? Est-il besoin d’en appe-
ler à la tradition talmudique du pilpoul (la discus-
sion contradictoire) pour dire qu’existe consub-
stantiellement attachée au judaïsme une tradition
éducative juive qui pourrait bien être tout simple-
ment une éducation juive ?
Cette éducation juive a été considérablement
marquée par les exils successifs du peuple. La
forme d’abord orale puis écrite des Talmidim
comme leur étude dépendent de l’Histoire. S’il a
fallu consigner par écrit les leçons des sages, les
Hakhames, dispersés en diaspora, il a fallu pour
les enseigner en conserver les commentaires, puis
les commentaires des commentaires au fil desquels
toute l’analyse exégétique se complexifie. L’His-
toire et particulièrement l’histoire guerrière, a
maille à partir avec la forme et le fond de l’éduca-
tion juive. La guerre et l’exil qui l’accompagnent
(destruction par deux fois du Temple) participent
ainsi du fondement lointain de l’étude juive.
Certes, c’est aller bien vite que de balayer ainsi
plusieurs millénaires d’éducation juive. Par
ailleurs, cette éducation religieuse juive a large-
ment été « contaminée » par la modernité des Lu-

3
mières tenues pour responsables de l’affadissement
du judaïsme religieux. Les Lumières juives, qu’on
appelle la Haskalah auraient organisé la mise au
pas d’une tradition éducative attachée à l’étude des
Textes. Il conviendrait peut-être de tempérer
l’idée selon laquelle le judaïsme religieux aurait
abdiqué devant la raison occidentale et sombré
sous les assauts de la Haskalah.
LA HASKALAH N’EST PAS UN ABANDON DU
JUDAÏSME RELIGIEUX
Si l’œuvre philosophique de Moses Mendels-
sohn semble avoir déposé le judaïsme sur les voies
des Lumières, Aufklarung et Haskalah réunies,
cette union des Lumières était-elle si franche ?
Peut-on affirmer que Mendelssohn avait en son
temps liquidé le judaïsme religieux européen ? Les
différents moments de l’émancipation des Juifs
sont décrits par le philosophe Jacob Toury9 mais
ils conduisent à leur absorption pure et simple :
rapprochement, adaptation, partage de la citoyen-
neté, intégration, fusion, dissolution. Ce processus
qui aurait pu conduire le judaïsme et les Juifs à
l’assimilation a été évité par Mendelssohn.
D’abord initié à la philosophie et à la pensée juive
par Gotthold Ephraïm Lessing, on surnomme ra-
pidement Moses Mendelssohn le « Platon alle-
mand » ou le « Socrate de Berlin ». Fénelon le cite
dans le « Dialogue des morts », Mendelssohn cor-
respond avec Kant à qui il ravit la première place
au concours de la classe de philosophie spéculative
de l’académie de Berlin tandis que Mirabeau, de-
puis la France, en établit la biographie. Il est cité
en bonne place au sein du pendant allemand de
l’Encyclopédie, le Allgemeine Deutsche Bibliothek,
organe quasi officiel de l’Auflkarung.
Toutefois l’association de la pensée de Men-
delssohn aux Lumières juives laisserait penser que
le judaïsme se serait par une forme d’adhésion de
principe affilié à la voix des Lumières euro-
péennes. Il aurait bradé rites et héritage ; il se se-
rait converti au passage à une alliance molle avec
le catholicisme. Plutôt qu’en professeur de Tal-
mud, on peint Mendelssohn ici en liquidateur de
la tradition juive et là en convertisseur du sabbat
en messe dominicale. Le judaïsme se socialise. Il
se civilise à l’idée du siècle, madame de Staël
confie à Henriette, l’épouse de Mendelssohn, les
compliments qu’elle écrit sur le philosophe. Men-
delssohn le moderne, telle est un peu plus tard
l’appréciation de Ernest Renan : « Les hommes
illustres que le judaïsme fournira désormais à l’his-
9 Toury J., Die Judische Presse Im Osterreichischen Kaiserreich Ein
Beitrag Zur Problematik Der Akkulturation 1802-1918, Berlin,
Mohr Siebeck, 1983
toire de la philosophie puiseront leur inspiration
non dans la tradition d’une philosophie nationale
mais dans l’esprit moderne lui-même ». Alors
« Onkel Moses » comme on l’appelle deviendrait
le saint patron du judaïsme allemand si l’on ne re-
levait pas comme le fait Dominique Bourel10
l’acrimonie des mouvements hassidiques et même
des courants sionistes du XIXe siècle. Le mouve-
ment HaBaD (Hokhma : sagesse ; Bina intelli-
gence ; Daat : savoir) en Russie, par exemple, s’y
oppose11. Jérusalem ne compte au reste aucune rue
du nom du philosophe. Parmi les penseurs du ju-
daïsme, Hermann Cohen ou Franz Rosenzweig
prendront en bonne part la pensée de Mendels-
sohn. Plus exactement, ils prendront à leur
compte la justification de l’observance religieuse
qu’expose Mendelssohn car Haskalah ou non,
Mendelssohn est un Juif observant. Et c’est bien
là, en effet, que doit se nuancer la comparaison
des Lumières avec les Lumières juives. Toute la
tradition rationaliste juive, comme le montre
Maurice Ruben Hayoun est depuis le judaïsme
médiéval une pénétration des instruments des ca-
tégories de la raison et une rationalisation des in-
terprétations allégoriques ou littérales. Maïmonide
pense avec les catégories d’Aristote, écrit en arabe
et prie en hébreu écrit Maurice Ruben Ayoun12.
Ainsi, faut-il voir en l’apport de Mendelssohn
un double hommage : un hommage au judaïsme
et un hommage à l’étude. À ses yeux comme à
ceux de la tradition juive, l’éducation est le fonde-
ment de la culture et de la société juives : « Le
monde ne tient que par la respiration de ses élèves
(Sanh. 119 b). Fils du bedeau de la synagogue,
Mendelssohn est bercé par les bénédictions et les
prières juives. Son père, scripteur sacré (Sofer) re-
copie les rouleaux de la Torah pour les mezouzot et
les tefillins. Loin de ce piétisme, « La synthèse
maïmonidienne définit l’univers mental, philoso-
phique et religieux du jeune Mendelssohn » écrit
D. Bourel13. Il reste que Mendelssohn, tout pen-
seur de la haskalah qu’il est, est un Juif religieux et
c’est en fonction de son « Jérusalem » traduit en
plusieurs langues dès le dix-neuvième siècle que se
définissent tous les courants du judaïsme européen
depuis lors. Cet écrit, souligne Dominique Bou-
rel14, offre « la charte du judaïsme moderne et
fonde même une philosophie du judaïsme et la
10 Bourel D., Moses Mendelssohn. La naissance du judaïsme mo-
derne, Paris, Gallimard, 2004, p. 30.
11 Goldberg H.-E., Une tradition d’invention. Familles et insti-
tutions éducatives parmi les Juifs traditionnalistes contemporains,
in Benbassa E., Transmission et passages en monde juif, Paris, Pu-
blisud, 1997, p. 526.
12 Hayoun M.-R., Maïmonide ou l’autre Moïse, Paris, J.-C. Lat-
tès, 1994.
13 Bourel D., ibidem, p. 65.
14 Bourel D., ibidem, p. 305.

4
philosophie juive allemande dont la fin est mar-
quée par L’étoile de la Rédemption de Franz Ro-
senzweig en 1921 ». Rosenzweig apparaît en effet
comme l’un des plus vigoureux artisans intellec-
tuels parachevant le renouveau du judaïsme reli-
gieux. La guerre exerce sur lui un effet qui se ré-
vèle catalyseur d’une éducation juive certes reli-
gieuse mais libérée de la bigoterie à la suite de
Mendelssohn. Ce dernier est en rupture avec son
temps lorsqu’il annonce sa conviction éducative
tendue vers deux directions : « Actions et convic-
tions appartiennent à la perfection de l’homme et
la société doit, autant que possible, par des efforts
communs, s’occuper des deux, c’est-à-dire diriger
les actions des membres en vue du bien commun
et provoquer les convictions qui conduisent à ces
actions. Ceci est le gouvernement, cela l’éducation
de l’homme social. L’homme est conduit vers les
deux par des principes, c’est-à-dire vers les actions
par des principes d’action et vers les convictions par
des principes de vérité. Grâce aux institutions pu-
bliques, la société doit disposer des deux ». Si la
principale charge de l’État est l’éducation, pour
Mendelssohn, celle-ci se mêle à l’aufklarung – les
Lumières – mais elle s’allie aussi au catholicisme
prusse de son époque et, au-dessus de tout, à
l’idéal de l’étude de la tradition juive. Au sortir des
deux guerres, des penseurs comme Gordin, Lévi-
nas, Sholem et Rosenzweig amplifieront le dernier
terme de l’héritage Mendelssohnien, celui de
l’étude juive. Le renouveau du judaïsme religieux
est donc moins à comprendre comme un retour au
piétisme qu’un retour à l’étude biblique et talmu-
dique. Étude et résistance s’unissent ainsi dans un
modèle éducatif particulier.
L’ÉDUCATION JUIVE COMME MARQUEUR DE
« RÉSISTANCE BIBLIQUE »
Contraintes de se cacher en zone libre au cours
de la Seconde Guerre, les communautés juives
françaises15 perpétuent en le transformant dans
des conditions de violente hostilité le courant ini-
tié à la suite de la première guerre pour les mouve-
ments de jeunesse. Le scoutisme juif (éclaireurs is-
raélites) et, de moindre ampleur, le mouvement
Shema Israël (Écoute Israël) sont alors les mar-
queurs d’une résistance contre la déjudaïsation des
jeunes Juifs de France de l’après première guerre
mondiale. M. Liber introduit dès avant la Se-
conde Guerre des éléments de pédagogie pour
l’éducation juive, mêlant retour à l’étude et activi-
tés récréatives mobilisant en cela des personnalités
15 Voir pour les détails le chapitre de Grynberg A. et Nicault C.,
Le Consistoire central en France sous l’occupation, in Benbassa
E., Transmission et passages en monde juif, Paris, Publisud, 1997.
telles que Jacob Kaplan ou Edmond Fleg.
Nombre de ces mouvements se retrouveront pen-
dant la Seconde Guerre hébergés dans différents
lieux de la zone non occupée. Robert Gamzon,
l’un des responsables des éclaireurs israélites,
pointe en 1941 pas moins de 10 000 jeunes Juifs
encadrés dans des cercles d’étude juifs. Le change-
ment, notent A. Grynberg et C. Nicault, s’opère
alors : « Non que les Éclaireurs aient tous, tant
s’en faut, renoué alors avec la foi et la pratique
juives. Mais elles progressent très nettement dans
leurs rangs, notamment dans ces communautés de
vie que sont les maisons d’enfants et les fermes.
Dans les premières, les éducateurs souvent à l’ori-
gine très éloignés du judaïsme, évoluent vers une
approche plus juive de l’éducation. »16 Le mouve-
ment de retour vers le judaïsme religieux est décrit
par Johannah Lehr qui a conduit pour sa thèse
une recherche minutieuse des mouvements d’édu-
cation juifs de l’après seconde guerre. Elle y établit
que la stratégie du renouveau du judaïsme reli-
gieux correspond à un fait de résistance contre la
barbarie nazie et collaborationniste. Il est d’abord
inscrit dans l’action commune de Marc Bloch par
exemple ou des jeunesses juives communistes
(Union de la Jeunesse Juive). Cette résistance
commune mute en résistance spirituelle. En
même temps que les acteurs de cette résistance
spirituelle participent au maquis, ils activent le le-
vier de l’éducation et de l’étude des textes : « Une
corrélation – jusqu’alors passée inaperçue – lie ain-
si l’expérience de la guerre et de la Résistance aux
renaissances du judaïsme en France après la se-
conde Guerre mondiale. Plus particulièrement,
elle rattache la Résistance juive à la naissance des
écoles juives modernes après 1945 en France » af-
firme-t-elle17. Ces écoles s’émancipent partielle-
ment du piétisme – que combattent Emmanuel
Lévinas comme les philosophes et théologiens qui
l’ont formé intellectuellement – et des structures
religieuses ; « Affranchies de la tutelle des rabbins
consistoriaux, elles peuvent désormais choisir de
délivrer un enseignement du judaïsme incluant des
références à la sphère non religieuse. La moderni-
té de ces écoles porte à la fois sur le contenu des
études juives, volontairement ouvertes sur la cité,
sur une conception moins rigide de la pratique re-
ligieuse et sur l’importance accordée au dévelop-
pement individuel des élèves avec l’adoption de
méthodes importées de la pédagogie nouvelle »18.
Cela n’affranchit pas pour autant ce judaïsme-là
de l’apprentissage et de l’étude de la Thora, des
16 Grynberg A. et Nicault C., ibidem, p. 272.
17 Lehr J., 2013, La Thora dans la cité. L’émergence d’un nouveau
judaïsme religieux après la seconde guerre mondiale, Paris, Le bord de
l’eau, p. 10.
18 Lehr J., ibidem, p. 11.

5
petits et grands prophètes, des Écrits, des cinq
rouleaux, du Talmud et de la confrontation de ces
apports à la pensée philosophique non juive.
Vieille tradition en vérité puisque la pensée juive a
très tôt su s’approprier et discuter les Grecs. C’est
peut-être cette proximité au reste entre la pensée
classique et le judaïsme qui va être bousculée du
fait de la guerre par les philosophes tels que Ben-
jamin, Gordin, Rosenzweig et Lévinas. Non qu’ils
contestent l’importance des Grecs, ils en célèbrent
plutôt l’intérêt, ils entendent toutefois rééquilibrer
les sources et les matrices pour la formation intel-
lectuelle des jeunes.
En tout cas, selon J. Lehr, « il existe un lien
profond entre la Seconde Guerre mondiale, mar-
quée par la collaboration de la France aux persécu-
tions antijuives et le processus de sortie du franco-
judaïsme ; ce lien contribue à la sortie de la clan-
destinité des Juifs à la Libération et la sortie du ju-
daïsme hors du modèle très dix-neuvième siècle de
l’Israélite français. Les divers projets éducatifs nés
pendant la guerre portent en effet tous la marque
de la rupture avec le modèle sociopolitique du pas-
sé. La trajectoire des hommes et des idées agrégés
autour des études et de l’éducation juives présente
la caractéristique d’autonomiser peu à peu le ju-
daïsme français d’après-guerre du modèle culturel
dominant en Occident, hérité d’Athènes et de
Rome, vers lequel il se tournait auparavant »19.
Cela n’a rien de théorique, J. Lehr relève l’exis-
tence de différents mouvements bien concrets
d’éducation juive. Les Éclaireurs israélites de
France, outre qu’ils participent aux combats armés
au sein de compagnies de résistance, se regroupent
dans la clandestinité pour recréer un réseau. Le
Yechouroun est un mouvement de jeunesse reli-
gieux alsacien d’où naît en 1942 une école secon-
daire juive placée sous la responsabilité d’un rab-
bin. À Toulouse, David Knout fonde le mouve-
ment Main forte et crée un cercle d’études bi-
bliques tandis qu’à Limoges, en septembre 1942,
le mouvement du judaïsme alsacien édifie un sé-
minaire délocalisé en France libre, le Petit Sémi-
naire Israélite de Limoges qui influencera bien
après-guerre l’éducation juive. Cet univers est
donc celui des « petites yechivas planquées » de la
résistance juive, elles offrent la possibilité de
l’étude biblique, la pratique du shabbat, les cours
d’hébreu. Ces quelques exemples parmi bien
d’autres permettent d’affirmer que la fin de la
clandestinité au sortir de la guerre correspond en
France à la fin de la confidentialité de la « pensée
juive », au sens où l’entend le philosophe Armand
Abécassis. L’école juive, insiste J. Lehr est une
19 Lehr J., ibidem, p. 11
« réinvention émergeant de la guerre »20. Mouve-
ments de jeunesse et d’éducation se conjuguent
ainsi avec la pensée de philosophes et théologiens.
C’est dans ce contexte qu’évolue Jacob Gordin
qui sera professeur à l’école des cadres de
l’Alliance israélite orientale dirigée par Emmanuel
Lévinas. Des philosophes tels qu’André Néher ou
Léon Askenazi tracent la ligne d’un renouveau de
la pensée et de l’éducation juives. Ainsi se com-
prend l’influence du retour aux textes, à leur exé-
gèse à la manière de Jacob Gordin enseignant
l’étude talmudique à Emmanuel Levinas après
avoir soutenu une thèse de philosophie à Berlin.
Marié à Rachel Zeiber, éducatrice de jeunes en-
fants, ce couple sera marqué par la pensée éduca-
tive. Jacob Gordin, rappelle J. Lehr, récuse
« l’alliance recherchée par Maïmonide et Spinoza
du judaïsme et de la raison occidentale ; il multi-
plie les incursions dans la mystique juive »21. Les
contacts établis entre le philosophe Gordin et le
mouvement des éclaireurs israélites de France fon-
dé par Robert Gamzon remontent à l’entre-deux
guerres. Dans un texte qu’il lui consacre, Emma-
nuel Lévinas y insiste : Jacob Gordin est celui « à
qui revient un rôle important dans la renaissance
de la conscience juive en France »22.
Il est complexe de séparer les influences intel-
lectuelles où se mêlent « La personnalité » de
Gordin, le « personnalisme » d’Emmanuel Mou-
nier et les traces de l’enseignement d’Hermann
Cohen dont Gordin fut l’élève. Cela s’observe
dans l’activité de Jacob Gordin que la guerre
contraint à se cacher sans l’empêcher d’enseigner
en Corrèze puis en Haute Loire et outre qu’il cô-
toie dans ses planques l’érudit André Chouraqui
et l’écrivain Albert Camus, il transmet sa vision de
la vie juive à des jeunes et moins jeunes ; parmi ses
auditeurs se compte Gamzon. Dès la fin de la Se-
conde Guerre, Jacob Gordin forme les cadres édu-
catifs des éclaireurs israélites de France dans un
moment où cendres de la guerre et reconstruction
« fusionnent » comme l’indique Johannah Lehr
dans l’étude des Textes. On se reportera pour cela
à son étude très renseignée comme aux témoi-
gnages remarquables sur Jacob Gordin des philo-
sophes et théologiens André et Renée Néher,
d’Emmanuel Levinas, de André Chouraqui23.
L’une des phrases favorites de Gordin, rapporte le
couple Néher, était cette citation translittérée de
la Genèse 42-1 « Yesh shever be mitsraim », il y a
20 Lehr J., ibidem, p. 48
21 Lehr J., ibidem, p. 21
22 Lévinas E., « Jacob Gordin » in Gordin J., Écrits. Le renouveau
de la pensée juive en France, Paris, Albin Michel, 1995, p. 294
23 En fin d’ouvrage Gordin J., Écrits, Le renouveau de la pensée
juive en France, Paris, Albin Michel, 1995.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%