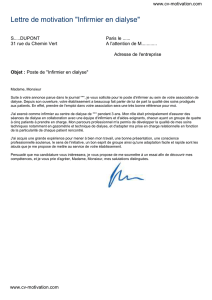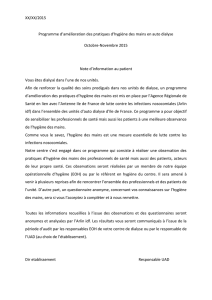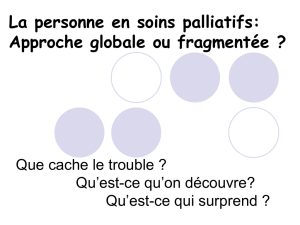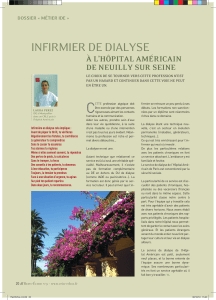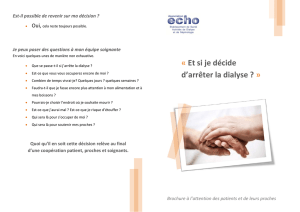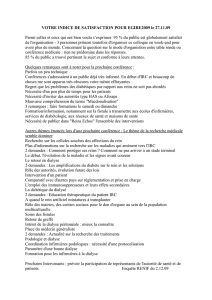Mise en place de directives anticipées dans un service de dialyse

2308 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
23 novembre 2011
introduction
La dialyse est associée à une importante
mortalité annuelle et de nombreux patients
en hémodialyse sont dans leur dernière
année de vie.1 Cependant, pour différentes
raisons, une approche intégrant mieux cette
perspective est peu courante et les mesu-
res proposées pour l’aborder encore insuf-
fisantes. Une réflexion s’impose pour opti-
maliser la prise en charge de ces patients.
Dans cette optique, nous avons remarqué
que quasiment aucun patient dialysé n’a ré-
digé de directives anticipées précisant les
limites des thérapies agressives accepta-
bles pour lui en cas d’urgence vitale.
Les directives anticipées (DA) ont été dé-
veloppées dans les années 70 et leur der-
nière révision date de 2011 (pour la Suis-
se).2 Leur origine est double, d’une part
elles s’inscrivent dans l’exigence du droit à
une «mort digne» sans acharnement théra-
peutique, mais elles sont également l’ex-
tension du droit à l’autodétermination des
patients, notamment du droit de refuser
des soins non désirés.3 Les DA actuelles
se focalisent largement sur ce refus – ce
que le patient ne veut pas qu’on lui fasse –
et peu sur ce qu’il aimerait qu’on lui fasse.
Aux Etats-Unis, depuis 1991, une ordon-
nance, the
Patient self-determination act
(PSDA) ordonne à tous les acteurs de la
santé de rendre attentif le patient à la possi-
bilité de rédiger des DA. Malheureusement,
l’impact de cette ordonnance est quasi nul.
En effet, seulement 10% de tous les pa-
tients ont des DA et ce taux est encore plus
faible chez les patients dialysés parmi les-
quels la mortalité peut être supérieure à
10% par année.
En 1995, l’étude SUPPORT a examiné
environ 10 000 patients hospitalisés avec
une mortalité attendue de 47% à six mois.4
Elle a pu montrer que la moitié des patients
décédaient dans la douleur, en recevant
des traitements dont ils ne voulaient pas.
Chez les patients en insuffisance rénale
terminale, le refus de l’initiation ou de la
poursuite de la dialyse est une des causes
de mortalité.5 Même s’il peut paraître diffi-
cile de comprendre pourquoi des patients
bénéficiant déjà d’un traitement d’épuration
extrarénale les gardant en vie artificielle-
ment pourraient vouloir refuser des soins
aigus en cas d’urgence vitale, cela peut
arriver. Il est donc important de leur per-
mettre d’exprimer leurs priorités. C’est par-
fois également plus facile de le faire dans
ce contexte où un suivi chroni que donne
lieu à une re lation thérapeutique plus sou-
tenue que dans certains autres services
hospitaliers. Le temps à disposition durant
un traitement de plusieurs heures est par
ailleurs plus important que dans la plupart
des consultations ambulatoires. La dialyse
est donc à la fois un contexte particulière-
ment favorable à l’aide à la rédaction de DA,
et une circonstance où offrir une telle aide
est important.
Cet article a pour but d’exposer comment
nous avons mis en place la possibilité de
rédiger des DA dans un service de dialyse
chronique.
dialyse chronique
La dialyse rénale ou épuration extraré-
nale est un processus artificiel qui accom-
plit les deux fonctions principales des reins
sains, à savoir filtrer en épurant le sang des
déchets du métabolisme azoté et équilibrer
les niveaux de liquides en éliminant l’eau en
excès. Si la dialyse est arrêtée, le décès du
patient est probable en quelques jours ou
quelques semaines. Les deux différents
types de dialyse sont l’hémodialyse (HD) où
le sang est filtré à travers une membrane
artificielle et la dialyse péritonéale (DP) où
la filtration s’effectue au niveau du péritoine,
une membrane naturelle située à l’intérieur
de l’abdomen.
Le traitement type d’un patient en HD
comprend trois séances de quatre heures
(douze heures) par semaine, soit le matin,
soit l’après-midi, les lundi, mercredi et ven-
dredi ou les mardi, jeudi et samedi. Il faut
ajouter à cela, les transports au centre de
dialyse et les éventuels autres traitements
liés aux multiples comorbidités.
Pour les patients en DP, le traitement se
fait à domicile et est quotidien ; des échan-
ges sont effectués au minimum quatre fois
par jour. Un traitement continu sur la nuit à
l’aide d’une machine est également pos-
sible.
A travers ces quelques notions, on peut
se rendre compte de l’importance que prend
le traitement de substitution extrarénale dans
la vie d’un patient dialysé. De même, on peut
facilement imaginer l’implication importante
de celui-ci dans sa prise en charge. Il nous
paraissait dès lors naturel de lui proposer
de rédiger ses DA.
historique local
En janvier 2005, un groupe est formé
dans le Service de néphrologie des Hôpi-
taux universitaires de Genève (HUG) pour
réfléchir à des questions éthiques suite à
une demande aussi bien infirmière que mé-
dicale. Formé de membres de l’équipe de
dialyse, ce groupe a pour but de fournir un
espace de discussion plus approfondie sur
les difficultés éthiques rencontrées au quo-
tidien. Dans un deuxième temps, il sera re-
joint par la consultante d’éthique du Conseil
d’éthique clinique des HUG. La première
réunion a lieu en février 2005 et traite de
dialyse palliative et déjà de DA. Une en-
quête est réalisée auprès du corps médical
et infirmier sur la dialyse palliative avec des
résultats qui sont présentés en mai 2007.
Mise en place de directives
anticipées dans un service
de dialyse chronique :
mode d’emploi
réflexion
V. Bourquin
P. Lefuel
B. Cassagne
L. Borgniat
C. Rastello
A. Yamani
P.-Y. Martin
S. Hurst
Drs Vincent Bourquin, Pascale Lefuel,
Brigitte Cassagne, Laurence Borgniat,
Catherine Rastello et Ada Yamani
Pr Pierre-Yves Martin
Service de néphrologie
Département des spécialités
de médecine
Pr Samia Hurst
Conseil d’éthique clinique
HUG, 1211 Genève 14
Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 2308-11
44_47_35864.indd 1 17.11.11 09:49

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
23 novembre 2011 2309
Le groupe de réflexion se penche alors
sérieusement sur les directives anticipées
à partir de septembre 2007 et établit un
modèle d’entretien initial pour les patients
souhaitant rédiger des DA, ainsi qu’une stra-
tégie pour identifier ces patients sans qu’ils
se sentent pour autant contraints. La pre-
mière étape est la publication d’un article
dans le journal
di@lisez
destiné aux patients
dialysés (http://nephrohug.com/patients/
journal-dilysez). Les entretiens avec les pa-
tients pour les DA commenceront en dé-
cembre 2007 sur le modèle décrit ci-après.
Actuellement le groupe éthique comprend
cinq infirmières de dialyse, un néphrologue
et une bioéthicienne. Il se réunit au minimum
quatre fois par année.
modèle d’entretien
En ce qui concerne l’identification des
patients susceptibles d’être intéressés et
capables de rédiger leurs DA, la littérature
propose des modèles d’approche systé-
matique. Davison et coll. ont identifié six
conditions indispensables à la rédaction de
DA : 1) la capacité a être impliqué dans la
discussion ; 2) un intérêt pour la démarche ;
3) une capacité de contrôle et d’affirmation ;
4) une compréhension du bénéfice de cette
rédaction ; 5) des ressources suffisantes et
6) l’identification possible du représentant
thérapeutique.6
Nous décrivons ici le modèle d’entretien
que nous utilisons dans notre Service, ainsi
que les raisons qui ont motivé chacun de
ses éléments.
Tout d’abord, nous discutons ensemble
pour savoir quel patient est à même de rédi-
ger ses directives anticipées. Si le patient
présente une pathologie psychiatrique aiguë,
nous attendons que la situation s’améliore
avec l’aide de notre psychiatre et réévaluons
régulièrement la situation. S’il présente un
problème somatique aigu, nous attendons
également que la situation s’améliore.
Nous avons, pour l’instant, évité de mener
des entretiens avec des patients ne parlant
pas correctement le français. Nous som-
mes attentifs à la culture de nos patients et
les encourageons à s’exprimer sur ce sujet.
Nous avons à disposition une consultation
transculturelle à laquelle nous pouvons avoir
recours.
Le soutien à la rédaction des DA est ef-
fectué par les membres du groupe éthique.
Chaque entretien a lieu lors de la dialyse où
le patient est isolé dans une chambre à un
lit. Lors de l’entretien, le néphrologue ainsi
qu’une ou deux infirmières sont présents.
Le patient est, selon son désir, accompa-
gné d’un proche qui participe à la discus-
sion.
Nous choisissons de ne pas faire venir le
patient hors d’une séance de dialyse afin
de ne pas lui ajouter un déplacement, sa-
chant qu’il vient déjà trois fois par semaine
en dialyse. Nous pensons que cette con-
trainte supplémentaire aurait peut-être dé-
couragé certains de nos patients à faire
des DA. Le prérequis est que la séance de
dialyse doit bien se passer et être bien sup-
portée (pas d’hypotension artérielle ou de
malaise durant celle-ci, par exemple).
Quand un patient est identifié comme
apte à rédiger ses directives anticipées,
nous voyons avec lui s’il est intéressé à le
faire. Une information orale lui est donnée
lors d’une séance de dialyse et des docu-
ments écrits lui sont remis (http://directives
anticipees.hug-ge.ch). Il est encouragé à
en parler avec ses proches.
Nous retournons ensuite vers lui pour
voir s’il est toujours intéressé. Si c’est le cas,
un rendez-vous est organisé avec le patient
et ses proches, le néphrologue et les infir-
mières.
Lors de cette deuxième approche, nom-
breux sont les patients qui demandent un
délai de réflexion ou qui refusent (à peu
près la moitié). Un autre cas de figure est le
patient qui prend rendez-vous et qui annule
au dernier moment, ou qui demande un nou-
veau délai.
L’entretien dure environ une heure. Nous
expliquons pourquoi nous proposons des
directives anticipées et débutons générale-
ment en demandant s’il y a des questions à
propos de la documentation. Nous laissons
le patient s’exprimer sur ce qu’il a compris.
Ensuite, l’entretien n’est pas structuré mais
nous l’encourageons à s’exprimer sur un
certain nombre de points : réanimation car-
dio-pulmonaire, notion de coma, don d’or-
gane, ventilation artificielle, alimentation arti-
ficielle, entourage, expérience personnelle,
représentant thérapeutique, acharnement
thérapeutique…
Il est étonnant de voir que la plupart de
nos patients ne voudraient pas être reliés à
une machine pour vivre (respirateur, par
exemple). Par contre, la machine de dialyse
n’est pas considérée de la même manière.
Quand nous faisons cette réflexion au pa-
tient, celui-ci nous répond souvent : «ce n’est
pas pareil !». Il est toujours crucial d’explo-
rer les termes employés par un patient : deux
personnes qui déclarent «ne pas vouloir de
tuyaux» peuvent avoir des idées très diffé-
rentes en tête.
Nous incitons nos patients à rédiger eux-
mêmes leurs directives anticipées et à ne
pas utiliser des formulaires préremplis. Ce-
ci peut être fait avec les proches et/ou avec
notre aide lors des séances de dialyses
suivantes.
Cela permet de préciser certains points
par écrit et d’ainsi éviter les malentendus
sur les termes employés (tableau 1). Nous
pensons que cette réflexion supplémen-
taire est bénéfique et permet des DA plus
personnelles. Avec l’accord du patient, nous
relisons ses DA au sein du groupe éthique
Autonomie du patient
Droit du patient à l’autodétermination, qui repose sur sa capacité décisionnelle dans les choix thérapeutiques
Coma végétatif
Abolition complète des fonctions mentales (conscience, mobilité volontaire et sensibilité) alors que les fonc-
tions de la vie végétative sont relativement conservées (le patient respire spontanément, mais n’est
conscient de rien)
Directives anticipées
Une maladie ou un accident peut vous rendre incapable de dire aux professionnels de santé qui vous pren-
dront en charge comment vous voulez être soigné. Les directives anticipées sont l’expression écrite par
avance de votre volonté sur le type de soins que souhaiteriez recevoir ou non dans des situations données
et au cas où vous ne seriez plus en mesure de vous exprimer par vous-même. Cette démarche est volon-
taire et non obligatoire (Loi genevoise sur la santé, art. 47, 48 et 49)
Dialyse = épuration extrarénale
Voir paragraphe dialyse chronique
Mort cérébrale
Etat de cessation complète et définitive d’activité cérébrale où les fonctions vitales (respiration/circulation)
ne sont maintenues que par des moyens artificiels
Représentant thérapeutique
Porte-parole au cas où le patient ne peut plus s’exprimer. Il est chargé de faire respecter les choix et
valeurs du patient
Acharnement thérapeutique
Attitude qui consiste à utiliser tous les moyens thérapeutiques pour garder une personne en vie sans réfé-
rence à la situation et en perdant de vue les objectifs cliniques de cette personne
Tableau 1. Quelques définitions
Il s’agit de termes qui sont revenus le plus souvent dans les discussions et pour lesquels il a fallu s’entendre
sur la définition.
44_47_35864.indd 2 17.11.11 09:49

2310 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
23 novembre 2011
afin de relever d’éventuelles ambiguïtés et
de lui permettre de les clarifier.
Nous les informons qu’ils peuvent chan-
ger d’avis à tout moment, qu’ils doivent garder
l’original aisément accessible et remettre
une copie à leur représentant thérapeutique.
Nous gardons une copie dans le dossier
médical de dialyse et une autre peut être
ajoutée au dossier patient intégré (DPI) de
notre hôpital. Le représentant thérapeutique
doit autant que possible être associé à la
démarche, et doit dans tous les cas con-
sentir à ce rôle.
quelques chiffres
Durant la période de décembre 2007 à
décembre 2010, 201 patients ont été dialy-
sés dans notre centre. Il y a eu 43 décès,
soit une mortalité de 7,2% par an inférieure
à ce que l’on retrouve dans la littérature.1
Quarante-cinq patients ont été évalués, soit
un peu moins d’un quart (22,3%) du collec-
tif. Parmi eux, un cinquième (20%) a rédigé
des directives anticipées, près de la moitié
a refusé ou s’est abstenue (51%), 16% sont
en attente d’entretien et 13% ont reçu l’in-
formation préalable (figure 1). La propor-
tion de patients qui ne sont pas intéressés
par les DA (refus ou abstention) est impor-
tante puisque cela représente un patient
sur deux. Nous pensons toutefois que le fait
de l’avoir proposé, et de le proposer en-
core dans le futur, suscitera une réflexion
chez ces patients. De plus, ils peuvent ainsi
identifier des personnes ressources qui se-
ront à leur disposition quand ils décideront
de rédiger des DA.
exemples
Cas clinique 1
Il s’agit d’une patiente de 72 ans, en
hémodialyse depuis quatre ans pour une
insuffisance rénale terminale sur hydro-
néphrose bilatérale secondaire à une ra-
diothérapie pour un carcinome de l’uté-
rus. Elle a bénéficié, neuf ans auparavant,
d’une importante opération chirurgicale
pour un carcinome utérin, suivie de chi-
miothérapie et de radiothérapie. Elle souf-
fre depuis de diarrhées chroniques inva-
lidantes sur colite radique. A l’âge de 71
ans, on lui découvre un carcinome du sein
pour lequel elle est également opérée.
Durant l’information préalable pour les
DA, elle nous signale qu’elle fait partie
d’EXIT, dans l’idée d’avoir la possibilité
éventuellement un jour de recourir à l’as-
sistance au suicide. Après discussion, il
nous apparaît clairement que cette dé-
marche n’est pas similaire aux DA. En ef-
fet, la patiente doit être consciente pour
avoir recours à l’assistance au suicide,
alors que les DA s’appliquent justement
dans le cas où la patiente deviendrait in-
capable de discernement.
Voici ses directives anticipées :
«Le jour où mon état de conscience ne
me permettra plus de prendre de dé-
cision pour moi-même, je soussignée
Mme… demande après mûres réflexions
et en pleine possession de mes moyens,
que soient respectées les dispositions
suivantes :
• être réanimée, ce qui permettra d’éva-
luer mon état physique et psychique. Si
mon état ne s’améliorait pas, et s’il y avait
souffrance cérébrale avec des lésions
irréversibles (tel un coma dépassé), je ne
souhaite pas être sous l’assistance d’un
respirateur et que l’on prolonge ma vie ;
• si toutefois mon état de dépendance
était tel que je doive être admise dans
une structure de long séjour où je n’au-
rais plus aucune autonomie (mobilité,
alimentation), je refuse que l’on prolonge
ma vie dans ces conditions ;
• je souhaite que l’on soulage mes dou-
leurs au maximum.
Mon représentant thérapeutique est
untel».
Ce document est conservé dans son
dossier médical et la patiente décédera
une année plus tard dans un autre hôpital.
Cas clinique 2
Il s’agit d’un patient de 80 ans en hé-
modialyse depuis quatre ans pour une
insuffisance rénale terminale sur néphro-
angiosclérose. Il est connu pour une
cardiopathie ischémique, hypertensive,
valvulaire et rythmique, différents épi-
sodes d’infections, un ulcère duodénal
et une goutte.
Il est de confession juive et fera ses
direc tives anticipées en présence de son
épouse.
«Le jour où je ne pourrai plus prendre
une décision moi-même, je soussigné
Mr… demande après mûres réflexions
et en pleine possession de mes facul-
tés, que soient respectées les disposi-
tions suivantes :
• bien que ma conviction religieuse m’in-
terdise d’abréger ma vie, je ne souhaite
pas que celle-ci soit prolongée par l’as-
sistance de machines, maintenant artifi-
ciellement mes fonctions vitales, en l’ab-
sence de tout espoir de réversibilité.
Mon représentant thérapeutique est
mon épouse».
Ce document est conservé dans son
dossier médical. Le patient fera quel ques
années plus tard de nombreuses com-
plications pour lesquelles il demandera
que l’on arrête la dialyse. Sa famille s’op-
posera à cette décision, principalement
pour des raisons religieuses, et il sera
dialysé jusqu’à la fin de sa vie.
Ces deux situations cliniques permettent
de constater que des confusions terminolo-
giques et des amalgames ont pu être mis
en lumière et élucidés par l’équipe soignante
grâce à la rédaction de DA. Premièrement,
la différence entre la notion d’autodélivrance,
terme employé par l’association EXIT pour
désigner l’assistance au suicide et les DA.
Le second point mis en évidence ici est
l’importance des croyances religieuses de
nos patients et la place que celles-ci peu-
vent prendre en fin de vie. Finalement, le
deuxième cas illustre également à quel point
un avis, même contraire, de membres de la
famille d’un patient peut peser lourd lors de
décisions de fin de vie.
discussion
L’accessibilité à l’information qui est ainsi
donnée aux patients pour faire des choix
thérapeutiques, ainsi que la réflexion susci-
tée par ces entretiens nous paraissent de
loin les aspects les plus importants de cette
démarche. La mise en place de DA dans
notre Service de dialyse chronique, nous a
permis d’aborder une dimension de la rela-
tion thérapeutique qui nous était largement
inconnue. La dialyse est un domaine très
Figure 1. Répartition des patients
évalués pour des directives anti-
cipées
13%
Directives anticipées
Refus
Réflexion
Attente
16% 20%
51%
44_47_35864.indd 3 17.11.11 09:49

technique de la médecine, où il peut être fa-
cile de se contenter de chiffres pour dire
que tout va bien. Mais les domaines de la
médecine où, comme en dialyse, la prise
en charge est plus chronique, sont égale-
ment des lieux idéaux pour demander, non
pas comment va votre dialyse, mais
com-
ment allez-vous ? Comment vivez-vous
cela ? Comment voyez-vous l’avenir ? Et si
cela va moins bien ?
Ces simples ques-
tions permettent d’ouvrir la discussion avec
nos patients sur des dimensions impor-
tantes de la maladie, qui incluent le fait
qu’elle peut déboucher sur la mort et ainsi
parler de la mort avec eux.
Une réflexion est nécessaire en amont
de la mise en place de DA. Celle-ci nous a
permis de nous préparer à élargir ainsi le dia-
logue avec nos patients, et également d’avoir
quelques idées sur comment aborder et re-
cevoir ces discussions. Cette étape nous
semble être essen
tielle et incontournable,
peu importe ensuite le modèle choisi. En
effet, il faut être à même d’entendre des his-
toires de vie difficiles pour lesquelles des
changements médicamenteux n’auront pas
d’impact. Dans cette démarche, il était utile
d’avoir à nos côtés une personne extérieu re
au service, une bio éthicienne, qui nous sou-
tient dans cette démarche et nous aide aussi
parfois à accepter que dans certains cas
l’empathie est la seule réponse que nous
pouvons apporter. Nous pensons que la
possibilité de rédiger des DA devrait être
offerte à tous les patients avec une mala-
die chronique et qu’avec un minimum de
moyens, une telle démarche est tout à fait
envisageable au sein d’une équipe hospita-
lière participant au suivi de ces patients.
conclusion
La mise en place de DA dans un service
de dialyse chronique est possible et devrait
être proposée à tous les patients néces-
sitant un tel traitement. Néanmoins, cette
mise en place nécessite que les soignants
établissent les conditions nécessaires pour
aborder cette problématique avec les pa-
tients. Parmi celles-ci, le développement
d’une relation thérapeutique, le temps alloué
à la discussion, la connaissance de l’his-
toire de vie du patient et son cadre culturel
sont des éléments très importants.
Cette riche expérience nous a permis
d’avoir un contact privilégié avec nos pa-
tients et de mieux les connaître dans leur
contexte biopsychosocial.
La démarche associée à la mise en place
des DA dans notre Service a également
donné la possibilité aux patients, pour rédi-
ger leurs DA, d’avoir recours à des person-
nes ressources identifiées au sein d’une
équipe. Cette démarche a aussi contribué
à dédramatiser des situations de soins cri-
tiques, et permis d’aborder le sujet de la fin
de vie plus facilement, tout en impliquant la
famille.
Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
23 novembre 2011 2311
Bibliographie
1 Davison SN. Facilitating advance care planning for
patients with end-stage renal disease : The patient
perspective. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:1023-8.
2 Bartlow B. In search of an advance directive that
works for end-stage renal disease patients. Hemodial
Int 2006;10(Suppl. 2):S38-45.
3 Mauron A, Hurst S. Les directives anticipées : un
instrument juridique au service du patient. Cahiers de
l’Action sociale et de la santé 2005:17-22.
4 A controlled trial to improve care for seriously ill
hospitalized patients. The study to understand prog-
noses and preferences for outcomes and risks of treat-
ments (SUPPORT). The SUPPORT principal investi-
gators. JAMA 1995;274:1591-8.
5 Noble H, Meyer J, Bridges J, et al. Patient expe-
rience of dialysis refusal or withdrawal – a review of
the literature. J Ren Care 2008;34:94-100.
6 Davison SN, Torgunrud C. The creation of an ad-
vance care planning process for patients with ESRD.
Am J Kidney Dis 2007;49:27-36.
44_47_35864.indd 4 17.11.11 09:49
1
/
4
100%