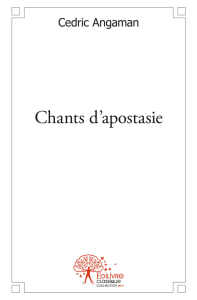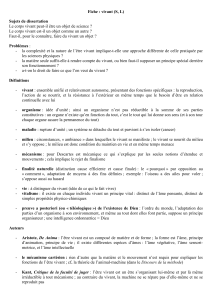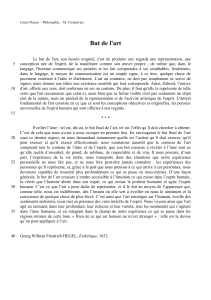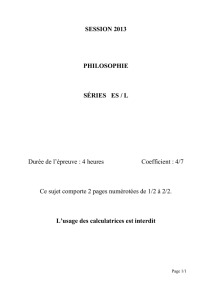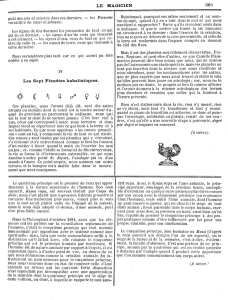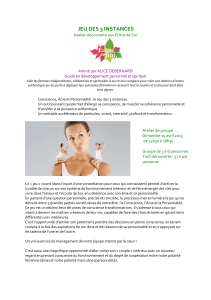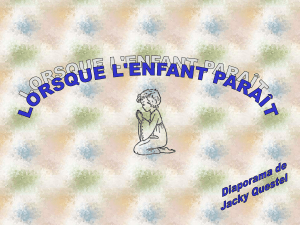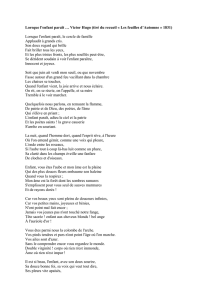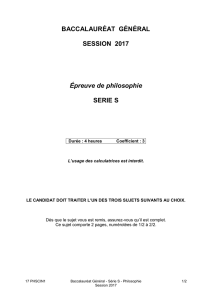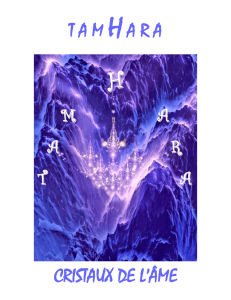L`évolution des animaux domestiques

L’évolution des animaux domestiques
Quelques aspects tirés d’une conférence de Manfred Klett,
revus et complétés par ce dernier et Markus Hurter
La toute première origine des animaux remonte à « l’ancien Soleil ». Toute
évolution se déclenche toujours dans la tension polaire d’un élément progressant et d’un
élément stagnant. C’est en ces temps planétaires les plus reculés, et donc bien avant la
toute première apparition d’un phénomène physique, que débuta l’amputation, le
détachement de l’animalité (élément stagnant) hors de l’être humain (élément
progressant).
Dans l’évolution de la Terre qui suivit, l’étape évolutive de l’ancienne Lune,
l’apparition physique des animaux débuta à l’époque de la Lémurie. L’être humain, qui
n’existait encore à cette époque que sous une forme purement astrale, traversa alors une
évolution qui, ultérieurement - pareille à une projection du microcosmos reflet du
macrocosmos - eut comme conséquence la formation de la tête. Tout ce qui s’opposait
alors à une évolution se réalisant dans cette existence astrale vers la formation de la tête
humaine, fut excrété. Et c’est ainsi que dans la progression de l’évolution physique
apparut un premier groupe quadruple d’embranchements animaux : Protozoaires,
Cœlentérés, Échinodermes et Mantelés, les fameux animaux céphaloïdes. Chez eux,
domine la formation d’une fonction céphalique qui inclut les fonctions métaboliques et de
locomotion (exemple typique: les Céphalopodes eux-même, phylum de la seiche. ndt). Ces
formes animales primitives sont principalement rondes et possèdent un squelette externe
partiel. Au plan géologique, leur avènement essentiel se situe à l’ère Paléozoïque.
Une seconde phase évolutive s’y rattacha pendant laquelle l’être humain
macrocosmique édifia une organisation rythmique s’émancipant fonctionnellement de son
organisation céphalique. Cette phase évolutive laissa derrière elle des traces nettes dans
l’apparition d’une seconde tétrade animale, les Mollusques, les Vers, les Articulés et les
Poissons et marqua de son empreinte ensuite l’ère Mésozoïque ou ère secondaire. Cette
série d’animaux est caractérisée par un élément structurel de répétition, la segmentation,
qui apparaît par la suite chez l’être humain dans la colonne vertébrale.
Alors que l’homme se rapproche de plus en plus de l’existence physique, tout en
préparant à cette occasion son système métabolique et des membres, une troisième tétrade
animale apparaît sur la Terre: les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et finalement les
Mammifères. Vue au plan géologique, cette évolution s’accomplit de la fin du
Paléozoïque, sur le Mésozoïque (Secondaire) jusque dans la première moitié du Tertiaire.
Douze embranchements du règne animal en résultent donc dans lesquels est exposé ce qui
apparaît corporellement - et se trouve corporellement engagé avec la vie de l’âme - au sein
de l’être humain considéré comme un tout. Ce qui représente chez l’être humain l’unité
(structurelle) équilibrée dans une triade (fonctionnelle), cela se retrouve individualisé dans

le règne animal sous une spéciation (au sens de formation d’espèces, ndt) à peu près
infinie. L’être humain est le compendium du règne animal, et fut la source de l’évolution
animale avant que lui-même n’apparaisse physiquement.
L’ère Atlantéenne, qui succède à l’ère Lémurienne et correspond
approximativement aux ères géologiques Tertiaire et Quaternaire, voit la grande
progression évolutive animale s’achever peu à peu vers le milieu des temps atlantéens.
L’apparition des singes humanoïdes, les Hominidés, en forme la dernière note. Les étapes
évolutives antérieures et postérieures sont accompagnées de disparitions d’espèces. Ne
suivront plus que des modifications, pour préciser, de ce qui a pris naissance
antérieurement. Au sein de l’évolution humaine, se produit la dotation du Je vers le milieu
de l’époque Atlantéenne et ce n’est qu’à la suite de celle-ci que l’être humain entre
finalement sur la Terre dans un corps physique [en effet, R. Steiner explique que le « Je »
est lié à une forme corporelle, mais il faut distinguer cette dotation du « Je » de la
conscience du « Je » qui est un phénomène se développant ultérieurement à cette dotation.
ndt]. Cela se réalise dans la seconde moitié de l’époque atlantéenne. C’est donc en tant
qu’être encore totalement imprégné du cosmos que l’être humain va à la rencontre du
monde terrestre et qu’il trouve donc à son arrivée sur la Terre des règnes naturels achevés,
les animaux, les végétaux et les minéraux. Vis-à-vis de ce monde et vis-à-vis du monde de
son origine cosmique, il se ressent alors dans une relation de type magique et cosmique
(souvenir lointain de l’état paradisiaque originel, dont on peut encore pressentir la
lointaine harmonie nostalgique dans un jardin bio-dynamique... ndt).
Vers la fin de la période atlantéenne, les glaciations survinrent et parallèlement à ce
phénomène, la relation magico-cosmique se transforma en une relation de type sacré et
cosmique. L’évolution psycho-corporelle de l’être humain ne se reflète plus dans
l’évolution d’une forme animale à une autre mais l’être humain, qui s’éveillait alors au
microcosmos, se plaça dans une relation immédiate, sacramentellement fondée, avec des
espèces animales particulières et commença à se charger de leur conduite. C’est le
moment de la naissance de l’animal domestique. Par l’intervention humaine, des
modifications caractéristiques survinrent dans l’édification du squelette, dans le
métabolisme et le comportement psychique d’espèces animales particulières.
Cette progression gigantesque vers la domesticité est le reflet de l’activité du « Je »
humain, qui était encore en train de réaliser des expériences dans les vastes espaces
cosmiques, et qui avait auparavant entrepris d’élaborer, dans son essence propre, le corps
physique - pendant les temps atlantéens et post-atlantéens - le corps éthérique - pendant
l’Ancienne Inde - l’âme de sensibilité pendant l’époque de civilisation de l’Ancienne
Perse. Ce travail du « Je » sur les composantes de la nature humaine ne resta pas limitée à
celles-ci. Il s’étendit à une influence sur la vie des végétaux et sur le psychisme des
animaux sur lesquels l’être humain orienta désormais son activité. En restant de ce fait un
être humain encore apte à élaborer des images au sein même des composantes de son
essence, il fut en situation de prendre soin des animaux et de les préserver de retomber

dans l’état sauvage, en les ramenant, et en les stabilisant, à un degré quasiment
embryonnaire de malléabilité des formes corporelles et psychiques. Cette relation
entretenue par l’être humain, préservant et stabilisant la jeunesse de la forme et du
psychisme animal, ouvrit l’âme animale vis-à-vis du Je humain la dirigeant. Le champ
d’expérience de l’animal devint, au lieu de la simple nature, l’environnement social de
l’être humain lui-même. Le chemin menant à une vie s’épuisant dans la création naturelle
fut corrigé et dirigé vers la domesticité. Cette perspective permet d’éclairer la question,
propagée du côté de l’écologie, d’un l’élevage animal conforme à l’espèce animale par
rapport au problème de rechercher le point de référence de cet élevage dans la fonction
directrice de l’être humain lui-même. [Autrement dit, pas d’élevage conforme à l’espèce
domestique, sans référence d’abord à l’action dirigeante de l’être humain sur l’élevage
animal ; seul l’être humain a en effet la capacité psycho-spirituelle « d’élever » l’animal,
et non la nature, qui en épuise plutôt la vie au travers des formes naturelles de l’espèce
« sauvage ». ndt]
Cette conservation dans un stade de juvénilité malléable contribue à la plasticité
dans le déploiement de l’espèce, à la plénitude des formes et des couleurs des robes des
races domestiques - chose qui était caractéristique dans une ampleur bien plus gigantesque
aux degrés d’évolution antérieurs, alors que l’être humain ne séjournait pas encore sur la
Terre. Ce qui, surtout au début de l’époque atlantéenne, surgit d’un seul coup en tant
qu’expression d’une plénitude de créatures, en culminant dans les plantes à fleurs d’une
part, et, d’autre part, dans les Mammifères - à l’extrémité desquels se situe le bovin - se
répète désormais dans les plantes cultivées et la domestication animale, mais cette fois
sous la main modelante d’un être humain collaborant à leur création.
Si on recherche dans les fossiles des restes des époques Atlantéenne/Tertiaire en
fonction des débuts de la domestication, on ne trouve rien qui puisse permettre de l’établir
nettement. On ne trouve que des restes osseux de la faune sauvage. (À l’occasion de quoi,
on doit prendre garde à l’utilisation du concept « sauvage », puisque jusqu’à la fin du
Tertiaire, les peintures rupestres témoignent combien l’être humain entretenait une
relation fortement magique avec les animaux.) Ce n’est qu’aux commencements du
Paléolithique, donc à peu près au 15ème millénaire avant le Christ, vers la fin des temps
glaciaires, qu’on en découvre les premières traces. En fouillant un habitat de chasseurs en
Ukraine, du temps des glaciations, on a trouvé, à côté des os de mammouth, de nombreux
crânes de loups et parmi eux un crâne possédant un os frontal plus court - une première
indication indubitable du cheminement évolutif du loup au chien. Mais cette trace se perd
à nouveau. Et ce n’est que deux millénaires plus tard, au Mésolithique (du 13ème au 9ème
millénaires avant le Christ), avec le franchissement du seuil des temps glaciaires, que le
chien apparaît dans une multitude de découvertes, comme le plus ancien des animaux
domestiqués, et d’une manière surprenante, dans toute la diversité de ses espèces grandes
et petites, hautes ou courtes sur pattes, etc., dans toutes les formes que nous connaissons
aujourd’hui et pendant un si court espace de temps ! Et cela bien que toutes les races de

chien remontent en définitive à la forme originelle du loup. Ce phénomène ne se laisse pas
expliquer par la sélection ni par les croisements et ne se ramène même pas à une simple
adaptation. L’être humain de l’époque a dû disposer encore de facultés, au travers de sa
relation cosmique sacrée avec les êtres naturels et les mondes planétaires, par lesquelles il
avait la capacité d’agir au sein des forces formatrices de la configuration animale.
Suit alors cette évolution que l’on désigne comme la Révolution néolithique. Tout
d’un coup, surgissent au 8ème millénaire avant le Christ, dans leurs formes définitives
d’animaux domestiques, le mouton, la chèvre, le bovin et le porc et à nouveau dans une
grande diversité de variétés. Le centre géographique de cette évolution se situe dans le
fameux « Croissant fertile », qui en Asie mineure, s’étend de la Palestine jusqu’au-delà de
la Perse, et dans la région de l’Indus, en englobant la Syrie, l’Anatolie, le pays des deux
fleuves. Dans cet arc en forme de croissant de Lune, on dispose non seulement
d’évidences fossiles prouvant une évolution de la domesticité animale sous la main de
l’être humain, mais établissant aussi celle des plantes cultivées. Les porteurs de cette
impulsion civilisatrice furent les deux premières civilisations post-atlantéennes,
l’Ancienne Inde et l’Ancienne Perse, qui progressèrent d’Est en Ouest. C’est surtout dans
cette dernière qu’existaient des Mystères fondés par Zarathoustra, par lesquels les
hommes furent éduqués à se tourner vers la Terre et vers ses créatures afin de prendre ces
dernières sous leur protection.
Les mythes des peuples décrivent cette révolution fondamentale des temps
atlantéens aux temps post-atlantéens, qui caractérise la fin de l’époque glaciaire avec le
déluge, par exemple l’épopée de Gilgamesh, dans laquelle ce revirement est lié au terme
de Uta-Napischtim. Dans l’Ancien Testament, c’est Noé, qui sauve du déluge le monde
végétal et animal en les faisant passer de l’atlantéen au post-atlantéen, et qui avec cette
Création préservée, entre dans la citoyenneté terrestre. Noé et son arche sont l’une des
images illustrant le fait que désormais l’être humain, en tant que microcosmos, fait
progresser les animaux et leur existence sur Terre, après avoir suivi l’exemple de leur
devenir depuis l’époque de la Lémurie. D’abord lui-même Créature, le voilà qui
commence à présent à orienter la Création.
L’individualité du Noé biblique est appelée Manu, dans la science spirituelle de
Rudolf Steiner. C’est elle qui conduisit les peuples de l’Atlantide s’effondrant vers l’Est,
et qui, dans la région ou s’étend aujourd’hui le désert de Gobi, fonda des lieux d’oracle
solaire, à partir desquels s’initièrent ou furent inaugurées les civilisations post-
atlantéennes. Dans ces époques de culture le Je humain s’éveille progressivement en
s’emparant de ses composantes corporelles. Dans la première civilisation de l’Ancienne
Inde, le Je s’éveille dans l’élaboration du corps éthérique. Le corps de l’Ancien Hindou se
développa en une sorte d’instrument de résonance par le truchement duquel une
conscience cosmique se faisait entendre, une conscience qui le laissait encore
complètement enchâssé dans son origine spirituelle. Il vivait encore totalement dans une

conscience céleste, qui ressentait le monde terrestre comme irréel, comme une apparence,
une maya. À en croire les découvertes archéologiques, c’est la progression la plus vaste de
la domestication qui s’accomplit alors. À partir de cette conscience céleste, l’être humain
de l’époque fut effectivement capable d’agir d’une manière telle - sur ce qui du cosmos se
trouvait dans l’animal au sein du corps astral de celui-ci - que, dans un accord instinctif
avec l’âme groupe de celle-ci, il façonnât l’âme et le corps d’espèces animales
particulières afin de pouvoir les placer à son service. Le fait d’exercer cette suppléance
pour l’âme groupe animale sur terre constitue justement la constitution psychique
caractéristique faisant d’un animal un animal domestique! - À l’époque de la civilisation
de l’Ancienne Inde, il est peu probable que les « animaux domestiques » aient déjà été
maintenus dans des étables. La conscience cosmique de ces temps-là et l’omniprésente
richesse de la nature, ne regroupaient pas encore les êtres humains sur des colonies
sédentaires. Les êtres humains éprouvaient une sympathie pure vis-à-vis de l’animal,
encore du style de celle d’Abel. En tant que berger, on se situait alors au centre du
troupeau avec lequel on circulait en nomadisant dans le pays.
La formation d’une « confiance » psychique à l’égard de l’homme, inhérente à
cette fameuse domestication des animaux, comme on l’a déjà mentionné, entraîna
également pour conséquences des modifications anatomiques et physiologiques. Ainsi,
outre la diminution de la grosseur du corps, le raccourcissement et l’arrondissement
imprimés aux os de la face, une plus grande fécondité que chez les espèces sauvages ; le
cycle sexuel fut moins lié au cours des saisons ; les poils de fourrure firent place à une
disposition plus drue et une coloration plus intense de la robe et ne changèrent plus en
fonction du rythme annuel, mais se renouvellèrent de manière constante pendant toute
l’année. On peut finalement constater un phénomène, a priori étonnant, à savoir que les
animaux domestiques possèdent un cerveau considérablement rapetissé et moins organisé.
La plus grande partie de cette réduction concerne le cerveau antérieur, là où se situent les
centres sensoriels. Conformément à cela, les animaux domestiques souffrent d’un net
amoindrissement de leurs capacités sensorielles par rapport à leurs congénères sauvages.
Le chien sent moins bien que le loup, le porc entend moins bien que le sanglier etc. Mais
ce phénomène est compréhensible quand on réfléchit que la progression vers la
domesticité, consiste précisément aussi, et entre autres, dans le fait que la productivité
sensorielle recule au profit de la productivité métabolique. C’est pour ainsi dire par une
sorte de renoncement que l’animal domestiques accomplit des performances pour l’être
humain, pour l’alimentation, l’habillement, l’habitation et services de toutes sortes rendus
à celui-ci. Aujourd’hui, dans le train de la commercialisation de l’agriculture, ce trop plein
de performances produites sur la base du renoncement de l’animal est encore utilisé
comme une fonction d’exploitation et de rentabilité. L’animal domestique devient animal
à exploiter. Toutes ces modifications citées existaient chez les plus importantes espèces
d’animaux domestiques vers la fin de la civilisation de l’Ancienne Inde, et donc vers le
début du 6ème millénaire avant le Christ.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%