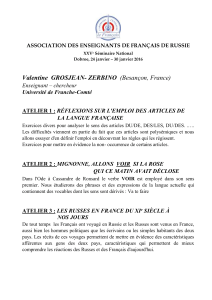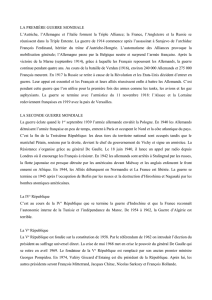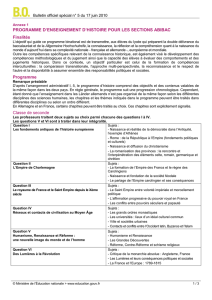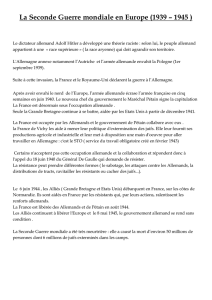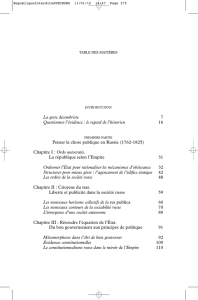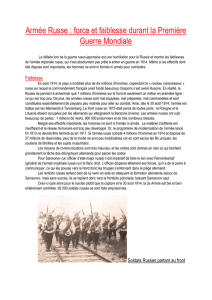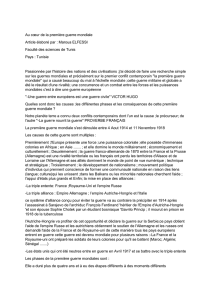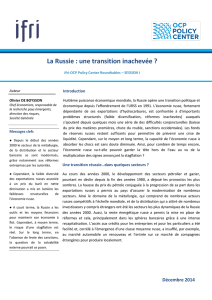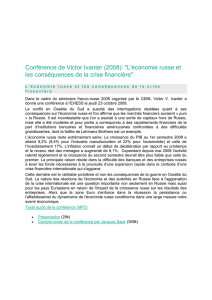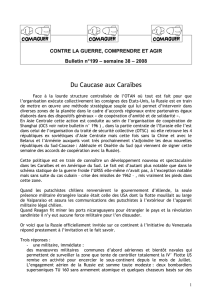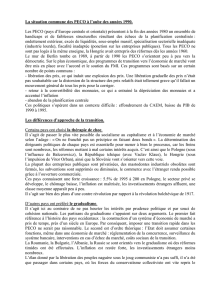Ecrits de Drieu 1942-1945 (pdf 22 pages)

Pierre Drieu la Rochelle
– Janvier 1943 –
EXAMEN DE LA POLITIQUE DE VICHY
En juin 1940, on pouvait suivre la politique de Paul Reynaud et la politique du
Maréchal Pétain.
1°) La politique de Paul Reynaud comportait l’abandon complet du territoire
métropolitain pour autant qu’il se trouvait des troupes, des fonctionnaires, des hommes
politiques et des représentants de l’élite – et la concentration de tout cela – dans l’Afri-
que du Nord ou même dans l’Afrique Occidentale.
Tels auraient été les résultats de cette politique :
– a) la population française aurait été complètement abandonnée comme la
population belge ou hollandaise à la haute administration allemande. La destruction des
ressorts français qui en aurait résultée aurait été beaucoup plus grave pour un Etat de la
proportion de la France que pour de petits Etats comme la Belgique ou la Hollande ;
– b) l’armée allemande aurait poursuivi les débris de l’armée française à travers
l’Espagne, qui alors ne songeait aucunement à se fermer (du moins pendant les premiers
jours), jusqu’en Afrique. Là, l’absence complète de munitions, de carburants nous
aurait livrés. Les Allemands se seraient rendus maîtres sinon de Gibraltar, tout au
moins de ses approches, et auraient fermé la Méditerranée aux Anglais. L’occupation
des principaux ports nord-africains aurait achevé leur maîtrise sur la Méditerranée occi-
dentale. Ils auraient pu facilement après cela conquérir l’Egypte qui, de l’aveu de Chur-
chill dans un de ses discours, était presque sans défense. Les effets auraient été décisifs
sur le cours de la guerre. On peut donc dire que la politique de Paul Reynaud aurait
perdu les Alliés bien loin de les sauver ;
– c) la France se serait trouvée devant l’Allemagne victorieuse dans la situation
de la Pologne.
2°) La politique du Maréchal Pétain qui a prévalu a, au contraire, sauvé les
Alliés en écartant de l’esprit des Allemands l’idée qui pour eux aurait été géniale, faute
d’avoir poursuivi les Anglais en Angleterre après Dunkerque, de les frapper à fond dans
la Méditerranée et de s’emparer de toute cette mer. Elle a beaucoup mieux protégé le
pays en posant le fait de sa neutralité maritime qu’en livrant la flotte aux Anglais, ce qui
aurait probablement eu les mêmes conséquences que la retraite en Afrique du gouverne-
ment et de l’armée.
De plus, vis-à-vis de l’Angleterre comme de l’Allemagne, il était indispensable
de maintenir la fiction d’un Etat qui sans être parfaitement autonome maintenait des dis-
tances physiques et donc morales vis-à-vis des grandes puissances qui voulaient la
réduire en la mettant sous la coupe directe, soit à Paris, soit à Dakar ou à Londres.

Mais la politique ainsi adoptée n’était valable sous sa forme primitive que pour
un temps limité. A partir du moment – et ce moment vint très vite, dès octobre 1940 –
où il fut acquis que l’Amérique et la Russie entreraient dans la guerre, le système de
neutralité et d’équilibre du Maréchal Pétain devenait extrêmement dangereux à cause de
l’énormité des forces engagées qui surclassaient absolument tout ce que la France pou-
vait encore mettre dans la balance, et à cause de la brutalité inexorable du conflit final
qui devait nous broyer entre les deux camps.
Le M a r éc h a l P é t a i n s ’ en t r e t e n a n t a v e c u n j eu n e f on c t i o n n a i r e
à la Délégation auprès des Prisonniers de Guerre : François Mitterrand
La politique de M. Laval ne se distingua pas d’une façon vraiment décisive, au
début, de celle du Maréchal Pétain et, en dépit des déclarations qu’il a pu faire ou des
intentions qu’on lui a prêtées, cette politique pour des raisons foncières n’a jamais su se
détacher complètement de l’attentisme auquel elle semblait s’opposer, mais à quoi en
réalité elle a toujours servi d’écran. En tant qu’ancien politicien démocrate, ne croyant
que dans les négociations et dans les arrangements de fortune, M. Laval ne pouvait pas
se distinguer beaucoup du Maréchal Pétain qui de son côté, comme toutes les personna-
lités officielles de l’ancien régime, alors même qu’elles étaient de droite, était entaché
des mêmes vices de timidité et d’opportunisme, mais chez lui enveloppé des pompes
habituelles de l’Académie Française et de La Revue des Deux Mondes.
Il était bien certain que cette politique d’attente, bien qu’à tel ou tel moment elle
pût être considérée par les Alliés ou par les Allemands comme favorable à leurs visées
qui se rencontraient sur le point de neutraliser pour longtemps la Méditerranée occiden-
tale et les côtes françaises, ne pouvait complètement satisfaire ni les uns ni les autres, et
devait accumuler dans leur esprit la rancune, le mépris, faciliter leurs arrières-pensées
sur le sort qui serait réservé à la France après les hostilités.
La doctrine de l’attentisme se fondait pratiquement sur des vues militaires et
maritimes qui ne correspondaient pas du tout à la réalité révolutionnaire de l’immense
conflit et qui prouvaient que nos milieux responsables n’avaient fait aucun progrès sur
leur état d’esprit d’avant 1940. Il était bien certain en effet que l’armée et la marine
françaises, réduites comme elles l’étaient, sans industrie de guerre, sans stocks d’aucune

sorte, ne pouvaient être considérées par personne comme un appoint sérieux et iraient en
s’amenuisant sans cesse à mesure que le temps passerait et que les chocs préliminaires
se multiplieraient dans l’Empire et aux approches de la métropole.
Le mérite de ceux qui décidèrent de faire de la collaboration plus ou moins ser-
rée avec l’Allemagne fut égal en cela contre Vichy à celui des autres collaborationnistes
qui avaient résolu de travailler avec l’Angleterre ou avec l’Amérique. Les uns et les
autres comprenaient qu’une intervention autonome de la France dans la suite du conflit
était impossible et qu’on ne pouvait chercher des garanties que morales dans une sou-
mission décidée et constante à l’un ou l’autre camp. Mais les collaborationnistes avec
l’Allemagne trouvaient dans leur politique un avantage pour la France que n’y trou-
vaient pas les autres, à savoir qu’étant en France, s’ils pouvaient mettre la main sur le
gouvernement de Vichy, ils disposeraient avec un peu d’habilité de l’armée, de la
marine, de la partie la plus importante de l’Empire et qu’ils pourraient mettre tout cela à
l’abri sous la sauvegarde d’une entente avec l’Allemagne.
Empire, armée, marine isolés par l’attentisme étaient voués à une lente ou rapide
consomption. Placés franchement dans l’un des camps, ils pouvaient être sauvés pour
des jours meilleurs : c’était la justification profonde d’une politique de collaboration qui
aurait été menée par une équipe homogène et dépouillée. On a essayé à la fin de 1940
et au commencement de 1941 de constituer cette équipe entre Vichy et Paris, en dehors
de l’attentisme et en dehors du collaborationnisme sportulaire et on y a échoué. Ce
qu’on a appelé « la bande Worms » (1) n’a pas eu de chefs et n’a pas su vraiment jeter
son va-tout. Elle n’a pu s’insérer que timidement et fragmentairement dans l’appareil
de Vichy et elle n’a pas su annuler ni les préventions des Allemands ni les préventions
de Vichy. Elle ne sut pas dominer les arrière-pensées de Vichy, bien au contraire. Son
échec décisif se produisit au printemps 1941 dans un conseil de cabinet où Pierre
Pucheu qui avait le plus de poids dans l’équipe décida le gouvernement de l’Amiral
Darlan à refuser aux Allemands l’accès du port de Bizerte. Ce jour-là, il fut avéré que
cette équipe ne se distinguait pas de Vichy et laissait passer sa chance.
Dès lors tout ce qui avait été pressenti par les ultras du gaullisme aussi bien que
du collaborationnisme se développa selon une progression terrible. D’abord l’Empire
se désagrégea. L’Indochine avait déjà été ramassée par les Japonais, les colonies du
Pacifique et de l’Atlantique par les Anglo-Saxons. Ce fut le tour ensuite de la Syrie,
puis de Madagascar. D’un autre côté, la révolution nationale échouait définitivement à
Vichy dans un attentisme social qui valait l’attentisme politique, sous le couvert d’une
multitude de lois et de règlements qu’aucun parti pris décisif n’animait. Nous allions à
pleines voiles vers les destructions finales, comme en 1939-1940 vers les premières des-
tructions.
Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus grave au fond de la politique de
Vichy et qui impliquait non plus seulement la responsabilité de la France vis-à-vis
d’elle-même, mais de la France vis-à-vis de l’Europe. Les hommes de Vichy formés
par les vieux manuels d’histoire diplomatique et d’histoire militaire ne concevaient
notre politique qu’en fonction du seul conflit entre l’Allemagne et les Anglo-Saxons,
qui pourtant depuis le Congrès de Berlin de 1878 n’était qu’une partie du drame euro-
péen. Ils ne voyaient qu’une moitié de l’horizon. La véritable éventualité était encore

plus qu’en 14-18 le conflit entre les Slaves et les Germains, entre le communisme et le
capitalisme. C’est là-dessus que les épouvantables insuffisances de Vichy prirent leur
caractère vraiment critique, et c’est là-dessus aussi que les collaborationnistes germano-
philes trouvèrent leur plus profonde justification à l’envers des collaborationnistes amé-
ricanophiles et surtout anglophiles qui, comme les gens de Vichy, ne voyaient qu’un
côté de la question.
Vichy escompta et souhaita les succès russes sur les Allemands. Bien sûr, ces
succès ne devaient pas en principe aller trop loin ; mais même s’ils allaient trop loin, on
ne les craignait pas et l’on comptait sur une armée française, inexistante et incapable de
ressurgir promptement des camps de prisonniers et de toutes les dispersions physiques
et morales, pour aider les Anglo-Saxons à arrêter une invasion qu’on avait d’abord sou-
haitée dans ses prémices. On nourrissait cette pensée paradoxale que l’armée française
qui avait été surclassée par l’armée allemande battrait finalement l’armée russe qui sur-
classait l’armée allemande. Les espoirs de l’état-major de Vichy sur les succès de
l’armée russe furent retardés par l’offensive allemande de l’été 1942 et la résistance
allemande de l’hiver 1942, mais ils ne subsistèrent pas moins.
Maintenant, durant cet hiver 1943, alors que décidément l’armée russe semble en
effet surclasser l’armée allemande, il n’y a plus du tout d’armée française ni de flotte
française ni d’Empire français pour tirer parti d’une situation si témérairement escomp-
tée. Car, entre-temps, la désagrégation de toutes ces forces s’est achevée par la prise de
l’Afrique du Nord, la prise de la zone libre, la démobilisation de l’armée et la destruc-
tion de la flotte. L’attentisme a rendu l’âme à Toulon en novembre 1942.
Le broiement des forces françaises qui était à prévoir entre des masses énormes
montre ses conséquences politiques dans la pulvérisation des éléments gaullistes entre
Giraud et de Gaulle et la pulvérisation des éléments collaborationnistes entre Laval,
Doriot et Déat.
Il résulte de tout cela pour l’Europe, au moment où elle est menacée de voir les
armées allemandes non seulement perdre tout ce qu’elles ont gagné cet été mais encore,
terriblement mutilées par la catastrophe de Stalingrad et la retraite précipitée du Cau-
case, s’ébranler de la Mer Baltique à la Mer Noire pour une interminable retraite jus-
qu’en Europe centrale, que la seule nation militaire en Europe en dehors de l’Allema-
gne, la France, n’offre plus aucune ressource et que bientôt, entre les armées anglo-
saxonnes qui ne sont nullement au fait des nouvelles méthodes de guerre en Europe et
qui, au reste, sont loin encore d’avoir débarqué, il ne restera que l’armée suisse et
l’armée suédoise.
____________________
(1) La « bande de la banque Worms » était soumise à l’influence de Gabriel Le Roy Ladurie (1898-1947).
Entré au service des Worms en juillet 1929, il dirigeait, dix ans plus tard, cette banque avec Jacques Bar-
naud. Il en fut seul directeur de 1940 à 1943. Sa position, au carrefour de la haute finance et de la politi-
que, lui permit de jouer un rôle occulte dont il est difficile de tracer les limites exactes (note A.D.L.R.).

Pierre Drieu la Rochelle
SITUATION AU PRINTEMPS 1943
Quand certains chefs nationalistes français se décidèrent quelque temps après
l’armistice à la collaboration avec l’Allemagne, ce ne fut point parce qu’ils étaient ger-
manophiles : cela n’aurait rien voulu dire de la part de nationalistes qui excluent toute
sentimentalité vis-à-vis des nations étrangères. Ce fut parce qu’ils étaient entièrement
d’accord avec la conception nationale-socialiste.
Ils estimaient que, mieux que les Italiens, les Allemands avaient mis en œuvre la
seule forme de nationalisme viable et valable pour les peuples européens du XXe siècle.
Cette forme assurait le salut pour ce qu’il y avait de plus profond et de plus vital dans
chaque nation d’Europe et pour ce fond d’humanité virile qui est le fondement commun
à toutes les nations d’Europe.
Les nationalistes français voulurent collaborer non avec la nation allemande
mais avec la nation qui portait en Europe la responsabilité de la révolution nationale-
socialiste. Les nationaux-socialistes français attendaient de l’Allemagne qu’elle créât
en Europe un climat favorable à des révolutions nationales-socialistes dans tous les
pays, et particulièrement en France ; ils attendaient de l’occupant une aide large, entière,
rapide pour faire la révolution, si difficile dans ce pays, qu’il soit occupé par les Alle-
mands ou les Anglo-Saxons.
Les nationaux-socialistes français voulaient faire une révolution nationale-
socialiste en France dans le cadre de la révolution nationale-socialiste en Europe. Cela
seul les intéressait et leur paraissait mériter par l’ampleur du résultat possible les terri-
bles risques qu’ils prenaient du point de vue nationaliste même.
Ils ont été rapidement déçus par le caractère que prenait la politique allemande
aussi bien en France qu’en Europe.
En Europe, faute de mesures d’ensemble proprement socialistes et réellement
européennes, là où l’Allemagne a soutenu des mouvements nationaux-socialistes,
l’entreprise a donné de fâcheux résultats, de sorte qu’ailleurs elle s’est appliquée à jouer
la partie inverse et à appuyer des démocrates ralliés. Cette seconde politique fut surtout
précisée en France. Parmi les hommes politiques français, avec obstination les diri-
geants allemands ne voulaient voir qu’un seul d’entre eux : Laval.
Or cet homme exprimait d’une façon parfaitement claire et continue sa volonté
de sauvegarder le plus possible de l’ancien régime, tant dans les personnes que dans les
institutions et surtout dans l’esprit général de sa politique. En fait, l’homme de Stresa et
du Pacte franco-soviétique ne se rapprochait des Allemands que pour des raisons de pur
opportunisme diplomatique.
Les résultats de cette disposition profonde de Laval ne se sont pas faits attendre.
Dès le 13 décembre 1940, il était avéré que Laval était incapable de dominer la nouvelle
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%