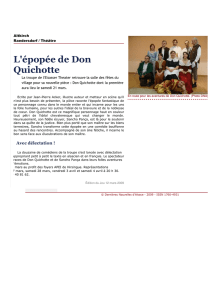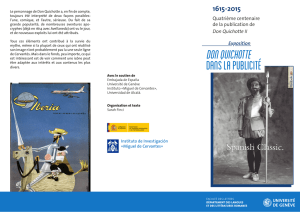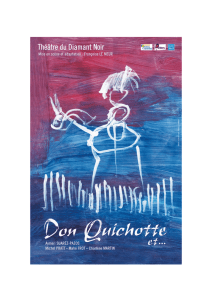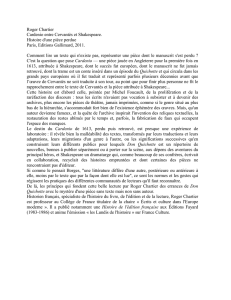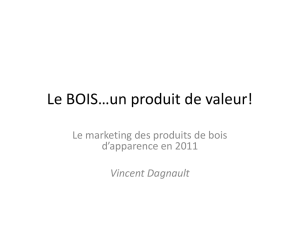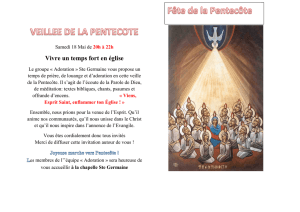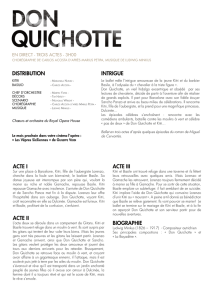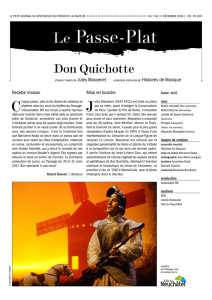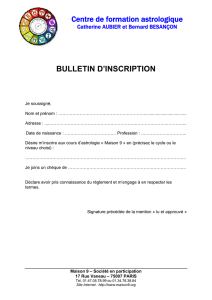XVI Les Cloches de Corneville - DBR

XVI
Les Cloches de Corneville
Telle est aussi la part de félicité qui revient à la vue
1. L’opéra-comique1
Nous sommes au chapitre XXII des Flibustiers. Un spectacle se donne sur les planches du
théatre de Manille. Les Cloches de Corneville. J’ignore tout, pour l’instant, de cette opérette.
Aussi je survole plus que je ne lis ce rapide chapitre.
Cependant, une idée me vient à l’esprit et qui n’a aucun rapport avec l’opérette : si Rizal a
conçu son ouvrage en pensant à Don Quichotte, alors nous devrions jeter un coup d’œil au
chapitre XXII du volume 1 des aventures de l’Hidalgo. Nous voici en présence des Galériens.
Voyons également au chapitre XXII du volume 2 : Don Quichotte raconte sa descente dans la
Caverne de Montesinos, la caverne des Dormants. Il nous faut suivre les trois chapitres XXII
d’un œil qui embrasse les trois textes. Le fil que Rizal tire au travers des trois chapitres est
torsadé autour de certains mots-clés : Cervantès, Caverne, libération, Cloches de Corneville,
rideau, scène, opérette, France.
Qu’est ce que cette opérette ?
Je mène l’enquête sur Internet et rapidement, les informations tombent. Je synthétise,
réorganise, réécris afin de les rendre plus directement lisibles et exploitables dans le cadre de cet
essai. Les amateurs de chansonnettes pourront à loisir compléter leur connaissance de cette pièce
en se rendant sur la toile où abondance de détails ont été collationnés.
Nous sommes à Paris le 19 avril 1877, les Folies-Dramatiques, théâtre parisien, se décident à
représenter Les Cloches de Corneville. Historique : Robert Planquette, auteur de la partition avait
déjà écrit une courte pièce intitulée Méfie-toi de Pharaon. Il contacte plusieurs directeurs de
théâtre, mais le projet ne séduit personne (Bip). En 1873, (BOP) un inconnu se présente.
Fabricant de dessous de plats à musique, il offre d'éditer des morceaux choisis. Planquette
accepte et la musique fait son petit tour de France, sans avoir jamais été jouée dans un théâtre !
La carrière de l’opérette ne commence qu’en 1877. La critique est catastrophique, mais le public
s’amourache de la pièce. L'ouvrage est traduit et fait plusieurs fois le tour du monde. À Paris, la
millième est atteinte en moins de dix ans. La carrière de l’œuvre durera près d’un siècle et il
arrive encore aujourd’hui, que certaines troupes la jouent.
2. L'histoire
En Normandie, à la fin du XVII° siècle, le marquis de Corneville doit s'expatrier avec son
petit-fils Henri. En partant, il confie sa fortune et son domaine à son fermier Gaspard. Au fil des
ans, ce dernier finit par considérer comme sien les biens de ses maîtres. Il laisse croire que le
château de Corneville est hanté par ses anciens châtelains.
1 Fiche technique : Les Cloches de Corneville, opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux de Louis Clairville et Charles
Gabet, musique de Robert Planquette. Création à Paris, théâtre des Folies-Dramatiques, le 19 avril 1877.

À la même époque, le comte de Lucenay, autre noble de la région, fuit également la France en
confiant sa fille Germaine à ce même Gaspard. Ce dernier la fait passer pour sa nièce. Enfin, le
fermier recueille dans un champ de serpolets un bébé qu’il prénomme... Serpolette et qui
deviendra plus tard sa servante. Gaspard subtilise la page du registre du bailliage où sont inscrites
les naissances de Germaine et Serpolette.
L’action débute quelque vingt ans plus tard, à la fin du règne de Louis XIV.
Acte I :
Un sentier boisé près du château de Corneville
Le nouveau bailli trouve suspects les agissements de Gaspard, et désire faire rouvrir le
château. Pour le neutraliser, le rusé fermier le convainc d’épouser Germaine, qui vient de revenir
au pays après quelques années passées en pension. Celle-ci a promis sa main à Grenicheux, un
jeune vaurien. Non par amour, mais par reconnaissance. En effet, étant tombée à la mer, elle a
trouvé, à son chevet en revenant à elle, Grenicheux qui a prétendu l’avoir sauvée de la noyade.
Le jour du marché de Corneville survient un inconnu qui s’intéresse au château. Il rencontre
Germaine. Elle lui raconte la légende des cloches qui, silencieuses depuis de longues années,
carillonneront au retour des seigneurs de Corneville. L’inconnu n’est autre que le marquis de
Corneville qui, après avoir fait le tour du monde, revient prendre possession de son domaine.
Le marché de Corneville
Le marquis se rend au marché où, deux fois par an, on peut louer domestiques, servantes ou
cochers. Henri engage Serpolette et Grenicheux qui fuient la colère de Gaspard.
Acte II :
Une grande salle du château de Corneville
Henri entraîne au château ses nouveaux domestiques et le bailli. Il leur dévoile sa véritable
identité et tente de les rassurer car, à part Germaine qui fait assez bonne figure, tout ce petit
monde claque des dents à la pensée de rencontrer les fameux fantômes.
Des documents trouvés dans le château laissent supposer que Serpolette serait l'héritière des
Lucenay. Le marquis se sent de plus en plus attiré par Germaine dont l'allure et la réserve ne
correspondent pas à l’attitude d'une fille de sa condition. Elle lui raconte les raisons qui l’ont
conduite à accorder sa main à Grenicheux. Le marquis comprend la duplicité de son serviteur, car
c'est en réalité lui, Henri, le véritable sauveur de Germaine.
Mais pour l'heure, il est temps de s'intéresser aux fantômes. Une barque approche du château.
Tout le monde se cache. Un homme apparaît. C'est Gaspard. Tel Harpagon, il attrape dans une
armoire des sacs remplis d'or et en contemple avec délices le contenu. Les cloches de Corneville
se mettent à sonner... Gaspard tremble, s’affole. Henri se découvre et s'approche pour le châtier.
Il se rend aux prières de Germaine et fait grâce au fermier.
Acte III :
Le parc du château de Corneville
Le marquis donne une grande fête dans son château. Gaspard, qui a perdu la raison, se
promène de groupe en groupe en chantonnant. Serpolette hérite les biens et titres des Lucenay, au
bénéfice du doute, par suite de la disparition de la page du registre de bailliage. Elle fait de
Grenicheux son factotum et souffre-douleur.
Henri fait confesser à Grenicheux sa supercherie. Cachée, Germaine entend leur conversation.
Elle se jette aux pieds de son seigneur. Le marquis la relève et lui demande de devenir sa femme.
Germaine refuse, estimant qu'une servante ne peut épouser un marquis.

Gaspard recouvre la raison. Pris de remords, il avoue toute la vérité et prouve ainsi que
Germaine est la véritable héritière des Lucenay.
Tout est bien qui finit bien pour Germaine et Henri. Les cloches peuvent sonner en l'honneur
de la nouvelle châtelaine de Corneville !
3. Des cloches allégoriques
La dramaturgie est baroque. Mais le sujet est intéressant si on l’étudie en pensant à Don
Quichotte et la destinée qui a été réservée à ce livre. En lisant le court scénario de la pièce, l’on
assiste en effet à une allégorie retraçant le parcours de l’œuvre cervantienne.
Un noble doit s’absenter, en compagnie de son petit-fils, laissant ses biens aux soins d’un
fermier. Ce dernier a la charge de Germaine, la fille du comte de Lucenay, qu’il fait passer pour
sa nièce. Mensonge, supercherie, bien évidemment, le fermier s’empare de tout.
Allégorie : Cervantès nous quitte en 1616, son trésor est confié… à un lectorat qui ne voit rien.
Le pillage en règle commence. Corrections de la part des grammairiens et experts qui s’estiment
en droit de perfectionner ce qu’ils jugent imparfait. Une longue lignée de pillards ballornisent
Don Quichotte. La récente réédition à la Pléiade de Don Quichotte, sous la direction d’un Samson
Carrasco moderne présente un maximum de ce que la culture conventionnelle peut produire de
grotesque. C’est Grenicheux qui se prend pour le marquis sous prétexte d’en avoir recueilli la
fille.
Mais un jour, le petit-fils du marquis revient au pays et entend reprendre ce qui lui appartient
de droit. Gaspard est démasqué. La vérité éclate. Les cloches de Corneville retentissent : les
seigneurs de Corneville sont de retour. Gaspard en devient fou. Germaine, qu’il a traitée en
domestique, est en fait l’héritière du comte de Lucenay. Elle peut épouser Henri.
Allégorie : la Culture a été dépossédée de la Connaissance. Don Quichotte a été mis à l’écart.
Mais survient un héros qui démasque mensonges et impostures, qui remet l’héritière en selle. Le
héros qui intervient, c’est Rizal. L’héritière qui reprend le flambeau de la lignée, c’est l’exégète
de Don Quichotte : Dominique Aubier.
Est-ce cette lecture que notre Philippin fit de l’opérette? Toujours est-il qu’il utilise les
planches de M. Planquette pour exposer Cervantès sous les projecteurs tout en le planquant ! Les
Servantes qui montent sur scène sont ici au service de la vérité quichottienne. Germaine est toute
désignée : elle est recrutée par le marquis comme domestique. Un jour, dans une conférence,
Dominique Aubier disait justement d’elle-même qu’elle était une sorte de femme de ménage qui
époussetait et briquait l’ensemble des données de la connaissance afin d’en faire briller les
couverts. Germaine : est-ce sous cette identité que Rizal a vu la préfiguration de celle qui
assumerait l’exégèse quichottienne ? Elle serait française, femme de ménage, et héritière ? Une
Germaine serait donc un jour appelée à monter sur scène, sous la pancarte Cervantès ? Elle
rétablirait l’acte de naissance authentique du héros, réabiliterait le chevalier dans ses droits et
privilèges ? Elle travaillerait au thème de l’Union des Contraires ? Je crois qu’en tous points, le
portrait de Germaine correspond à celui de Dominique Aubier. Un point d’analogie est
saisissant : Corneville. Les douze cloches de Corneville retentiront, dit la légende, le jour où les
seigneurs de la ville seront de retour. Corneville se trouve en Normandie, dans le département de
L’Eure qui est justement celui où réside Dominique Aubier. À Damville. Ce n’est pas un secret,
d’autant qu’elle l’a elle-même indiqué dans certains de ses ouvrages. De Corneville à Damville…
moins de cinquante kilomètres ! Rizal a bien vu : c’est en Normandie que Don Quichotte

monterait sur les planches, non pas en représentation théâtrale, mais sur la scène exégétique
d’une élucidation qui lui rend sa noblesse et son origine.
En ce moment même, alors que j’écris ces lignes, Dominique Aubier met la touche finale à
son livre sur la 23ième lettre de l’Alphabet hébreu. Un important chapitre y traite des douze tribus
d’Israël2 : les rapports qu’entretiennent les douze paires de nerfs crâniens avec la représentation
qu’en assument les douze tribus d’Israël. Je suis frappé par ce chiffre douze. Les douze cloches
de Corneville sont-elles une allégorisation préfigurative de la réhabilitation d’une cause sur son
origine ?
2 Dominique Aubier, La 23e lettre de l’Alphabet hébreu. M.L.L. 2005. Si j’en crois la prévision de Rizal, cet ouvrage
retentira à grande volée!

XVII
L’équateur du cristallin
Ton œil a un droit sur toi
1. Rizal, l’écrivain opticien
Le corps médical peut s’enorgueillir de compter parmi les siens un grand auteur. Généraliste,
Rizal se spécialise dans l’ophtalmologie lors de son séjour à Paris, sous la direction de Louis de
Wecker, puis à Berlin avec le spécialiste Otto Becker. Sa motivation ? Sa mère perd la vue. En
fils reconnaissant, il étudie la science de la vision. En cette fin du XIX° siècle, l’ophtalmologie,
selon ce qu’indiquent les manuels techniques de l’époque, était déjà fort avancée.
Connue des Grecs, notamment par Hippocrate qui diagnostiquait avec assez de précision
certaines pathologies (uvéites, glaucomes etc.) elle s’est beaucoup développée en Egypte antique.
De nombreux documents furent trouvés dans les pyramides, aux pieds des momies, mentionnant
l’existence d’une médecine des yeux3. Les anciens avaient développé une impressionnante
pharmacopée. Mais il fallut attendre le XVIII° siècle pour qu’une révolution bouleverse les
usages de la médecine : l’ouvrage d’Antoine Maitre-Jean4 est un grand traité sur la cataracte, qui
reprend l’ensemble des notions connues à son époque. La description qu’il fait de l’œil et son
anatomie ainsi que sa connaissance des maladies du cristallin et des paupières gardent
aujourd’hui encore toute leur pertinence.
Les 100 premières pages de son ouvrage décrivent l’anatomie et la physiologie oculaires.
Antoine Maître-Jean s’est appuyé sur des expériences de chambre noire, de réflexion et de
réfraction de la lumière, de réfraction dans les verres concaves et convexes suivies d’application à
l’œil et de l’image projetée sur la rétine. Il en déduit que le cristallin n’est pas absolument
nécessaire à la vision, mais qu’il permet la vision précise.
Si j’en crois le site Internet spécialisé sur la question, sa volumineuse étude est un véritable
guide du praticien ophtalmologue. Les spécialistes modernes s’étonneront des précisions
chirurgicales de l’époque… Son livre marque une étape essentielle dans l’évolution des
connaissances des maladies oculaires et spécialement de celles du cristallin. Par ailleurs il
représente le premier traité moderne d’ophtalmologie, car il est un traité complet et
systématique, rédigé à partir d’expériences personnelles. Il est nettement plus important, plus
riche et plus systématisé que celui de son contemporain, Guillemeau. Rizal, infatigable lecteur, a
eu entre ses mains une édition de ce précieux livre dont quelques exemplaires se trouvent à la
Bibliothèque nationale où il s’était inscrit.
Il a certainement lu le traité de la cataracte et du glaucoma, de Pierre Brisseau5, et le traité
des maladies des yeux de Charles de Saint-Yves6. On ne peut être un ophtalmologue en fin de
3 Voir le site Internet http://www.snof.org/histoire/egypte1.html
4 Antoine Maitre-Jean, Traité des maladies de l’œil et des remèdes propres pour leur guérison enrichi de plusieurs
expériences de physique, Jacques Lebebvre, Troyes 1707.
5 Pierre Brisseau, Traité de la Cataracte et du Glaucoma éd. Laurent d’Houry, Paris, 1709
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%