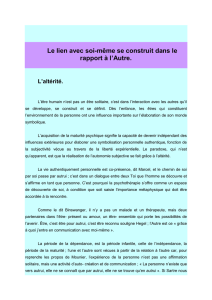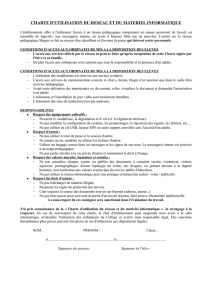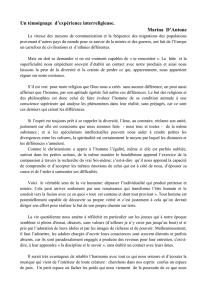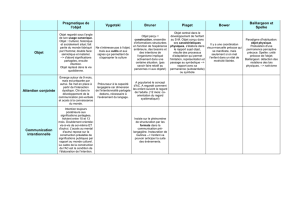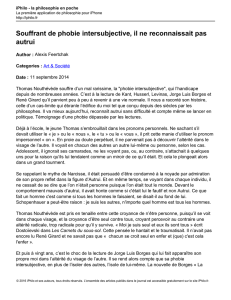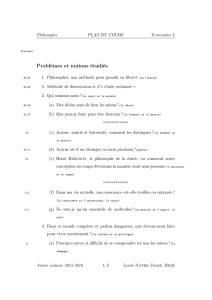UPS ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES

1
On trouvera ci-dessous le compte rendu des 29 séances (223 p.)
de l’atelier de philosophie sur
« le rapport à l’autre » (2008-2011)
de l’Université Populaire de Septimanie (Narbonne)
Animation Michel Tozzi
Nouveau site de l’UPS : http://upsnarbonne.unblog.fr/
2008-2009 (9 séances)
Université Populaire de Narbonne (UPS)
Site : http://perso.wanadoo.fr/universitepopu.septi
PÔLE PHILOSOPHIE
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Cycle sur le « le rapport à l’autre » (9 séances)
Année 2008-2009 (Cinquième année de l’atelier de philo de l’UPS,
première année sur ce thème)
Séance 1 du 27-09-08 9h45-12h15
(26 participants)
Séance de conceptualisation et de problématisation sur le rapport à l’autre
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Gérard
Synthétiseur : Jean-Francis
1) Introduction de la séance : Michel
1) Du sens des mots
Une problématique (nom) en philosophie, c’est la façon dont on pose un problème, une
question essentielle pour l’homme à laquelle il est difficile de répondre à cause de sa
complexité, et qui demande réflexion pour le résoudre (Est-ce d’ailleurs toujours possible ?).
Un jugement problématique (adjectif), c’est une affirmation qui se situe du point de vue du
vrai, mais qui demande examen, parce qu’elle pourrait être fausse : on la considère donc
comme douteuse sous bénéfice d’inventaire.
Un rapport, c’est un lien constaté, établi ou construit entre deux ou plusieurs termes du
langage, des choses, des êtres, des personnes. Ce lien peut être problématique, c'est-à-dire
poser problème.
Ainsi de mon (mes) rapport (s) à l’autre, à autrui.
Dans ce rapport à l’autre, quel est le sujet dont il est question ?
Ce peut être moi :
- moi en tant que Michel, dans ma singularité, et compte tenu de mon histoire ;

2
- moi, en tant que je m’identifie à un groupe (enseignant, Français…) ;
- plus généralement moi en tant qu’homme, espèce particulière ou genre avec ses
caractéristiques propres.
Et quel est l’autre terme du rapport : l’autre ? Cet autre :
- si c’est moi en tant qu’individu, ce sont les autres personnes, tous les autres sauf moi ;
- si c’est moi en tant que « nous » (les noirs, les homosexuels), l’autre, les autres, c’est « eux »
(les blancs, les hétéros) ;
- si c’est moi en tant qu’homme, l’autre, c’est le minéral (ce qui n’est pas vivant), le végétal,
l’animal (ce qui n’est pas doué de raison), Dieu (ce qui n’est pas fini), le cosmos (ce qui
m’enveloppe)…
Nous circonscrirons dans un premier temps la problématique abordée au rapport à l’autre
comme le rapport de moi-même à l’autre, ou d’un sujet humain à un autre sujet (ce qui
délimite le rapport envisagé dans la sphère de l’intersubjectivité).
Le rapport de moi comme sujet à un autre sujet est alors la façon dont j’entre en relation
avec lui. Mais qu’est-ce qu’entrer en relation ?
C’est la place, le rôle, le statut par exemple, qui typologisent les relations, les organisent.
Financièrement (débiteur-créancier) ; institutionnellement : par exemple hiérarchiquement
(être père ou fils de, maître ou élève de, maître ou esclave de, chef ou subordonné de, patron
ou salarié de, pape ou président de etc.) ; ou plus horizontalement : citoyen de, camarade de,
collègue de, ami de, mari de, amant de, veuve de… Ces relations peuvent avoir pour champs
des registres divers : sensible (les goûts), affectif, (amour/haine), intellectuel
(accord/désaccord sur des idées), social (les habitus semblables ou distincts), culturel,
juridique (la diversité des droits), politique (le rapport au pouvoir) ; elles peuvent affecter la
vie intime (amitié, amour), privée (copain), publique (citoyen, membre de tel parti, syndicat,
association) ; familiale ou professionnelle ; dans le cadre du travail ou des loisirs ; elles
peuvent être intersexes, intergénérationnelles, interclassistes, internationales etc. Elles
touchent tout ce en quoi les hommes peuvent individuellement ou collectivement se
ressembler ou différer, ce qui les met en relation d’affinité ou d’opposition, de
complémentarité…
Entrer en relation, c’est habiter ces jeux sociaux de place par l’attribution d’un statut, d’un
rôle, mais aussi en y impliquant sa personnalité propre de sujet singulier.
2) Moi, le même et l’autre
- L’autre comme différent
L’autre ce n’est pas le même, sinon je ne le désignerais pas comme autre : c’est le différent, le
dépaysant, l’étrange, l’étranger. C’est parce que je suis un individu que je suis original,
singulier, insubstituable biologiquement (par mon ADN), psychologiquement (chacun a sa
personnalité, sa propre histoire et sa mémoire propre) : il y aura toujours des traits distinctifs
qui me séparent d’un autre individu, fut-il mon jumeau. Il y a un lieu où personne n’a et ne
peut avoir rien de commun avec moi. Et inversement, l’autre a toujours un point où il diffère
de moi, et de tous les autres, où il est seul de son espèce, l’ensemble à un élément et un seul,
où il est le « moi unique ». Je suis donc différent de chacun et de tous, tous sont différents de
moi, et chacun diffère de tous les autres en tant qu’individu ou sujet. C’est la singularité qui
fait l’unicité de chacun, pour lequel tout autre est un autre, autre.
L’autre est aussi pour moi générique (tout autrui sauf moi). Mais aussi spécifique (certains
autres seulement). Il est tout ce par quoi je ne me définis pas, ni ne m’identifie,
individuellement par ma singularité ou collectivement par ma (notre) particularité : grand si je
suis petit, jeune si je suis vieux, femme si je suis homme, noir si je suis blanc, bouddhiste si je
suis chrétien, croyant si je suis athée, de droite si je suis de gauche, américain si je suis

3
français, africain si je suis européen, ouvrier si je suis cadre, du privé si je suis du public etc.,
que ce soit au niveau physique, psychologique, social, intellectuel, culturel…
- L’autre comme le même
Mais, et c’est là où la complexité commence, l’autre me ressemble aussi : la plante respire
comme moi, et l’animal comme moi se reproduit (nous sommes des êtres vivants). Par de
multiples traits d’appartenance, autrui est le même que moi (par son sexe, son âge, sa
profession, son milieu, sa ville, mais aussi ses droits etc.), qui sont autant de référents
communs, d’histoire(s) partagée(s). Au niveau le plus général, nous sommes tous des
hommes, biologiquement de la même espèce, éthiquement porteur des mêmes droits de
l’homme : telle est l’universalité de l’humaine condition, où l’autre est mon « alter ego », un
autre moi-même. Ce qui atténue sensiblement son altérité, sous ce rapport de l’universalité,
notamment l’altérité de sa singularité individuelle ou de ses particularités collectives.
- L’autre est donc à la fois le différent et le même. S’il n’y a pas contradiction, c’est parce
que ce n’est pas sous le même rapport, du point de vue de l’extension du concept : il est le
différent en tant que nous sommes chacun des individus singuliers, le même en tant que nous
appartenons à l’universalité du même genre humain. Mais cette dualité, dans sa tension
toujours possible, n’est pas évidente à penser (de quel point de vue je me place, y a-t-il une
meilleure place, et selon quel critère?), et encore moins à vivre (sous quel rapport j’aborde la
relation avec autrui, quelle est le meilleur et quel est le pire, psychologiquement,
politiquement, éthiquement ?).
3) « Soi-même comme un autre » (Ricoeur)
- Redoublement de la complexité : non seulement l’autre est aussi le même que moi, et pas
seulement le différent, mais moi-même je suis autre pour moi. En effet, je ne suis pas
totalement de la texture du même, homogène dans ma substance. Dans une conception
dualiste (Descartes), le corps est autre que la pensée ; pour Freud l’inconscient est autre que la
conscience etc. Il y a donc de l’autre en moi : du corps pour ma pensée, de l’inconscient
pour ma conscience, de ma conscience qui se regarde (introspection), de celle qui juge mes
actes (éthique personnelle). Ces dédoublements et clivages ne sont pas sans effet sur mon
identité, et mon rapport à l’autre.
- J’ai de plus une multiplicité d’appartenances, une « identité multiple ». C’est une richesse,
mais ces appartenances peuvent se faire concurrence, voire entrer en contradiction (Basque,
Français, européen et/ou citoyen du monde ; producteur et consommateur ; fils et père ;
enseignant et parent d’élève ; fumeur et écologiste, etc. : comment hiérarchiser en cas de
conflit ?) : ces appartenances à des mêmes deviennent autres sous un autre rapport, et posent
le rapport de soi à l’autre en soi, à plusieurs mêmes et autres en soi, à « soi-même comme un
autre ».
- L’autre en soi, c’est aussi, peut-être surtout les autres : la façon dont ils m’ont parlé avant
même que je ne sois né (en me nommant symboliquement), façonné par l’éducation, le milieu
familial (socialisation première), la classe sociale, l’école (socialisation secondaire), le travail,
la profession et « l’entreprise » (socialisation tertiaire), plus globalement telle région, tel pays,
telle aire civilisationnelle (pour moi la culture gréco-romaine et judéo-chrétienne). L’autre en
moi, c’est ma part d’acculturation, de socialisation, de langage, d’habitus incorporés. C’est
aussi l’image que je pense que l’autre (les autres) ont de moi, tout ce en quoi autrui m’a
affecté, tout ce en quoi il m’altère (me modifie par son altérité). L’autre en moi est ainsi un
certain rapport à soi par la médiation du rapport à autrui.
4) Définition de la notion et notions associées

4
Pour penser une notion (autrui), c’est-à-dire un mot de la langue relativement vague, il faut
chercher à le conceptualiser, c’est-à-dire lui donner un sens plus précis au terme d’un
processus de réflexion. On peut alors tenter de le définir
- en compréhension (ce qui permet de comprendre son sens), en déclinant ses attributs, ses
caractéristiques essentielles. Ex : c’est « un moi qui n’est pas moi » (Sartre), l’autre, le
différent, mais aussi mon prochain, mon semblable (Rousseau);
- ou en extension (ce à quoi le concept peut s’appliquer). Ex pour moi : Socrate ou Platon, et
tous les autres hommes.
Quelles notions alors nous semblent fondamentales à creuser pour éclairer qui et ce qu’est
l’autre, et mon rapport à l’autre, aux autres ? Quelle est la carte conceptuelle de la notion
d’autrui, les notions qui permettent de penser cette notion ?
Ce qui peut appuyer une pensée qui tente de penser à partir du langage est la convocation :
- de synonymes de la notion, ou de mots voisins : autre, altérité, distinct, différent,
dissemblable, séparé, étrange, étranger, inhabituel, original, nouveau, inconnu, insolite,
effrayant ; avec des connotations de divers, multiple, collectif ; et les notions d’écart,
contraste ; et aussi les mots-notions d’indifférence, contraire, discordance, disparité,
divergence, opposition, conflit, lutte ; mais aussi (et paradoxalement au premier abord
puisqu’il s’agit de l’autre) prochain, semblable, même, etc. ;
- de mots contraires, opposés, antonymes : moi, unique (autrui c’est les autres), particulier,
singulier, et aussi congénère, semblable, pareil, similaire, analogue, équivalent, comparable,
identique, égal, commun…
- de notions qui apparaissent essentielles dans la relation avec autrui dans notre expérience
humaine vécue (renvoyant moins au langage qu’au réel) : désir, séduction, amour, amitié,
don, charité, respect, reconnaissance, confiance, droit, devoir, promesse ; mais tout autant
intérêt, pouvoir, dépendance, domination, soumission, rivalité, conflit, lutte, guerre, haine,
mépris, et aussi indifférence etc.
7) Questions à creuser
Quelles sont les questions à (se) poser sur notre rapport à l’autre, aux autres ?
- Autrui est problématique en soi dans sa définition même, car il est à la fois le même et le
différent : comment penser cette dualité ?
- Notre rapport à autrui est problématique dans son ambivalence : ce peut être le meilleur
comme le pire ! Pourquoi et comment ?
L’autre, ami ou ennemi ? Trop proche ou trop lointain (Des hommes que l’on entasse
pourrissent comme des pommes, dit Descartes ; des hérissons qui veulent se tenir chaud se
piquent, dit Schopenhauer) ? Avec l’autre j’étouffe, sans lui je m’ennuie. « L’homme n’est
pas fait pour vivre seul » ou « Mieux vaut vivre seul que mal accompagné » ?
- Comment organiser ma coexistence avec l’autre (ex : le couple) ; d’autres (dans la famille,
l’école, l’entreprise, le hors travail, la société, l’Etat, le monde etc.) ? Qu’en est-il du lien
social de moi aux autres et des autres entre eux dans les sphères :
- de l’intersubjectivité, du privé, de l’intime, de l’affect ;
- du juridico-politique (loi, droits et devoirs) ;
- de l’économico-social (utilité sociale, contribution/rétribution) ?
6) Les penseurs de l’altérité
- Hobbes : « L’homme est un loup pour l’homme » (Léviathan). D’où l’exigence d’un
pouvoir fort pour assurer une coexistence pacifique.
- Rousseau : l’autre c’est mon semblable, cet être qui vit et souffre auquel je m’identifie dans
l’expérience privilégiée de la pitié (Discours sur l’origine de l’inégalité).

5
- Hegel : autrui est une donnée irrécusable comme existence sociale et historique, constitutif,
dans une relation intersubjective, de chaque conscience dans son surgissement même. Il se
définit comme désir, non simple désir d’objet, mais désir de désir, désir d’être reconnu. D’où
la lutte à mort (dialectique du maître et de l’esclave) pour la reconnaissance, où les
consciences ne se constituent et ne se reconnaissent que dans cette relation conflictuelle
(Phénoménologie de l’esprit).
- Sartre : « Autrui, c’est ce moi-même dont rien ne me sépare si ce n’est sa pure et totale
liberté, c’est-à-dire cette indétermination de soi-même que seul il a à être par et pour soi ». Par
son regard, autrui est une présence sans distance qui me tient à distance, me chosifie, faisant
de moi un destin (L’être et le néant) : « L’enfer, c’est les autres ».
- Husserl : autrui est l’autre que moi, donné non comme objet autre, mais comme alter ego.
L’expérience d’autrui est celle d’une intercorporéité : la comprésence de ma conscience et de
mon corps se prolonge dans la comprésence d’autrui et de moi (Méditation cartésienne).
- Heidegger : l’ « être-avec-autrui » est une expérience originelle, celle de l’ « être-avec », la
découverte de notre humanité commune (Être et temps).
- Lévinas : « Autrui en tant qu’autrui n’est pas seulement alter ego : il est ce moi que je ne
suis pas », cet infiniment Autre qui se dérobe à moi, et dont l’altérité radicale déborde sans
cesse l’idée que j’en ai. Ainsi paradoxalement, «cette absence de l’autre est précisément sa
présence comme autre » (Totalité et infini). Le visage de l’autre m’ouvre à la transcendance
divine. Il m’oblige, sans exigence de réciprocité.
Pause : 10’
2) Ecriture
Chacun formule, sous forme de question (une à 3 par participant), la problématique qui
l'intéressera cette année.
3) Décisions
Par quoi commencer pour les prochaines séances? En fonction de quelle
logique envisager la programmation de cette année?
La référence à des auteurs semble par ailleurs importante à un moment donné pour enrichir la
réflexion.
- Prochaine séance du 15 novembre : « L’identité », car il semble que pour penser mon
rapport à l’autre, il faut creuser la question de mon identité personnelle. Qui est MOI? Qui est
JE? Introducteur : Gérard.
- 3ième séance du 13 décembre : définition de « L’altérité » pour comprendre ce qu’est
« L’autre », phase nécessaire pour comprendre mon rapport à l’autre. Introductrice : Marcelle.
Les séances suivantes porteront sur la construction de la relation, dans ses dimensions
éthique et politico-sociale.
4) Synthèse des échanges et des questions par Jean-Francis
A) PRESENTATION par Michel
L'AUTRE peut être quelqu'un ou quelque chose (nature, cosmos): c'est tout ce qui est,sauf
moi. Mais qui est MOI ? Dans ma singularité ; dans mon groupe ; en tant qu'homme (Autre =
minéral,végétal, animal)
Donc de quel AUTRE va-t-il s'agir? Ici on peut décider de se limiter à AUTRUI.
- 1ère problématique : pourquoi y a t-il problème dans le rapport à l'Autre ? C'est que l'Autre
est à la fois comme moi et différent de moi. En effet, chaque individu est singulier, unique,
donc différent (l'A.D.N. est la preuve biologique de ma singularité). Mais l'Autre est aussi le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
1
/
227
100%
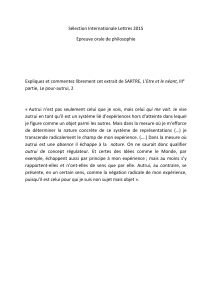

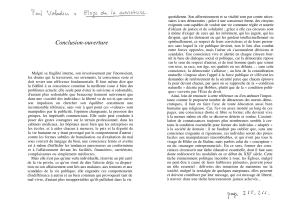
![Inscription de la séquence dans les programmes[1] de l](http://s1.studylibfr.com/store/data/007119161_1-080fc5b72510279fdade3b1afa55e3c0-300x300.png)