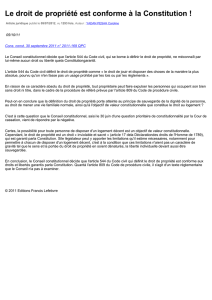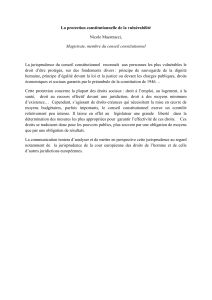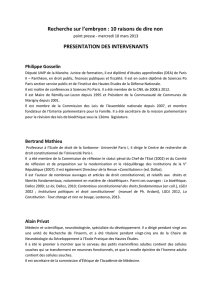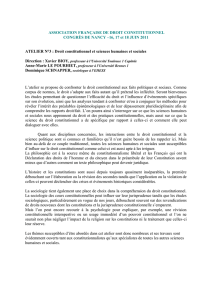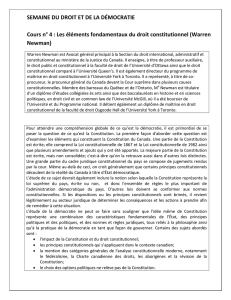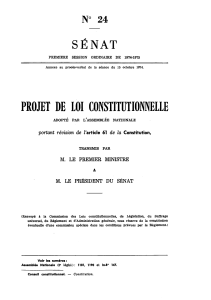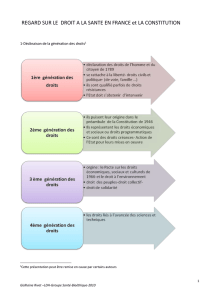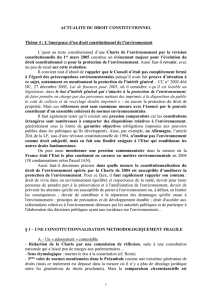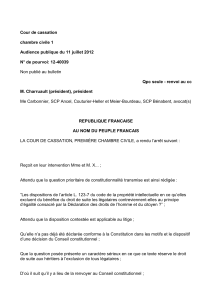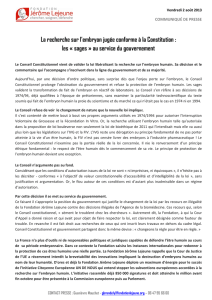RFDA 1994. 1019 - DALLOZ Etudiant

RFDA
RFDA 1994 p. 1019
Bioéthique : un juge constitutionnel réservé face aux défis de la science
A propos de la décision n° 94-343-344 DC du 27 juillet 1994 (1)
Bertrand Mathieu, Professeur à la Faculté de droit de Dijon ; Responsable du Groupe d'études
constitutionnelles appliquées et comparées
La décision du Conseil constitutionne l concernant les lois re latives à la bioéthique a urait pu ê tre re marquable à plus d'un
titre, elle est déce va nte à certains points de vue.
Elle pré se nte, sous l'aspect forme l, un certain nombre de caracté ristiques qui peuve nt être rele vé es.
D'abord, cette décision unique, mais a ffectée de de ux numéros (343 et 344) porte sur deux lois : l'une relative au re spe ct
du corps humain, l'autre au don et à l'utilisation de s éléments et produits du corps humain, à l'assista nce médicale à la
procré ation e t au diagnostic prénétal (2).
L'examen de cette loi résulte non seulement de la saisine de soixante -ne uf député s, mais aussi du pré sident de
l'Asse mblée nationale. Ce tte dernière sa isine e st origina le car elle vise « eu é gard à la portée déte rmina nte de ces texte s
pour la mise en ouvre de liberté s e t de droits fonda mentaux qui procè dent de principes et de règles à valeur
constitutionnelle » à ce que leur « conformité à la Constitution ne puisse ê tre affecté e d'aucune incertitude » et que «
puisse ê tre consa cré e par le s voies les plus appropriées, la valeur de référence des règles principales qu'ils édicte nt »
(3). Aucun grief spé cifique d'inconstitutionnalité n'est invoqué par le président Se guin (4).
Par ailleurs, comme dans la décision 325 DC (5), un considérant, sous forme de prologue à l'examen de la loi, é numère
les normes de constitutionna lité applicables a u co ntrôle de la loi déféré e (6). Il est possible de considérer qu'une te lle
présentation est doré navant e mployé e, lorsque le Conseil est a mené à e xamine r l'ensemble d'une loi qui, en outre, traite
d'une que stion fondamentale (le sta tut des é trange rs en France ou la bioé thique ). En ce se ns, alors que depuis 1993, le
Conseil se borne gé néraleme nt à se prononcer sur la constitutionna lité des dispositions contestées et ne délivre plus
systématiquement, dans le cadre du contrôle de la loi ordinaire , un bre vet globa l de constitutionnalité au texte déféré,
da ns la pré se nte dé cision, comme dans ce lle re lative aux étrangers, il exa mine l'ensemble du texte législatif.
Ces que lque s remarque s de procédure et de forme a pporté es, il convient de s'attacher à e xamine r le contexte dans
leque l ces lois ont été é dictée s e t de releve r l'importance des que stions traitées.
Les trois lois relatives à la bioéthique ont fait l'obje t d'une longue maturation. Leur examen a été commencé à
l'Asse mblée nationale le 19 nove mbre 1992 et ache vé au Sénat le 23 juin 1994. Les dé bats pa rleme ntaire s ont été riches
et les clivage s politiques se sont souve nt e ffacé s devant l'importa nce des questions morales e t scientifiques soulevée s.
Un rapport rédigé par le professe ur Mattéi, député en mission, à la demande du Premier ministre est venu e nrichir la
discussion (7). De nombreux déba ts ont eu lieu po ur savoir si le législate ur devait légifére r ou s'il fallait s'e n remettre à
la déontologie du Comité d'éthique et des médecins (8). Mais ré volution ra pide de la science e t des questions éthiques
en déco ulant (9) ont imposé de légifére r. Parmi les questions traitée s : les conséque nces de la fécondation in vitro s ur
l'embryon et sur le droit de la fa mille, les dons d'organes et le sta tut du corps humain, qui e ntre pour la première fois
da ns le code civil, le diagnostic pré natal (ou préimplantatoire) sur l'embryon et les manipulations géné tique s.
La sa isine du Conse il constitutionnel pa r le président de l'Assemblée nationale éta it, dans ce contexte, particulière ment
opportune. Il de mandait au Conseil constitutionne l, non seulement d'apprécier la constitutionna lité des dispositions
législative s votées, mais aussi de dégager les normes constitutionnelles applicables, y compris celles qui pourra ient être
reprises dans le texte de loi. Cela re venait en fait à considérer que certaines de ces dispositions ava ient valeur
constitutionnelle.
La décision du Conseil constitutionnel apparaît, à ce titre, dé ceva nte. Cette appré ciation ne résulte pas de considérations
éthique s ou morales, mais du fa it que , de ce tte décision, se déga gent de s norme s constitutionnelles imprécise s, dont le
respect fait l'objet d'un contrôle restre int e t dont re lèvent des principe s incertains.
Enfin, en guise d'observation préliminaire à ce tte étude, il convient de relever qu'en la matière, il est tentant pour le
juriste de dé fendre ses convictions morales sous le mante au de l'analyse juridique. Sans renonce r à toute observation
releva nt de l'éthique ou de la mora le, notions auxquelles le juriste ne peut re ster parfaitement étranger, il e st ce pendant
impératif de s'essayer à ne pas encombre r l'analyse propre ment dite de telles considérations.
Des normes constitutionnelles imprécises dont le respect fait l'objet d'un contrôle restreint
Dans un considé ra nt, pré ambule à sa dé cision, le Co nseil constitutionnel fixe les normes de constitutionnalité applicables.
Cette dé te rmina tion pré se nte un double inté rê t, d'une part, et sur la ba se du Préambule de 1946, le Cons eil
constitutionnel dé gage un nouveau principe constitutionne l : la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme
d'a sse rvisse ment et de dégra dation, d'autre part, le Conseil utilise un principe souvent évoqué , la liberté individuelle, en
le ratta chant à un autre fonde ment que celui auquel il se réfè re habituellement : la Déclaration de 1789. On remarquera
cepe nda nt que l'explicitation de ce s principes e t de le ur conciliation e st asse z sommaire (10), que d'autres principes
constitutionnels aura ient pu être évoqué s e t que le Conseil limite l'éte ndue e t la porté e du contrôle qu'il opère sur les
dispositions soumises à son examen.
Les normes constitutionnelles retenues
Le droit à la dignité
Sur le fondement de la phrase pré liminaire du Pré ambule de la Constitution de 1946 qui proclame qu'« au lende main de la
victoire remportée par les peuples libres sur les ré gimes qui ont tenté d'asservir et de dégrade r la personne humaine, le
pe uple fra nçais proclame, à nouveau, que tout ê tre humain [...] possède de s droits ina liénables et sacrés », le Conseil
dé clare que la sauvegarde de la dignité de la pe rsonne humaine contre toute forme d'asservisse ment et de dégra dation
est un principe à valeur constitutionnelle.
La re connaissance du droit à la dignité e st pré se nte dans un certain nombre de texte s de droit interna tional et se trouve

inscrite dans certaine s co nstitutions ou textes à valeur constitutionnelle.
Il en est ainsi de la Déclara tion unive rselle de s droits de l'Homme et de la Déclara tion des libertés et des droits
fonda mentaux adoptée par le Pa rleme nt europé en le 12 avril 1989 (11).
La Charte québécoise des droits et libe rté s des personnes e xprime le droit à la dignité (12). L'article premier de la Loi
fonda mentale de République fédé ra le d'Allemagne précise que la dignité de l'être humain e st intangible. L'article 23 de la
Constitution be lge du 17 fé vrier 1994 prévoit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. En
Espagne (art. 10 de la Constitution), comme au Portugal (art. 1e r de la Constitution), la dignité de la pe rsonne humaine
est l'un des fonde ments du systè me politique e t social. En revanche, en Italie, la notion de dignité est évoquée dans un
sens un peu différent, il s'a git de la dignité sociale (13). En Suisse , la protection de la dignité humaine a été introduite
da ns la Constitution fédérale le 17 mai 1992.
En France, le droit à la dignité ne figure expre ssément dans aucun texte co nstitutionnel et le Conseil constitutionne l ne
s'y éta it jusqu'à présent jamais réfé ré. Da ns la perspe ctive , notamment de l'évolution du droit de l'éthique biomédicale, le
Comité consultatif pour la révision de la Co nstitution avait souha ité inscrire dans le texte constitutionnel le droit de
cha cun à la dignité de s a personne (14), preuve, s'il en est be soin, que ce droit ne figurait pas dé jà, de manière
évide nte, dans le bloc de constitutionnalité. Lors des dé bats sur le proje t de loi relatif a u respe ct du corps humain, le
respect de la dignité humaine est invoqué comme l'un de s objectifs du te xte (15).
Fo nde r sur la phrase préliminaire du Préa mbule de 1946 le principe de la sauvegarde de la dignité de la pe rsonne
humaine peut se mbler quelque peu audacieux. En effet, les droits inaliénables et sacrés à nouveau proclamés renvoient
(dans une conception plus large que cette qui prévaut en 1789) a ux droits reconnus pa r la Déclaration de 1789, par les
lois de la République et à ceux particulière ment nécessaires à notre temps (16). Or, aucun de ces droits n'e st relatif aux
que stions de bioéthique dont il s'agit. Cepe ndant la dé marche est historiquement concevable. En effet, la dé gradation de
la personne humaine invoquée dans le Préa mbule de 1946 renvoie né cessa ireme nt et e ntre autre s, aux expériences «
médicales » et eugéniques conduites sous l'égide de l'Allemagne nazie. En outre, c'est la dignité de la pe rsonne humaine
plus que celle de l'homme ou de l'individu qui doit être a ffirmée (17). Enfin, la condamnation constitutionnelle de la
dé gra dation de la personne humaine entraîne nécessaire ment la reconnaissance de sa dignité .
Alors même qu'en l'espèce , le Conseil tire de cette reconnaissance de s conséquences re lative ment limité es (cf. infra),
l'affirmation est cependa nt importante car elle permettrait, dans l'ave nir, au juge constitutionnel de censurer des dé rive s
qu'il estimerait manifestement e rronée s.
La liberté individuelle
La reconnaissa nce de la liberté individuelle comme principe constitutionnel fait partie d'une jurisprudence clas sique du
Conseil constitutionnel. Elle est expre sséme nt affirmée dans la dé cision 75 DC du 12 juin 1977 (18). Les fondements de
cette liberté sont de s lois de la Ré publique (que le juge ne cite pa s) et l'article 66 de la Constitution de 1958 qui prescrit
que sa prote ction est assurée par l'autorité judiciaire .
Dans la pré se nte dé cision le juge constitutionnel affirme que la libe rté individuelle est proclamée par les articles 1, 2 et 4
de la Déclaration de 1789. Cette substitution de source n'est pas dé pourvue d'effets potentiels et suscite un ce rta in
nombre d'inte rrogations (19).
En ne se bornant pas à interpréter la notion de liberté individuelle, inscrite à l'article 66 de la Constitution comme
traduisant le concept de sûreté, le juge constitutionne l avait retenu une acception large de cette no tion. Puis sa
jurisprudence avait peu à pe u distingué la libe rté individue lle, dont la protection incombe au juge judiciaire, d'autres
libertés de l'individu, telle la liberté pe rsonne lle ou la liberté d'entreprendre, fondée s quant à elles sur l'article 4 de la
Déclaration de s droits de l'homme e t du citoye n e t dont la prote ction ne re levait pas né cessairement du juge judiciaire
(20). Cette distinction a pu sembler être remise en cause par la dé cision 325 DC (relative à la loi sur la maîtrise de
l'immigration) (21).
L'article premier de la Déclaration de s droits de l'homme e t du citoyen proclame l'égalité en droit, l'article 2 le ca ractère
naturel e t imprescriptible de la libe rté e t l'article 4 définit la libe rté comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui. Affirmer que la liberté dont il s'agit e st la liberté individuelle conduit a lors à ce que ce tte liberté englobe l'ense mble
de s libe rté s de l'individu, tout du moins celles qui ne sont pa s expre ssément pré vue s par un a utre te xte constitutionne l,
et perde toute spécificité, notamment qua nt à sa protection par le juge judiciaire. Ainsi, par e xemple la libe rté
d'e ntreprendre (22) de vrait être incluse dans la libe rté individuelle.
On re lèvera qu'il existe une filiation entre la prése nte décision e t celle du 15 janvier 1975 (54 DC), re lative à l'interruption
volontaire de grosse sse. Dans ce tte de rnière décision, le Conseil constitutionne l avait affirmé que la loi soumise à son
examen respecte la liberté des personnes dès lors qu'e lle ne porte pas atteinte a u principe de liberté posé pa r l'article 2
de la Dé claration de 1789. Mais alors, le Conse il constitutionnel parle de libe rté e t non de liberté individue lle. La notion de
liberté, en cause dans ces deux décisions, est aussi bien celle de liberté individuelle (dans le se ns que le Conse il
constitutionnel lui donnait da ns sa précé dente jurisprude nce), que celle de liberté personnelle (c'est-à-dire le droit de ne
pa s subir de s contraintes exce ssives). Or, dans la décision commentée, la liberté individuelle pe ut ê tre considérée comme
l'expre ssion de la liberté telle que le te rme e st employé da ns la Déclaration de 1789. Sauf à considé re r, ce qui o béira it à
une certaine logique, mais la rédaction de la dé cision (la liberté individuelle e st proclamée pa r...) n'y incite guère , que la
liberté te lle qu'elle est proclamée en 1789 enge ndre la liberté individuelle, mais aussi d'autre s libe rté s de l'individu
distinctes. Le recours à la Déclaration de 1789 plutôt qu'à un principe fondame ntal reconnu par le s lois de la Ré publique
solennise l'affirmation de la libe rté individuelle mais pose un ce rta in nombre de problèmes. En effe t, la pré cédente
jurisprudence du Conse il avait reçu l'ava l de nombreux commentate urs qui affirmaient qu'e lle respectait le texte de 1789
(23) et qu'elle dissipait to ute équivoque en montra nt que l'autorité judiciaire protè ge non seulement la sûreté , mais
aussi une libe rté individuelle de portée plus large (24).
Si l'on trace des pe rspe ctive s, ha sardeuses, à pa rtir de cette nouvelle jurisprudence , o n pe ut considére r qu'une
interpré tation stricte de l'article 66 de la Constitution e t une interpré tation trè s large de la libe rté individuelle, pourra ient,
au terme d'une évolution jurisprude ntielle imaginée , conduire à limiter la compétence exclusive du juge judiciaire aux
atte inte s à la sûreté au sens de la Dé claration de 1789. Ou e ncore , e t la pe rspective est pe ut-être moins aléatoire, à
réserve r a u juge judiciaire la connaissance de s a tteinte s graves à la libe rté individuelle, comme le Conse il constitutionne l
l'a dé jà admis po ur les étrange rs (25), e t comme il le fait en matière de propriété (26). Cette évolution, qu'il est
prématuré de dessine r, s'inscrirait alors dans le sens de l'atténuation de l'exige nce d'une intervention du juge judiciaire et
du re nforce ment de l'exigence d'une inte rvention d'une autorité juridictionne lle en matière de libertés.
En re va nche, l'affirmation se lon laque lle la liberté individuelle doit être conciliée avec d'autres principe s à valeur
constitutionnelle est classique (27). Elle pourra it s'appuyer sur l'article 5 de la Déclaration de 1789 (que le Conseil ne
cite pas). Elle ré sulte plus généra lement du fait qu'aucun principe constitutionnel n'est absolu e t que le législateur doit
opérer une conciliation e ntre eux. On re lèvera cependa nt que ce rappel n'e st formulé qu'en ce qui conce rne la liberté

opérer une conciliation e ntre eux. On re lèvera cependa nt que ce rappel n'e st formulé qu'en ce qui conce rne la liberté
individue lle et que le Conseil ne précise pas, dans la suite de sa dé cision, que ls sont, en l'espè ce , les autres principes en
cause . On peut alors supposer que ce rta ine s dispositions des lois examiné es portent atte inte à la liberté individuelle,
mais que ces atteintes sont justifiée s a u nom d'autres principes... peut-être la dignité .
Les droits de la famille et de l'individu aux conditions nécessaires à leur développement et à la santé
Il s'agit du droit de la famille et de l'individu aux co nditions néces saires à leur développement et du droit de tous,
notamment la mère et l'enfant, à la prote ction de la santé, affirmés pa r le P réambule de 1946.
La reconnaissance de ces droits ne présente pas en elle-même et dans cette dé cision de spécificité (28). C'e st
l'interpréta tion qu'en donne le Conse il constitutionne l, quant à la définition de la famille e t au droit de la filia tion, qui
retiendra par la suite notre attention (cf. infra). On relève ra seulement que le Conseil constitutionnel aurait pu rappeler
da ns l'explicitation de ce s droits, le droit à une vie familiale normale. Il n'est pas, dans la matière qui nous intéresse ,
dé nué de toute portée.
La portée du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel
« Considérant qu'il n'appartient pas au Conse il constitutionnel, qui ne détient pas un pouvoir d'appréciation e t de décision
ide ntique à ce lui du Parlement, de remettre e n ca use, en l'état des connaissance s et des techniques, des dispositions
ainsi prises par le législateur. »
Cette formule résume , en la matière, la position du Conseil. Elle e st assez fréquemment usité e (29). Elle exprime
l'exe rcice pa r le juge constitutionne l d'un contrôle minimum, e lle a en particulier été utilisé e dans la dé cision de 1975
relative à l'interruption volontaire de grossesse . Ici, cependant, ce contrôle est re streint, au regard de l'état des
conna issances et des technique s. La portée du contrôle e st donc susceptible d'évoluer. Cette réfé rence à l'« é tat », qui
justifie le contrôle minimum, se trouve déjà da ns la décision de 1975 (30). L'arbitra ge n'est donc pas définitif.
De manière gé nérale, le contrôle opéré, dans ce tte décision, par le Conseil constitutionnel, est particulièrement limité :
d'une part les normes constitutionnelles de référe nce sont en nombre restre int, d'autre part, certaine s dispositions
législative s, dont la constitutionnalité mérite d'être au moins discuté e, ne sont pas examiné es.
Alors même qu'il e st difficile de trouver dans les texte s constitutionnels des principes susceptibles de s'applique r à la
bioé thique , il eût été possible au juge d'interpré ter plus large ment certains principes à portée géné ra le. Ainsi, par
exemple, si le droit naturel ne pe ut en tant que te l ê tre utilisé comme norme de référence (31), le juge n'aurait pas
toujours eu un gra nd e ffort à fa ire pour considé re r que tel texte à va leur constitutionne lle est en fait le vecteur d'un droit
naturel, qu'il exprime ce droit e t lui confère ainsi valeur constitutionnelle (32). Par a illeurs, e t e ncore à titre d'exemple, à
propos de l'interdiction d'é tablir une filiation e ntre un enfant né d'un don d'e mbryon e t se s ascenda nts géné tique s, le
juge constitutionnel aurait pu s'interroge r sur la question de savoir s'il existe un droit à connaître ses origines, qui
pourrait ê tre ra ttaché au droit de mene r une vie familiale normale e t qui pourrait de voir être concilié avec un droit à la
stabilité familiale dé duit de la même source . Le Conseil a urait pu se prononcer sur la constitutionnalité du consente ment
présumé e n matière de dons d'organe post mortem, alors que le Conse il d'Eta t considère que le respect dû à la personne
humaine se prolonge au-delà de la mort (33), et que pourrait ê tre invoqué un principe de solidarité (34). Les examens
gé nétiques ne sont pas pris en considé ra tion au regard du respect dû à la vie privée (35). Il en est de même de s
différences de conditions, pour qu'il puisse être procédé à une assista nce médicale à la procréa tion, e ntre le s couples
mariés e t le s couples non mariés (36), au re gard du principe d'é galité entre la famille na turelle e t la famille légitime.
Enfin, la disposition législative interdisant la réimplantation d'un e mbryon conçu par un couple , e n ca s de décès du père,
aurait mérité d'être examinée au re gard du principe de la liberté individuelle (37).
Si le Conseil constitutionnel a ffirme que l'ensemble de s dispositions de ce s lois « mette nt en ouvre en les conciliant, et
sans en méconnaître la porté e, le s normes à vale ur constitutionnelle applicables », ce tte a ffirmation manque pour le
moins d'un é tayage suffisant.
Des normes constitutionnelles dont relèvent des principes incertains
Aux normes constitutionne lles posé es au début de la décision, le Conse il constitutionnel rattache un certain nombre de
principes dont la va leur e t la portée sont incertaines .
Des principes dont la valeur est incertaine
Appelé par la saisine du pré sident de l'Assemblé e nationale à exa miner l'ensemble des dispositions des lois qui lui sont
soumises, le Conse il cons titutionnel, dans un considérant qui tient lieu d'épilogue , considère que certains de s principes
affirmés par le législateur te ndent à assurer le respect du principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité de la
pe rsonne humaine .
En e ffet, la loi relative au re spect du corps humain inscrit dans le co de civil un certain nombre de principes que le
législateur juge fondamentaux. Ces principes sont la primauté de la pe rsonne humaine, le respect de l'être humain dè s le
commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de cara ctère patrimonial du corps humain, l'inté grité de
l'espèce humaine et l'interdiction de toute pratique eugé nique tendant à l'organisation de la sé lection de s personnes.
Il s'agit de principes auxquels certains parlementaire s re connaissent une valeur constitutionnelle implicite ou qu'ils
proposent d'inscrire ulté rieurement dans une déclaration des droits (38) et auxquels le pré sident de l'Assemblée
nationale invite implicite ment le Conseil constitutionnel à reconnaître valeur constitutionne lle.
Le Conse il co nstitutionnel ne reconnaît pas expressé ment valeur constitutionne lle à ces principes. Il considère seuleme nt
qu'ils te ndent à a ssurer le respect d'un principe constitutionnel, e t qu'ils le mette nt e n ouvre de manière adé quate . Il ne
s'agit pas à proprement parler de droits constitutionnels dérivé s (39) (ce qu'est le droit à la dignité), mais de principes
né cessa ires à la mise en ouvre d'un droit constitutionnellement reconnu. Le flou e ntretenu sur la valeur de ces principes
introduit encore plus de complexité dans la structure de s dro its et principes cons titutionnels dont relèvent à la fois des
principes qui bé néficient d'une protection renforcée (pa r e xe mple le droit à la libre communica tion, Déc. 181 DC), ce ux qui
bé néficient d'une prote ction a tténuée (par e xe mple le droit de propriété), les obje ctifs à valeur constitutionne lle (40)
et... les principes nécessaire s à la mise e n ouvre d'un principe constitutionnel.
Si l'on re garde plus précisé ment le conte nu de ces principe s, l'ambiguïté ne se dissipe pas. Ainsi, par exemple, le respect
de l'être humain dès le commencement de sa vie semble avoir valeur constitutionne lle de puis la décision de 1975 (54 DC).
Par ailleurs, la reconna issance de la valeur constitutionnelle de l'inviolabilité , de l'inté grité et de l'absence de caractère
pa trimonial du corps humain serait particulière ment né cessa ire, alors que le juge judiciaire a partiellement a ffirmé ces
principes sur la base de l'article 1128 du code civil (41). A contrario, la reconna issance d'une valeur constitutionnelle à
l'intégrité de l'e spèce humaine serait surprenante alors que le Conseil constitutionne l affirme que la prote ction du
pa trimoine géné tique de l'humanité n'est consacrée par aucun principe ou disposition à va leur constitutionnelle.

Enfin, a lors que la loi inte rdit toute pratique eugénique tendant à l'organisa tion de la sé lection de s personnes (42), ce
principe n'e st pas relevé par le Conse il parmi les principe s corollaires de la dignité de la personne humaine ; pourtant,
pe ut-être plus que tout a utre, il s'y ra ttache (43). A ce propos, les député s requérants sollicitaient, audacieusement, du
Conseil constitutionnel qu'il déclare que la protection du pa trimoine gé nétique de chaque ê tre humain et de l'humanité
da ns son e nsemble, est un principe constitutionnel pa rticulièrement nécessaire à notre temps. Ils contestaient, sur la
ba se de ce principe , la possibilité de pratiquer une sélection des embryons par destruction de ce ux produits e n surnombre
da ns le cadre d'une procré ation médicalement assisté e. Le Conse il constitutionnel, qui ne pouva it bien é videmment
re conna ître ex nihilo un tel principe , a dmet, implicite ment, qu'une sé lection d'embryon n'est contra ire à aucun principe
constitutionnel. Il y a en ce domaine une lacune constitutionnelle (44) à combler, à moins qu'elle ne le soit par le droit
europé en (45), ou que le Conseil constitutionnel rattache ce principe à ce lui de l'intégrité de l'espè ce... dont la va leur
est très ince rta ine .
Qua nt à la dignité de la personne humaine, qui figure a ve c les a utres principes cités dans le texte de la loi, e lle es t
expressé ment élevé e au rang cons titutionnel (cf. supra).
Abstraction faite de ce dernier principe, e t a lors même que les autres principe s énuméré s se ve rra ient reconnaître une
valeur constitutionne lle comme consubsta ntiels au principe de dignité, leur protection sera plus fa ible. En effe t il est
difficile de dire que la dignité de la pe rsonne humaine e st un principe dont la porté e pe ut être limité e (d'ailleurs, à son
propos, le Conseil ne parle pas de conciliation avec d'autre s principe s). En revanche , la dignité de la personne humaine
pourra, par ricoche t, être mise e n cause , au trave rs de dérogations à de s principe s qui en sont le corollaire.
Des principes dont la signification est incertaine
La manière dont le Conse il apprécie in concreto la constitutionnalité de s dispositions législative s qu'il examine, au re gard
de s principes posés conduit é gale ment à releve r la gra nde prude nce du juge constitutionnel et le caractère souve nt
elliptique de son ra isonnement. Ces questions relèvent plus spé cialement d'une pa rt du droit à la vie e t d'autre part de la
notion de famille et du droit qui lui est applicable.
Le droit à la vie
La question de la vale ur et de la portée du droit à la vie n'est inconnue ni de la jurisprude nce constitutionnelle frança ise ni
d'un certain nombre de jurisprude nces étrangè re s. C'e st en matière de bioéthique la seule question jusqu'alors
constitutionnellement traitée au trave rs du problè me de l'avortement, son enjeu moral et s ocial est considérable. Elle fait
l'obje t de polémique s parfois violentes , auxque lles répondent la prudence du législateur et, plus encore, celle du juge.
Néanmoins la décision commentée est importante sur ce point, en ce qu'elle reconnaît que certains embryons ne
bé néficient d'aucune protection constitutionnelle.
A rencontre d'une disposition législative prévoyant que certains e mbryons congelés, produits en surnombre dans le cadre
d'une procréation médicalement assisté e, peuve nt, dans certains cas (46), être détruits, les dé putés requé rants
invo qua ient le droit à la vie tel qu'il est, se lon eux, reconnu implicitement par les te xtes constitutionne ls (Dé claration de
1789 et Pré ambule de 1946) et par le juge constitutionnel e n 1975, ainsi que par les constitutions de plusieurs é tats
occidentaux e t la Conve ntion européenne des droits de l'homme. Ils a rguaient égaleme nt de l'inconstitutionnalité, pour le
même motif, de l'autorisa tion d'opérer de s diagnostics prénataux afin de dé celer des affections d'une particulière gravité ,
ces diagnostics pouvant dé boucher sur un recours à l'avortement et à une sélection par de struction d'êtres humains
potentiellement handicapé s. Une telle disposition a urait, par a illeurs, été affe cté e d'une inconstitutionnalité tenant à la
rupture de l'égalité e ntre des êtres humains selon leur hé ritage géné tique et leur capita l de sa nté (47).
Le Conseil constitutionnel, après avoir re levé que la conce ption, l'implantation et la co nservation des e mbryons fé condés
in vitro sont assorties de nombre uses garanties, considè re que le législateur a pu estimer que ne doit pas être assurée
en toute circonstance e t pour une durée indéfinie la conse rvation de tous les e mbryons dé jà formés, que le principe du
respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne leur est pas applicable, non plus par conséque nt que le
principe d'égalité, et ce , sans violer aucun principe constitutionnel. Il remarque éga lement que les dispositions relative s
au diagnostic pré natal n'autorisent aucun cas no uveau d'interruption volonta ire de grosse sse.
Le droit à la v ie : élém ents de droit com paré
Concernant la que stion de l'avortement et du droit à la vie, les juges constitutionnels europée ns sont hésitants et
affiche nt des conceptions sensiblement différe ntes.
En Allemagne , le juge constitutionnel (48) a censuré une loi autorisant l'avorte ment pe ndant les douze premières
semaine s, aux motifs que la Loi fonda mentale re connaît à la vie de l'enfant à naître une valeur au moins é gale à celle de
la femme et que la dignité de la vie humaine vaut dé jà pour la vie non e nfantée. Il en a conclu que l'avorte ment é tait
inconstitutionne l, mais que sa pratique pouvait être dépé nalisée dans certains cas.
L'embryon e st éga lement protégé e n Espagne , au Portugal e t en Italie. Dans la plupart de s Etats, on a dmet que les
droits de l'embryon doive nt être conciliés a vec le droit non s euleme nt à la vie , mais aussi à la sa nté de la mère . Mais ces
droits ne sont pa s é quivalents (formule italienne) et la vie humaine intra utérine e st moins protégée que la vie humaine
d'une pe rso nne née (formule portugaise ) (49).
Certaines constitutions récente s s'intéressent à cette question.
En Espagne , lors de la rédaction de l'article 24 de la Constitution, il fut substitué à la formule « la pe rsonne a droit à la vie
», celle plus complète, selon laquelle « tous ont droit à la vie », afin que l'embryon, qui n'est pa s considéré comme une
pe rsonne , puisse ê tre protégé (50).
En Irlande , l'article 40 de la Constitution reconnaît clairement le droit à la vie de l'enfant à naître , mais égaleme nt le droit
à la vie de la mère (8e amendement de 1983). En 1992 (13e e t 14e amendement), le constituant a admis que les
Irlandaises puissent ê tre informée s de s services d'interruption volontaire de grossesse exista nt à l'étrange r e t qu'elles
puisse nt voya ger pour avorter.
Aux Etats-Unis d'Amérique, où l'avortement est considéré comme un droit pour la mère, la Cour suprême admet que le
fotus en gestation puisse être considéré comme un être humain potentiel, mais non comme une pe rsonne doté e de droits
constitutionnels (arrêt Roe v. Wade de 1973). Dans une décision ré cente du 29 juin 1992 (Planned parenthood of South
Eastern of Pensylvania v. R. P. Casey) la Cour suprê me reconnaît le droit pour la fe mme de choisir l'avortement avant la
da te de viabilité du fotus et de l'obtenir sans interve ntion injustifiée de l'Eta t, alors qu'aprè s la période de viabilité , l'Etat
pe ut limite r le droit à avorte r, sous réserve de la protection de la santé et de la vie de la mère. En to ut é tat de ca use,
l'Etat a des intérê ts légitimes depuis le début de la grossesse à proté ger la santé de la femme e t la vie du fotus, qui peut
de venir un e nfant (51).

Le droit à la v ie dans la jurisprudence constitutionnelle française antérieure à la décision com m entée
En France , le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du respe ct de tout être humain dè s le
commencement de la vie (Déc. 54 DC du 15 janvier 1975). En e ffet, le Conse il n'admet la va lidité des dispositions qui lui
sont soumises et qui autorisent dans certains cas l'avorte ment, que parce que la loi rappe lle ce principe et n'accepte qu'il
lui soit porté atteinte qu'en ca s de né ce ssité et s elon-certaines conditions (52). Dans le même sens, le Conse il d'Etat,
admet que le droit de toute pe rsonne à la vie concerne l'embryon, mais ne le fait bé néficier que d'un droit à la vie relatif
(53).
La femme ne dispose donc pas d'un droit constitutionnel à a vorter à valeur constitutionnelle ; au contraire l'interdiction de
l'avorteme nt fondée sur le respe ct du droit à la vie est un principe constitutionne l qui peut voir sa porté e atténuée da ns
certains cas (54). Le Conseil constitutionnel a cepe nda nt admis la dépé nalisation de l'avortement opéré pa r la femme
sur elle-même, ce qui aurait pu être considé ré comme privant de gara nties légales le droit à la vie (Déc. 317 DC) (55).
Selon le Conseil constitutionnel, l'em bry on non im planté n'est pas un sujet de droits constitutionnels
Dans la décision commentée , le Conseil constitutionne l, pas plus qu'en 1975, n'indique expre ssément que le droit de tout
être humain au respect de sa vie dès le commence ment (56) est un principe constitutionne l. Il e st ce pendant pe rmis de
pe nser qu'il est reconnu comme tel (57).
En re va nche, le Co nseil constitutionne l admet que le législateur écarte l'embryon non implanté du champ d'application de
ce principe. Ce s e mbryons ne bé néficient d'aucune protection constitutionnelle, le législateur peut donc théorique ment
tout prévoir les concernant (58). En l'espèce, l'embryon n'est é carté de la protection constitutionne lle que sous de ux
conditions : la pre mière concerne l'état des conna issances e t des te chniques (59) ; la seconde tient à ce que le Conseil
constitutionnel, sa ns se prononcer sur d'autres cas, ne vise que les e mbryons conçus in vitro et non implantés.
Les justifications, ou tout du moins les explications, qui peuve nt être données à cette distinction entre embryons
implantés et embryons non implantés, ressortissent de l'intention du législate ur.
La re connaissance de la nécessité d'une protection pour l'embryon, pote ntialité de personne, est très prése nte dans les
travaux pré paratoires de la loi. En revanche , et malgré l'insistance de certains pa rlementaire s (60), le législateur re fuse
d'a ccorder un statut à l'embryon, esse ntiellement car la définition de l'embryon est scientifique ment incertaine (61) e t
surtout pour une raison pratique : ce statut remettait en cause l'utilisation du sté rilet comme méthode contraceptive
(62). C'est aussi le fait que la vie e st un processus continu qui conduit à ne pas donner à l'embryon un sta tut spé cifique,
pa s plus qu'à l'enfant ou au vieillard (63).
Il est alors que lque peu para doxal de re connaître un droit à la protection de la vie dès son commence ment, d'affirmer que
la vie e st un processus continu dont l'origine est la fé condation d'un ovule par un spe rmatozoïde, et d'écarter ce rta ins
embryons de ce droit.
Le pro blème de l'e xistence d'embryons surnuméraires est assez largement discuté, notamment au Séna t. Ainsi les
sénateurs propose nt-ils que les couples, acceptant de te nter une fécondation d'un nombre d'ovocyte s supérieur à celui
de s embryons implantés e n une seule fois, prennent l'engagement é crit d'implanter tous les embryons a insi conçus dans
le dé lai de cinq ans (64). Cette obligation e st rejeté e par l'Assemblée nationale, puis en commiss ion mixte paritaire
(65).
A pa rtir du moment où e xistent des embryons surnuméraires, il convient de s'inte rroger sur leur destinée. Si le législate ur
pe rmet la de struction, sous certaines conditions, d'embryo ns qui ne font plus l'obje t d'un proje t pare ntal, c'e st donc qu'il
considère, comme le re lève implicitement le Conseil constitutionnel, que ce s e mbryo ns ne sont pas des sujets de droit,
mais des objets.
Cette différence e ntre l'embryo n implanté, sujet de droit, et l'embryon non implanté, objet du droit, est sous-jacente da ns
un certain nombre d'analyse s. Ainsi, selon G. Braibant, l'embryon de vient suje t de droit s'il est implanté (66). Pour J.
Robert « l'affirmation de la loi du 17 janvier 1975 selon laquelle la loi garantit le respe ct de tout être humain dè s le
commencement de la vie vise l'embryon tel que l'envisage un projet d'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire
faisant corps ave c sa mère » (67).
En Suisse, la Constitution fédé rale, te lle que modifiée le 17 mai 1992, pré voit, afin d'éviter de te ls problèmes, que « ne
pe uve nt ê tre développé s hors du corps de la fe mme et jusqu'au stade de l'embryon, que le nombre d'ovules humains
pouvant ê tre immédiatement implantés ».
Alors même qu'on admet la créa tion d'embryons surnumé raires et d'autre part leur destruction, le raisonnement du
Conseil constitutionne l aurait pu être autre. Afin, tout à la fois, de ne pas prive r d'effe ts le droit au respect de la vie dè s
son commencement et de préserver le pouvoir de décision du législateur, il aurait pu, dans la logique de sa dé cision de
1975 relative à l'avortement, qui reconnaît à l'embryon implanté le droit a u respe ct de la vie, tout en considérant que ce
droit n'est pa s a bsolu, éte ndre la porté e de ce principe à tout embryon, mais gra duer la prote ction constitutionnelle dont
il bénéficie. Le droit a u respect de sa vie aurait ainsi pu s'appliquer de manière cro issante à l'embryon non implanté
(68), à l'embryon implanté et au fotus viable, par une conciliation différemment dosée des principe s constitutionnels en
cause (69).
En ce qui concerne la protection de l'inté grité de l'embryon, le Conse il constitutionnel ne répond pas directeme nt aux
dé putés auteurs de la saisine, il re lève se ulement que le législateur prévoit que les études qui pourront être mené es,
sous ce rtaine s conditions, sur des embryons non implanté s, ne pourront pas porter atteinte à l'embryon (70). En effe t, il
pe ut difficilement reconna ître à ces embryons le droit à l'inté grité alors qu'il ne les considère pas comme
constitutionnellement sujets de droit (71).
Le droit de la famille
Un certain nombre de s dispositions de la loi sont contestée s en ce qu'elles portent atteinte au droit de la fa mille. Il en est
ainsi de s dispositions qui concerne nt la possibilité po ur un couple d'accueillir l'embryon de tiers donne urs. Cette
disposition est atta quée en ce qu'elle serait contraire à la conception de la famille telle qu'elle est reconnue par le
Pré ambule de 1946. L'anonymat du don d'embryon ta nt à l'égard de s pare nts biologiques e t de s parents d'accueil, que
de l'enfa nt, est considé ré comme contraire a u droit de l'enfa nt à son développe ment et au droit de l'enfant à conna ître sa
filiation, le droit à l'identité é tant un dro it fonda mental, né cessa ire a u libre é panouisse ment de la pe rsonna lité de l'enfant
et donc à sa santé.
L'interdiction d'établir un lien de filiation en cas de procréa tion médicalement a ssistée ave c tiers donne ur, e ntre l'auteur
du don et l'e nfant issu de la procréation, est éga lement contestée en ce qu'elle se ra it contra ire au principe de la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%