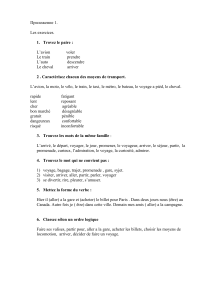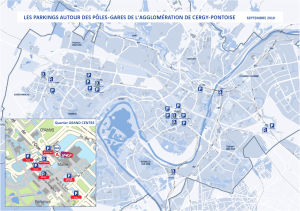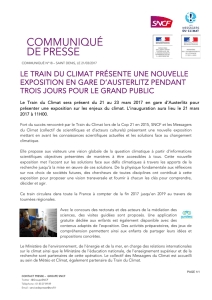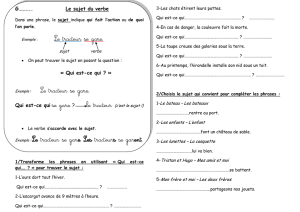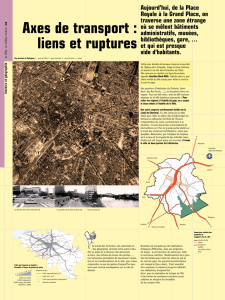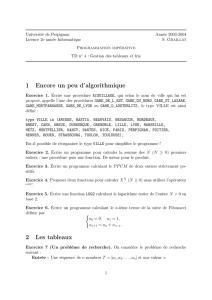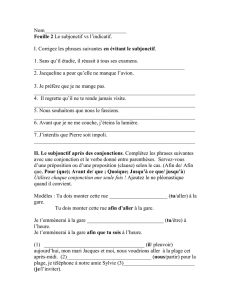(1,5 mo) / the dissertation`s pdf file

FONDATION NATIONALE DES
SCIENCES POLITIQUES
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE
PARIS
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA
DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E
RICERCA SOCIALE
La production organisée de l’ordre.
Contrôler des gares et des centres commerciaux à Lyon et à Milan
THESE POUR LE DOCTORAT DE L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS ET DE
L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
MENTION SOCIOLOGIE
PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT PAR
François Bonnet
Le 20 janvier 2006
Directrice de la thèse : Ota de Leonardis, Professore ordinario, Università degli Studi di
Milano Bicocca
Directeur de la thèse : Patrick Le Galès, Directeur de recherche, CNRS / CEVIPOF
COMPOSITION DU JURY
Ota de Leonardis, Professore ordinario, Università di Milano-Bicocca
François Dubet, Professeur des universités, Université Bordeaux-2 ; Directeur
d’études, EHESS (Rapporteur)
Yves Grafmeyer, Professeur des universités, Université Lyon-2 (Rapporteur)
Hugues Lagrange, Directeur de recherche, CNRS / OSC
Patrick Le Galès, Directeur de recherche, CNRS / CEVIPOF
Enzo Mingione, Professore ordinario, Università di Milano-Bicocca (Président du
jury)

2
RÉSUMÉS
Résumé Ce travail s’intéresse aux questions de sécurité et de contrôle social et pose le problème de la
production de l’ordre dans des espaces urbains comme les gares et les centres commerciaux. Quels
acteurs mènent quelles politiques de sécurité envers quels groupes sociaux et pourquoi ? La réponse
s’appuie sur un examen de la littérature théorique et sur une enquête de terrain menée sur quatre sites :
deux gares et deux centres commerciaux à Lyon et à Milan. Les méthodes utilisées sont l’observation
directe, plus de 90 entretiens et l’analyse de documents. Pour expliquer comment des acteurs organisés
produisent de l’ordre, il faut articuler les différents niveaux d’analyse de la sociologie (micro, meso,
macro). La thèse est donc organisée autour de trois problématiques. La première problématique est
celle des acteurs de la production de l’ordre et des enjeux qui animent la définition des politiques de
sécurité qu’ils mettent en œuvre. Dans cette partie, on montre que acteurs et acteurs privés sont animés
par des logiques différentes qui dépendent des enjeux de leurs commanditaires. La police a des enjeux
d’ordre public, qui la conduit à mener des politiques de sécurité bien spécifiques. Les centres
commerciaux et les compagnies ferroviaires ont des enjeux commerciaux, qui les conduisent à mener
des politiques différentes. La situation de concurrence sur le même espace crée des tensions qui sont
résolues différemment en France et en Italie en fonction du contexte institutionnel. La deuxième
problématique est celle des relations de pouvoir qui se jouent au niveau micro sur chaque espace entre
les acteurs de la production de l’ordre et les populations considérées comme potentiellement
menaçantes pour l’ordre. L’enquête de terrain montre que la plupart de ces populations parviennent à
instaurer un rapport de force qui contraint les organisations dans la mise en œuvre des politiques de
sécurité. Les politiques de sécurité réellement mises en oeuvre ne sont donc pas seulement définies par
des organisations, elles sont aussi le produit des interactions quotidiennes au niveau micro entre
acteurs de la production de l’ordre et populations déviantes. La troisième problématique est celle des
groupes-cibles des acteurs de la production de l’ordre. A Lyon et à Milan, dans les deux gares et les
deux centres commerciaux, les populations considérées comme menaçantes sont invariablement les
immigrés en Italie et les enfants des immigrés en France. Ce constat pose un problème
d’interprétation : s’agit-il d’une réponse fonctionnelle à une sur-délinquance ou à la sur-
criminalisation d’un groupe social ? Les données du terrain montrent que la question ne se réduit pas à
une sur-délinquance des immigrés, ni à un effet de structure du marché du travail. Dans les deux pays,
les entretiens révèlent la mise en œuvre de classifications « eux » / « nous » par rapport aux immigrés.
L’incrimination des immigrés n’est donc pas qu’un effet de logiques d’acteurs rationnels. Ce travail
suggère donc de formuler une hypothèse fonctionnaliste de l’incrimination des immigrés : dans des
sociétés européennes en recomposition, assimiler immigration et criminalité permettrait de raffermir la
solidarité du groupe majoritaire.
Summary
This work addresses the issues of security, social control and focuses on the problem of the
production of order in urban spaces such as railway stations and shopping centers. Which actors
follow which security policies towards which social groups and why? The answer is based on
theoretical work and on fieldwork carried out in four sites: two railway stations and two shopping
centers in Lyon and Milan. The methods employed include direct observation, more than 90
interviews and archival research. To explain how order is produced, it is necessary to articulate the
various levels of analysis in sociology (micro, meso, macro). The thesis is therefore organized around
three problems. The first problem is that of the actors of the production of order and the stakes which
animate the definition of the security policies that they implement. Private actors and public actors are
animated by different logics which depend on the stakes of their auspices. The police have stakes of
public order, which lead them to follow specific security policies. Shopping centers and railway
companies have commercial stakes, which lead them to follow different policies. Competition within
the same space creates tensions which are resolved differently in France and Italy according to the
institutional context. The second problem is that of the power relationships one can find at the micro
level on each space between the actors of the production of order and the populations considered as

3
potentially threatening. Fieldwork shows that the majority of these populations manage to establish a
power relationship that constrains organizations to implement more tolerant security policies. The
actual security policies are not just socially defined, they emerge out of the micro-level daily
interactions with the deviant populations. The third problem is that of the relationship between the
production of order and immigration. In Lyon and Milan, in both shopping centers and both railway
stations, the populations considered as threatening by the police and commercial stakeholders are
invariably the immigrants in Italy and the children of immigrants in France. This finding raises a
problem of interpretation: is the penal focus on immigrants a functional response to over-delinquency
or is it over-criminalization of particular social groups? Data show that the question cannot be reduced
to the over-delinquency of immigrants, nor it is a by-product of the labor market. In the two countries,
interviews reveal “us”/“them” classifications based on immigration. Immigrants incrimination relies
therefore not only on rational-action schemes. This work therefore suggests the formulation of a
functionalist hypothesis of the incrimination of the immigrants: in European societies facing profound
social change, to merge the issues of crime and immigration may enhance the solidarity of the
mainstream social group.
Sintesi Questo lavoro si occupa della produzione dell’ordine in spazi urbani, quali stazioni
ferroviarie e centri commerciali. Ci si interroga su quali politiche di sicurezza vengono messe in atto e
verso quali gruppi sociali queste sono orientate. Lavoro teorico e ricerche di campo effettuati in
quattro luoghi, due stazioni ferroviarie e due centri commerciali a Lione e Milano, offrono risposta a
questi interrogativi. I metodi impiegati comprendono l’osservazione diretta, piu’ di 90 interviste e la
ricerca d’archivio. Per spiegare come l’ordine viene prodotto, e’ necessario collegare diversi livelli di
analisi sociologica (micro, meso, macro). La tesi si articola quindi attorno a tre interrogativi. Il primo
e’ relativo agli attori produttori dell’ordine e degli obiettivi che ispirano la definizione delle politiche
di sicurezza da essi messe in atto. Infatti, attori privati ed attori pubblici sono animati da logiche
differenti che dipendono tanto dagli obiettivi quanto dalle aspettative che questi hanno. La polizia si
pone obiettivi di ordine pubblico, che la spingono a seguire determinate politiche di sicurezza. I centri
commerciali e le aziende ferroviarie hanno invece obiettivi commerciali, e quindi mettono in atto
politiche differenti. Il conflitto latente tra questi due tipi di attori viene risolto diversamente in Francia
ed Italia a seconda del contesto istituzionale. Il secondo interrogativo concerne i rapporti di potere a
livello micro tra gli attori responsabili dell’ordine e le categorie sociali che rappresentano una
potenziale minaccia di tale ordine. La ricerca di campo suggerisce che la maggior parte di questi ultimi
riesce a stabilire un rapporto di potere che costringe gli attori responsabili dell’ordine ad attuare
politiche di sicurezza piu’ tolleranti. Le politiche di sicurezza non sono semplicemente definite
socialmente, bensi’ emergono dalle micro-interazioni quotidiane tra produttori dell’ordine e
popolazioni devianti. Il terzo interrogativo riguarda il rapporto tra produzione dell’ordine ed
immigrazione. In entrambe stazioni e centri commerciali la popolazione percepita come potenziale
minaccia dalla polizia e dai consegnatari commerciali sono invariabilmente gli immigrati – in Italia –
ed i figli di immigrati – in Francia. Questo solleva un problema di interpretazione: il focus penale sugli
immigrati puo’ essere una risposta funzionale al livello di delinquenza di tale gruppo sociale oppure
puo’ essere interpretato come un fenomeno di sovra-criminalizzazione di uno specifico gruppo sociale.
I dati indicano che il fenomeno non puo’ essere ridotto alla sopra-delinquenza degli immigrati, ne’ e’
un sottoprodotto del mercato del lavoro. In entrambi i paesi, le interviste mostrano il diffuso utilizzo di
una classificazione “noi”/ “loro” basata sulla distinzione tra cittadini ed immigrati. L’incriminazione
degli immigrati non e’ quindi interpretabile esclusivamente secondo schemi di azione razionale.
Questo lavoro suggerisce un’interpretazione in chiave funzionalista dell’incriminazione degli
immigrati : nelle società europee, l’equazione « immigrazione uguale criminalità » pottrebbe
aumentare la solidarietà del maggiore gruppo sociale.

4
À Naïma

5
REMERCIEMENTS
Après avoir passé quatre années dans trois institutions universitaires, quatre villes et sept
appartements différents, j’ai beaucoup de monde à remercier, et je ne voudrais pas que la valeur de ma
gratitude soit diluée par la longueur de la liste.
Ma passion pour la sociologie doit beaucoup au corps professoral de Sciences Po : merci à
Louis Chauvel, Marco Oberti, Edmond Préteceille et Agnès van Zanten. Que mon travail ne leur fasse
pas honte.
Mon travail de thèse a débuté à l’Université Milan-Bicocca où j’ai été chaleureusement
accueilli par Alberta Andreotti, Enzo Mingione, Fabio Quassoli, Tommaso Vitale et ma directrice de
thèse Ota de Leonardis. Merci aussi à mes collègues et néanmoins amies du doctorat européen Urbeur,
Barbara Da Roit, Mariana D’Ovidio, Stefania Sabatinelli et Anna Ferro. Merci du fond du cœur à
Gianluca Argentin, Carlo Barone, et Michele Schiavone, qui m’ont hébergé à mon arrivée, et à
Davidde De Yanna qui m’a appris à parler italien (et à cuisiner). Merci à Aurélie Pourreau.
Je suis ensuite revenu en France, d’abord à Paris, dans le cadre du master du Centre de
sociologie des organisations. Merci à Erhard Friedberg, Annick Heddebault et à Christian Mouhanna.
Merci aussi à Héloïse Durler. Puis je suis parti faire mon terrain à Lyon. Merci à mes parents de
m’avoir supporté, merci à Benoit Cret pour m’avoir permis d’ouvrir le terrain du centre commercial,
merci à Claire Combe de m’avoir suggéré d’étudier la gare de la Part-Dieu. Merci à Romain Vian et
Anne-Sophie Bonnet pour leur implication à me trouver des interviewés. Merci à Edith Boncompain et
Vincent Pasquini, qui m’ont hébergé à Paris plus que de raison.
Je suis reparti à Milan, et je dois louer l’efficacité de Barbara Da Roit et de Franco Rampi à
m’ouvrir les terrains. Sans eux, je ne sais pas comment j’aurais fait. Merci à Loredana Carletti et
Mathias Noschis, qui m’ont aidé dans mes démarches auprès des autorités de la gare et du centre
commercial. Merci à Cristian Poletti pour toutes les précieuses informations qu’il m’a communiquées
sur la police italienne. Merci aussi au réseau de chercheurs européens RTN UrbEurope, financé par la
Commission européenne, qui m’a offert une bourse et l’occasion de présenter mes travaux dans des
conférences avec des doctorants européens. Merci beaucoup à Raphaël Madinier.
Puis je suis revenu à Paris, où je remercie Erhard Friedberg et David Colon de m’avoir fait
confiance pour enseigner en premier cycle à Sciences Po. Merci à mes étudiants, qui ont certainement
fait plus pour mon édification que je n’ai pu le faire pour eux. Merci à Hugo Bertillot et Naïma Makri,
qui ont beaucoup lu et discuté mon travail. Merci aussi à Alexandre Lambelet. Merci pour tout à
Romain Vian (et pour le reste, aussi).
Enfin, je suis parti finir la rédaction à New York, au département de sociologie de Columbia
University. Merci au Centre américain de Sciences Po et à Sudhir Venkatesh de m’avoir offert cette
merveilleuse opportunité. Eva Rosen et Sudhir Venkatesh m’ont généreusement accueilli au Center for
Urban Research and Policy. Merci à Frédéric Gilli, Charles Tilly et à Diane Vaughan. Merci à Yassi
Janhanmir qui m’a accueilli à mon arrivée.
Merci pour tout à mes parents ; merci à Marc Bonnet, qui a lu et relu et discuté plus souvent
qu’à son tour les différentes versions de ce travail.
Enfin, merci à Patrick Le Galès. Je ne sais pas comment lui dire.
Bien entendu, je ne veux pas associer toutes ces personnes estimables aux imperfections de
ce travail. J’en reste le seul responsable. Attribuez-leur le bon et laissez-moi le reste.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
1
/
278
100%