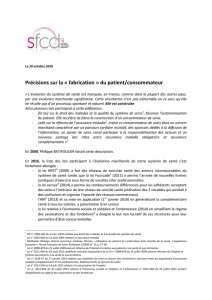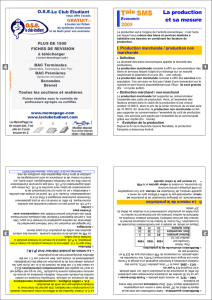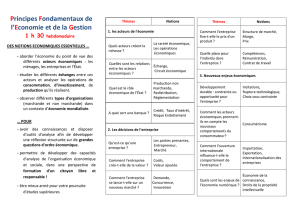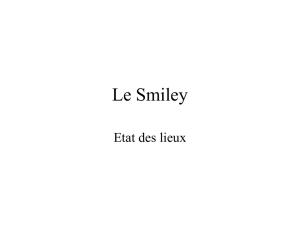La crise de l`assurance maladie est-elle imputable à l

La crise de l’assurance maladie est-elle imputable à l’orientation
marchande de l’État social ?
Philippe BATIFOULIER EconomiX, Université Paris X-Nanterre.
Jean-Paul DOMIN OMI-LAME, Université de Reims Champagne-Ardenne.
Maryse GADREAU LEG, Université de Bourgogne.
Résumé
En mettant au premier plan le rôle des représentations, ce texte propose une lecture de l’inclinaison
marchande du système de santé français. Pour penser le marché, il faut partir de l’Etat social et de sa
capacité à construire une forme de marché en s’appuyant sur les ressources cognitives du référentiel
marchand de politique publique et sa déclinaison locale ; sur les mécanismes de corégulation illustrant
le rôle des acteurs libéraux de la réforme ; et sur la nouvelle vision de l’assuré social faisant du patient
un consommateur souverain et responsable.
Abstract
This paper proposes a reading of the “reform” of the French health system, emphasizing the
diffusion of a «market toolbox» by the public policy. French social state never has intervened so much
in the health policy as these last years in order to apply market mechanisms both in the ambulatory and
hospital medical sectors. This economic policy modifies the actors’ representations and produces a
new physicians’ and a new patients’ market-based behaviour.
1. INTRODUCTION
Le dernier rapport de la Cour des Comptes chiffre les dépenses de santé à 41,7 % des dépenses des
régimes de base en 2004, talonnant ainsi les dépenses liées à la vieillesse (42,4 %, la famille
représentant 13,1 % et les accidents du travail 2,9%). Les dépenses de santé représentent environ 10%
du PIB (5,6% en 1970 et 8,6% en 1990) et la croissance annuelle moyenne ces dernières années est de
5 à 6%. Ces dépenses ne posent problème que si l’on ne peut (ou veut) pas augmenter les recettes.
L’entrée dans le domaine de la santé par le déficit fournit alors le décor à la dramatisation. Le solde du
régime général en 2004 est de - 13,2 milliards dont 12,3 milliards pour l’assurance maladie et le déficit
cumulé 2003-2006, pour cette seule branche, avoisine les 40 milliards d’euros. Ainsi le « trou de la
Sécu » est-il aujourd’hui celui de l’assurance maladie.
Les explications traditionnellement données à cette augmentation chronique de la dépense de santé
insistent sur la nature du bien santé (un bien supérieur, un bien premier naturel, un bien en soi, etc.),
sur l’évolution démographique (avec l’effet du vieillissement qu’il reste à évaluer par comparaison
avec l’effet de la proximité de la mort), et sur les pratiques « irresponsables » des acteurs (patients
comme médecins). Ce dernier type d’explication est privilégié par la microéconomie de la santé qui
met en avant la possibilité de manipulation offerte aux acteurs disposant d’un avantage informationnel.
Dans cet esprit, les dernières réformes, présentées comme étant à la fois structurelles et
exceptionnelles cherchent à combattre l’aléa moral du patient (notamment en durcissant les politiques
de ticket modérateur et en sanctionnant le nomadisme avec l’instauration d’un « parcours de tarifs »
qui constitue le corollaire du « parcours de soins »). Les médecins sont par contre épargnés par les
réformes récentes, non pas parce qu’ils sont jugés moins potentiellement fraudeurs que les patients
mais du fait de leur pouvoir politique et de la difficulté, souvent mentionnée, de faire une réforme
contre les médecins. C’est donc l’impuissance de la politique publique ou le blocage politique qui
expliqueraient la hausse incontrôlable des coûts, en empêchant la mise en oeuvre de mécanismes
incitatifs et concurrentiels susceptibles de conduire les individus à plus de vertu.
La crise financière de l’assurance maladie est donc une crise de la régulation publique, incapable
de mettre en œuvre des remèdes connus à la suite d’un diagnostic présenté comme allant de soi. Ce

2
texte cherche à étayer une autre conception de l’inefficacité publique où la « crise » de l’assurance
maladie est imputable à l’orientation marchande de l’État social et à sa traduction dans le secteur de la
santé.
Les choix de gouvernance de l’assurance maladie tracent depuis les années 1980 une trajectoire
marchande au système qui s’accélère ces dernières années. L’un des traits marquants de l’évolution du
système de santé est en effet l’existence d’une désocialisation. Les mécanismes de coassurance, faisant
acquitter une part de plus en plus lourde au patient, constituent une mutation majeure du financement
de l’assurance maladie. Parce qu’elle s’exprime par un mécanisme de balancier où la part de
l’assurance obligatoire diminue en même temps que la part de l’assurance complémentaire augmente,
cette désocialisation peut être vue comme une preuve de la prégnance des mécanismes marchands
dans la régulation de l’assurance maladie. La couverture privée, investissant les espaces laissés
vacants par la couverture publique, développe les mécanismes de marché et conduit à une privatisation
rampante du système.
Cette lecture de l’inclinaison marchande du système de santé n’est pas sans fondement quand elle
souligne que l’extension marchande à un secteur dit « à imperfections » ne peut se faire sans
l’intervention de l’État. Le marché n’investit pas naturellement les espaces de la santé. Il a besoin de
l’État, ce qui brouille le clivage traditionnel entre État et marché.
Si l’Etat construit cette forme de marché de la santé, il devient nécessaire d’éclairer la politique
publique au regard de critères marchands. Or, la vision « classique » (en matière de protection sociale)
d’une prévoyance privée qui se construit par retrait (« retrenchment ») de l’État, n’est pas totalement
pertinente pour le système de santé français. En effet, l’intervention centralisée n’y est pas en reflux. Il
semble au contraire que le système de santé français soit caractérisé par une accélération de
l’intervention de l’État. Ainsi, la désocialisation du système s’accompagne d’une « Étatisation » ou
d’une « planification » de la santé (BARBIER, THERET, 2004).
Cette forme très particulière de marché qui s’installe ne peut donc s’appuyer sur la notion usuelle
de marché (walrasien) qui n’existe pas, ni même (uniquement) sur l’existence d’un marché qui
s’engouffre dans les espaces laissés vacants par la régulation publique. La notion de marché qui
semble pertinente en matière de santé est celle de « marché institué » reposant sur des évolutions
historiques et sociales et prenant des configurations diverses selon les arrangements institutionnels
(CORIAT, WEINSTEIN, 2005). Dans cette conception, l’Etat qui construit ce marché, doit être pensé en
complémentarité au marché et non en opposition. Il étend le marché à des secteurs qui ne sont pas –
naturellement- dans le registre du marché.
En soulignant que l’orientation « marchande » du système de santé français relève d’une politique
volontariste des pouvoirs publics, la partie 2 du texte souligne le rôle d’un référentiel marchand sur les
représentations des acteurs et son expression particulière en matière de santé. Ce référentiel sectoriel
produit du sens en pointant les problèmes jugés importants, en délimitant l’espace des solutions, en
indiquant aux acteurs les ressources pertinentes, en forgeant un régime des "bonnes idées", etc. Il se
diffuse en rencontrant des forces et valeurs, propres à la configuration française. C’est pourquoi, la
façon de « faire marché » s’inscrit dans des logiques nationales de protection sociale et des
arrangements institutionnels situés. On cherche à étayer cette construction marchande hic et nunc en
étudiant, dans une partie 3, le rôle des acteurs libéraux dans la réforme. Médecins et assureurs privés,
en disposant d’un pouvoir de co-régulation, jouent un rôle majeur dans la forme de marché qui
s’installe. La dernière partie redescend au niveau des logiques microéconomiques des acteurs pour
s’intéresser à la construction, par la politique publique, d’un nouveau comportement pour l’assuré
social. Il n’y a pas de marché sans consommateur souverain. Or, les réformes de la santé vont dans ce
sens, développant une logique de bien privé et de libre prévoyance. Elles ont besoin de s’appuyer sur
un consommateur responsable et souverain, librement informé, notamment des différentes options
assurantielles et capable de faire des choix éclairés. Cette évolution prend le risque d’une inégalité
accrue pour une efficacité douteuse sur la réduction de la dépense de santé.
2. QUAND L’ÉTAT FAIT SON MARCHÉ
La « réforme » française de la santé est caractérisée par un paradoxe qui n’est qu’apparent : elle
conjugue plus d’État et plus de marché en conciliant activisme public et inclinaison marchande. Si la

3
réforme consacre la désocialisation d’une partie de la couverture santé en accentuant les mécanismes
de co-assurance et en important des concepts venus du secteur privé (notamment la comptabilité
analytique en matière de gestion hospitalière), elle s’appuie sur un Etat interventionniste qui « prend le
pouvoir » sur la régulation du système de santé. Ce dernier constitue dés lors l’une des formes les plus
expressives de l’avancée beveridgienne de la protection sociale française. Cette évolution s’apprécie
aussi bien au niveau des objectifs (création de la CMU notamment) que des moyens mis en œuvre,
qu’il s’agisse du financement de la santé (par la CSG) ou des nouveaux outils de gouvernance installés
par l’État, comme la Haute Autorité de Santé ou encore le vote par le parlement du projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui fixe l’objectif national d’évolution des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM).
Cette première partie soutient que l’intervention publique accrue et la construction d’un marché
font système. Elle instruit la façon dont les ressources cognitives marchandes imprègnent la politique
publique pour devenir des critères locaux de « bonne gouvernance » de l’assurance maladie On
s’intéresse à la production d’un modèle d’État social en santé développant un « sens commun
réformateur » (2.1) puis, dans un second temps à la diffusion de ce modèle quand il rencontre les
logiques nationales de protection sociale (2.2).
2.1. L’émergence d’un référentiel marchand pour la gouvernance de l’assurance maladie
Avec la crise des années 1970, les gouvernements occidentaux ont commencé par employer les
instruments alors traditionnels contre le chômage. Ces outils keynésiens, qui avaient fait leur preuve
pendant les trente glorieuses, n’ont pas enrayé l’aggravation de la crise économique et les
gouvernements ont progressivement manifesté un changement d’opinion envers le keynésianisme.
L’accusation d’inefficacité a laissé place à celle de responsabilité dans la crise et la théorie
keynésienne et son plaidoyer en faveur de l’intervention de l’État ont été accusés d’aggraver la crise
économique au lieu de la réduire. La théorie économique des anticipations rationnelles qui est
considérée comme la critique la plus aboutie de la macroéconomie keynésienne n’est pas étrangère à
cette conception partagée de la politique économique. En soutenant que les remèdes keynésiens sont
non seulement stériles envers le chômage mais aussi nuisibles car générateurs d’inflation, elle a
disqualifié durablement la théorie keynésienne traditionnelle. À partir des années 1970 et surtout dans
les années 1980, le keynésianisme n’est plus un référentiel adéquat de politique publique et un
référentiel « marchand » va animer les politiques publiques.
2.1.1. La construction d’un modèle d’État social en santé
La notion de référentiel, forgée par l’approche cognitive des politiques publiques (P. HALL, 1993,
MULLER, 2000, Y. SUREL, 2000, JOBERT, 2003, etc.) permet, en insistant sur le rôle des idées dans les
politiques publiques, de souligner que celles-ci se nourrissent d’un paradigme dominant qui peut être
remis en cause à la suite d’anomalies persistantes. Quand les faiblesses du paradigme dominant
deviennent des défaillances insurmontables, un nouveau paradigme s’installe, à l’image de la structure
des révolutions scientifiques de T KUHN.
La notion de « référentiel marchand », pour caractériser la nouvelle époque, si elle est intuitive, est
sans doute moins bien identifiée que celle de référentiel keynésien. Elle semble définie par défaut : on
oppose un mécanisme de coordination ; le marché, porté ou travaillé, à des degrés divers par une
multitude d’auteurs1, à une théorie que l’on peut mieux cerner par un seul auteur (KEYNES) et ses
partisans. Le terme marchand renvoie ici à l’efficacité des mécanismes du marché, par opposition à la
nécessaire intervention de l’État chez KEYNES. Si l’économie keynésienne insistait sur les échecs du
marché (« market failure »), le nouveau paradigme va surligner les échecs de l’intervention publique
(« state failure »). Dans ces conditions, pour différencier le nouveau référentiel, on pourrait employer
également les qualificatifs « walrasien » ou « néoclassique » ou renvoyer à « l’économie de l’offre »
ou au « (néo) libéralisme ».
1 Y compris KEYNES.

4
L’important est de souligner le lien intime entre la notion de référentiel et le rôle des
représentations dans la conduite des politiques publiques (THEVENON, 2006). Le référentiel fournit un
« cadre d’interprétation du monde » qui impose une problématique pertinente et définit des modèles
d’action2. Le référentiel permet non seulement de s’accorder sur la façon de résoudre le problème mais
aussi sur la définition du problème. Il diffuse ainsi une vision du monde légitimée, associant un régime
des « bonnes » idées à celui des « bonnes politiques ».
Le nouveau référentiel, s’il affecte les politiques macroéconomiques globales, ne laisse pas
indemne l’État social dont la vision se transforme profondément. Associé au progrès social, améliorant
le bien être des ouvriers, des salariés puis de l’ensemble des individus, l’État social et en particulier
son pilier protection sociale est dorénavant remis en cause et dominé par une autre image. Le poids
financier qu’il fait supporter à ses contributeurs lui vaut d’être sévèrement critiqué. L’existence d’un
déficit public, valorisée comme instrument de relance à l’ère keynésienne est aujourd’hui fortement
condamnée en vertu de « la gestion en bon père de famille ». La limitation des dépenses publiques
devient impérative et fait office d’objectif de toute politique. Le mot d’ordre est la diminution des
prélèvements obligatoires, aussi bien le prélèvement fiscal que le prélèvement social. La protection
sociale est alors intimée de faire une cure d’amaigrissement et les « poids lourds » de la protection
sociale française que sont les retraites et la santé (près de 80% des dépenses du régime général à eux
deux) subissent des réformes structurelles.
L’argument financier va permettre de formater le problème à résoudre. Il va conduire à mettre en
actes, les idées du référentiel marchand dans un secteur comme la santé, sous tutelle publique, qui ne
lui est a priori pas accueillant. La pensée européenne, avec l’institution de l’Union Economique et
Monétaire et les critères de convergence, va beaucoup faire pour fortifier cette trajectoire
intellectuelle. Sans constituer une représentation parfaitement cohérente et totalement balisée, elle va
fournir des répertoires d’action auxquels les gouvernements doivent se conformer. Le pays
contrevenant s’exposerait alors au reproche de « mauvais élève », incapable « d’assainir » son État
social. Un gouvernement est reconnu performant par ses pairs s’il résout certains problèmes jugés
importants comme la baisse des déficits publics. L’influence européenne peut aussi se faire plus
directe quand elle impose une séparation entre l’économique et le social, traçant les frontières de ce
qui doit être donné ou rendu à la concurrence. Cette distinction va permettre d’identifier comme
marchands, car économiques certains domaines de la santé. Ainsi, le plaidoyer de la commission
européenne pour « soumettre aux règles normales de la concurrence », l’ensemble de la protection
sociale complémentaire qui relève d’un « service marchand » car sur la base du volontariat, peut être
interprété dans ce sens3.
Suite aux arbitrages de politique économique générale, le système de santé se met en conformité, à
sa manière, avec la valorisation de la concurrence, de la compétitivité et de la responsabilité
individuelle. L’ordre nouveau qui s’installe en matière de financement de la santé n’est ainsi pas
spontané. Il n’est pas le fruit d’une évolution naturelle de la médecine, de la technologie, de la
démographie et des comportements vis-à-vis de la médecine. Il s’appuie sur des relais efficaces et des
« locuteurs autorisés » (LORDON, 1999) comme la commission européenne4 mais aussi les hauts
fonctionnaires convaincus de l’inefficacité des politiques keynésiennes. La défiance envers la
2 Le modèle du référentiel se décompose en 4 étages : valeurs, normes, algorithmes et images. Les valeurs sont
peu discutées hors crise. Les normes sont des principes d’action qui donnent l’orientation générale de la politique
publique (il faut que…). Les algorithmes développent des instruments sous la forme « si …alors » (si les charges
baissent, alors la compétitivité s’accroît). Enfin l’image est un raccourci cognitif véhiculant les étages supérieurs
mais sans avoir à les déployer (le trou de la Sécu).
3 Dans une lettre adressée au gouvernement français en 2001, la commission recommande de ne pas soumettre à
la taxe de 7% les assurances privées quand les autres organismes complémentaires (mutuelles en particulier) en
sont exonérés.
4 « le fait que les réformes sociales des trente dernières années aient été régies principalement par des
considérations financières peut être associée, plus ou moins directement, à l’institution du marché et de la
monnaie unique dans l’Union européenne, via le jeu de politiques d’inspiration néo-libérale. Ce marché et cette
monnaie unique ne sortent pas du chapeau d’un magicien, ce sont des constructions politiques et sociales qui
renvoient à des choix politiques internes » (BARBIER, THERET, 2004, p. 4).

5
protection sociale et l’aspect trop coûteux du système de santé sont davantage partagés par certains
forums que par les intéressés eux-mêmes : les assurés sociaux.
2.1.2. Les communautés épistémiques et la construction d’un modèle d’État social en santé
Deux types de relais doivent être soulignés dans le cas de la santé : l’économie de la santé,
productrice d’un langage et les organismes internationaux producteurs de chiffres.
· L’économie de la santé, caution du référentiel marchand
De façon paradoxale, l’économie de la santé est d’un soutien plus efficace pour la politique
publique depuis qu’elle n’est plus reliée à l’administration. En s’affranchissant de la tutelle publique et
en produisant ses propres schèmes5, elle fournit une caution scientifique plus crédible pour le
développement du référentiel marchand. L’inscription de l’expertise médicale dans une économie de
la santé, s’affichant en tant que science (économique), illustre un processus de « force des liens
faibles ». La distance prise avec l’administration et les études uniquement empiriques est allée de pair
avec l’insertion de l’économie de la santé dans un corpus théorique d’obédience néoclassique.
L’apport de l’économie de la santé a été d’adapter de façon convaincante le métalangage de
l’économie aux spécificités de la santé. Le secteur de la santé n’échappe ainsi pas à une conception
essentiellement marchande des interactions sociales qui se veut naturelle. Elle se base sur une
anthropologie mettant en avant les comportements stratégiques qui sont étalonnés en dividendes
informationnels6. L’économie de la santé adopte cette posture, valorisant la figure de l’homo
economicus, tardivement par rapport à d’autres disciplines comme l’économie publique ou l’économie
du travail (ROCHAIX, 1997). Si l’on dit souvent que l’économie de la santé est une discipline récente,
en fait, elle serait surtout une discipline lente.
Cette représentation savante du système de santé ne s’est pas seulement imposée comme un cadre
théorique de référence. Elle a aussi une grande influence sur la politique économique et les « fictions
théoriques » ont la capacité de s’incarner dans les pratiques dans le cadre d’un processus analysé par
CALLON (1998) où l’économie comme discipline (economics) modèle l’économie comme réalité
(economy). La façon de concevoir les individus a en effet une grande influence sur l’élaboration des
politiques publiques. La définition univoque et réductrice de l’individu, cantonné à un statut de
calculateur opportuniste n’est pas neutre car elle oriente la façon de résoudre les problèmes
économiques en s’adressant prioritairement aux intérêts égoïstes des individus. C’est pourquoi, le
formatage des esprits se traduit dans les faits. Les représentations théoriques influencent donc
fortement le réel. Elles ont la capacité à produire des comportements, et des réactions à ces
comportements, qui valident ex post cette façon de juger. Les prophéties deviennent alors auto-
réalisatrices (VENTELOU, 2001, 2002). Les notions phares de la microéconomie de la santé servent de
points d’appui aux politiques publiques (SERRE, 1999): l’effet d’induction (où les producteurs ont la
capacité de créer une demande artificielle) sert (ou servait) de justification scientifique aux politiques
de rationnement de l’offre (numerus clausus par exemple). Le concept d’aléa moral, établissant un
pont entre socialisation des dépenses et comportement de surconsommation, est la caution théorique
aux politiques de déremboursement. La nouvelle tarification hospitalière se nourrit de la notion de
concurrence fictive, développée notamment dans un rapport du CAE (MOUGEOT, 1999) et venant de la
théorie de l’agence. Ces conceptions théoriques, élaborant un modèle d’acteur en santé en phase avec
5 Qui peuvent d’ailleurs dorénavant aller à l’encontre de ceux de l’administration. L’autonomisation de
l’économie de la santé, sa « lente sortie de l’expertise des espaces bureaucratiques », sa professionnalisation en
phase avec l’évolution de l’ensemble de la science économique n’empêchent pas l’existence d’une cohabitation
avec un contexte social (BENAMOUZIG, 2005).
6 L’économie de la santé est, pour une très large part, une économie de l’information. Dans le champ de la santé,
si le marché fonctionne mal c’est parce qu’il existe un différentiel d’information à l’avantage d’un acteur (le
médecin, l’assuré) dans le cadre d’une relation bilatérale (respectivement médecin patient ou médecin tutelle et
assureur (tutelle) – assuré (patient)) Les problèmes posés à la microéconomie de la santé sont convertis en une
grandeur uniforme : l’information. Or, une telle analyse ne pointe pas uniquement une différence d’information
entre un acteur, elle insiste sur son caractère indu. L’asymétrie d’information est alors le moteur de
l’opportunisme, ce qui permet de dérouler les principes du calcul économique et de trouver dans les logiques
incitatives les moyens de remédier à cet avantage abusif (BATIFOULIER, GADREAU, 2006b).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%