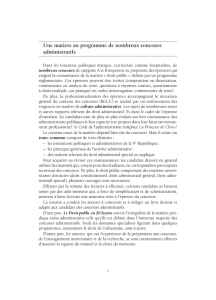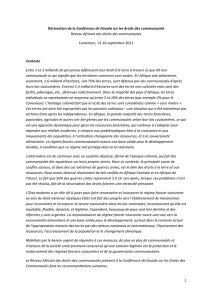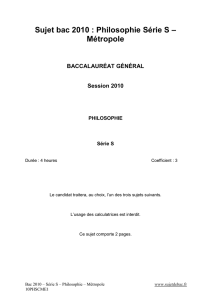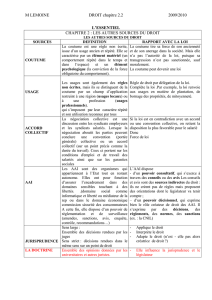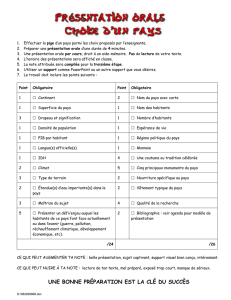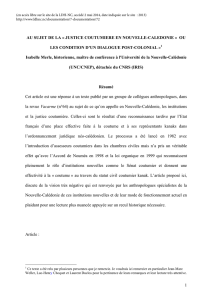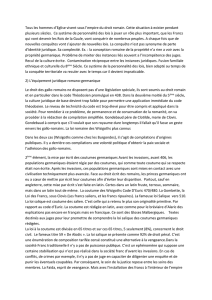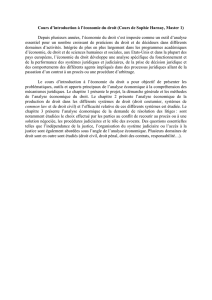coutumes sociétés

1
LA JUSTICE COUTUMIERE DANS LES PAYS
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Shura en Afghanistan – District de Rustaq ©Yann Colliou
Yann Colliou
+41 78 611 23 30

2
Table des matières
Introduction ................................................................................................................................. 3
Partie 1 – La coutume ................................................................................................................... 5
1.1 Définition et caractères généraux de la coutume ......................................................................... 5
1.2 La coutume en tant que source du droit ....................................................................................... 6
1.3 La rédaction des coutumes ........................................................................................................... 6
1.4 Les Constitutions coutumières et la coutume constitutionnelle .................................................. 7
1.4.1 Les Constitutions coutumières ............................................................................................... 7
1.4.2 La coutume constitutionnelle ................................................................................................. 8
1.5 Le droit coutumier et la colonisation ............................................................................................ 8
1.6 Le droit coutumier en tant que système juridique ..................................................................... 10
Partie 2 : Les limites de la justice d’état ....................................................................................... 12
2.1 Perception de la justice d’état par les populations locales ......................................................... 12
2.2 Le développement de modes de justice parallèle ....................................................................... 13
2.3.1 La justice parallèle au Cameroun ......................................................................................... 13
2.3.2 La justice expéditive ou « mob justice » .............................................................................. 14
Partie 3 : Le recours à la justice coutumière................................................................................. 16
3.1 L’objet de la justice coutumière - L’importance du lien social .................................................... 16
3.2 L’évolution et l’organisation de la justice coutumière ................................................................ 17
3.2.1 Les Territoires palestiniens ................................................................................................... 17
3.2.2 L’Egypte ................................................................................................................................ 24
3.2.3 L’Afghanistan ........................................................................................................................ 28
3.3 Les avantages de la justice coutumière ....................................................................................... 31
3.4 Les limites de la justice coutumière et les résistances ................................................................ 32
Partie 4 : Intégrer la justice coutumière dans les programmes de développement ........................ 34
4.1 Préalables / Constitutions ........................................................................................................... 35
4.2 La recherche ................................................................................................................................ 38
4.3 L’enregistrement de l’activité coutumière .................................................................................. 39
4.4 Codifications de la loi coutumière et l’introduction de garanties procédurales ......................... 41
4.5 Rapprochement avec la justice d’état ......................................................................................... 42
4.6 Formation et la sensibilisation des acteurs de la justice coutumière ......................................... 43
4.7 L’élaboration de principes d’action ............................................................................................. 44
Conclusion ................................................................................................................................. 46
Bibliographie .............................................................................................................................. 47

3
Introduction
La justice coutumière doit-elle être intégrée dans les programmes de développement visant à
garantir les droits de l’homme et l’accès à la justice ? cette question est devenue cruciale si l’on
considère qu’aujourd’hui, dans les pays en développement, plus de quatre-vingt pour cent des litiges
sont résolus hors du cadre de la justice formelle.
Dans beaucoup de pays l’accès à la justice est une question de vie ou de mort, l’expropriation illégale
de terres retire à des dizaines de milliers de paysans leur outils de travail, les forçant à l’exode.
Beaucoup de femmes se retrouvent privées de leurs biens par leurs belles familles à la mort de leur
mari, les laissant dans le dénuement le plus total. Des groupes extrémistes prospèrent dans certaines
régions car ils proposent des formes de règlement de conflit là ou l’état est l’absent, laissant une
large place à l’arbitraire. Ces quelques exemples, et bien d’autres, démontrent la nécessité d’outils
de gouvernance, de systèmes de justice efficaces. Malheureusement, ces besoins restent insatisfaits.
La communauté internationale et les pouvoirs locaux se sont concentrés sur des programmes d’aide
visant à soutenir les institutions officielles, telles que la magistrature, la police, l’administration
pénitencière. La justice coutumière est souvent considérée comme incompatible avec les « valeurs »
de l’état nation moderne. Mais malgré ces aides massives et cette focalisation sur le système
étatique, ils n’a pas été possible de mettre en place des systèmes de justice accessibles à tous, ils
sont souvent géographiquement inaccessibles, ils sont considérés comme étant corrompus, les
décisions de justice mettent beaucoup de temps à être rendues, ils n’ont pas toujours la validation
des autorités religieuses locales, ils ne sont pas culturellement adaptés.
Par conséquent, les mécanismes locaux ou communautaires de gestion de conflit restent
globalement, par défaut, très largement utilisés. Les institutions coutumières régissent la vie d’une
grande partie de la population des pays en voie de développement. Mais nous constatons que la
place faite à l’individu au sein de la justice coutumière n’est pas la priorité, le but étant la paix sociale
au sein de la communauté. Cela pose donc des questions en termes de respect des droits
fondamentaux de la personne. Dans ces systèmes opérant en marge du système étatique, quelles
sont les garanties du respect des normes internationales en matière de droits de l’homme et de
justice pénale ?
Il y a depuis quelques années, dans le domaine du développement, un regain d’attention pour la
justice coutumière, qui commence à être considérée comme étant le moyen permettant aux
populations marginalisées et défavorisées comme les femmes et les enfants d’avoir accès à la justice
ou du moins à des formes de règlement de conflit. Mais ce domaine reste encore peu et mal étudié,
et bien que la justice informelle soit exclusive dans certaines régions, il n’existe pas à notre
connaissance d’initiatives visant à quantifier ou à enregistrer l’activité de la justice coutumière,
excepté une initiative pilote que nous allons présenter dans ce travail. A quelques exceptions, les
études menées abordent le sujet de manière assez générale et présentent peu d’études de cas.
Dans une première partie, nous tenterons de définir les caractères généraux de la coutume, nous
nous intéresserons à la coutume en tant que source matérielle du droit, au droit coutumier en tant
que système juridique et à sa cohabitation avec les autres systèmes. Nous mesurerons l’impact de la
colonisation sur l’ordre juridique en place.

4
Nous nous concentrerons dans une deuxième partie sur les limites de la justice d’état, sur la
perception qu’en ont les populations locales ainsi que sur les conséquences de l’évitement de ses
institutions par les population et par conséquent sur le développement de modes de justice
parallèles et de pratiques d’un autre temps.
Dans ce contexte de rejet ou d’évitement de la justice d’état le recours croissant à la justice
coutumière sous différentes formes reste l’alternative qui semble proposer le plus de garanties. Nous
détaillerons dans une troisième partie les modes de fonctionnement de la justice coutumière dans
trois contextes spécifiques, à savoir les Territoires Palestiniens, l’Egypte et l’Afghanistan. Ce travail
nous permettra de mieux appréhender les avantages et les limites de ces systèmes de justice.
Les constats que nous aurons fait nous permettront de suggérer des modes d’action à l’attention des
organisations de développement souhaitant intégrer la justice coutumière dans les programmes
d’accès à la justice et de présenter les préalables à respecter avant d’intervenir dans ce domaine.
Nous détaillerons les activités liées à la recherche dans le domaine, à l’enregistrement et à la
codification des décisions, au rapprochement entre les deux ordres juridictionnels, à la formation des
acteurs et enfin à l’élaboration de principes d’action.
Il y a un champ de tension évident entre ce que certains qualifient de volonté hégémonique et
centralisatrice du droit et la justice coutumière. Dans ce contexte, nous tenterons d’évaluer les
possibilité de rapprochement et de collaboration entre les institutions judiciaires de l’état et les
instances coutumières de justice. Nous proposerons des activités visant à « décloisonner » la justice
coutumière et à faciliter le travail des acteurs du développement, dans un objectif d’un meilleur
accès à la justice pour les populations défavorisées. Tout ceci en évitant de minimiser le rôle de la
justice étatique et en proposant des principes d’action et un guide de bonnes pratiques à l’attention
des organisations de développement souhaitant mettre en œuvre des programmes dans ce domaine.

5
Partie 1 – La coutume
1.1 Définition et caractères généraux de la coutume
La coutume est un « usage juridique oral, consacré par le temps et accepté par la population d'un
territoire déterminé »
1
. La coutume est une règle de droit née d’un usage prolongé et peu à peu
considéré comme obligatoire.
2
Ces deux définitions nous semble particulièrement pertinentes car
elle démontrent les principaux éléments qui définissent l’existence d’une coutume à savoir son
acceptation par une majorité d’une population donnée, un usage prolongé et son caractère
obligatoire. A cela il faudrait rajouter que pour devenir coutume, un usage doit être général, c’est-à-
dire largement répandu, il doit être constant, c’est à dire régulièrement suivi.
La notion de coutume est ancienne, elle précède certainement celle de la loi dans l’histoire du droit,
mais contrairement à la loi, elle est plus délicate à caractériser, elle est considérée comme
« fuyante »
3
. La coutume se définit en premier lieu par son caractère répétitif. Selon Virginie Saint
James
4
, il est très difficile d’étudier le processus coutumier, classiquement il est admis qu’il faut une
longue période de temps pour former la coutume, cependant il est difficile, voire impossible de
définir l’origine temporelle de la plupart de nos coutumes. L’ancien droit français avait parfois, pour
sa part, fourni un repère dans la durée avec l’exigence d’une pratique répétée pendant un minimum
de quarante années.
Dans son rapport introductif sur la place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien, Gilles Paisant
présente deux éléments constitutifs de la coutume, l’un matériel, l’autre psychologique.
D’un point de vue matériel, pour devenir coutume, la pratique considérée doit bénéficier d’une
certaine étendue dans l’espace. A cet égard, la portée des coutumes est très variable. Alors que
certaines présentent un caractère général comme par exemple la faculté reconnue aux mineurs
d’effectuer de menus achats courants malgré leur incapacité juridique, d’autres ne se constatent que
dans des zones géographiques restreintes, spécialement en matière rurale. Il est évidemment
impossible de préciser la portée géographique minima en deçà de laquelle une pratique ne pourra
plus être reconnue en tant que coutume. Paisant précise que si les coutumes n’étaient appréciées
qu’à l’aune de leurs éléments matériels, elles ne resteraient que des pratiques en principe
impuissantes à constituer de véritables règles de droit.
La différence entre une pratique et une coutume tient à l’existence pour cette dernière d’un élément
psychologique complémentaire, qui est la conviction bien établie, parmi les membres d’un groupe
social, que telle ou telle pratique ou tel ou tel comportement sont obligatoires et doivent être
respectés.
La coutume est d’acceptation variable selon les continents et les systèmes juridiques considérés
5
.
Dans les pays de droit romano-germanique, la coutume ne peut théoriquement jouer un rôle que si
la loi y fait référence, les arguments fondés uniquement sur la coutume sont irrecevables devant les
tribunaux, ce qui est a contrario possible dans les système juridiques de common law.
1
Le Grand Robert, Dictionnaires le Robert, 1994. Coutume, p.5201.
2
Patrick Courbe - Jean-Sylvestre Bergé, Introduction générale au droit, Dalloz, 2013, p66.
3
Gilles Paisant « B. Oppetit, Sur la coutume en droit privé, Droits, n°3, 1986, p.46.
4
Maître de conférences de droit public à l'Université de Limoges.
5
Gilles Paisant « F. Terré, Introduction générale au droit, 5è éd. Dalloz, 2000, n°202 ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
1
/
49
100%