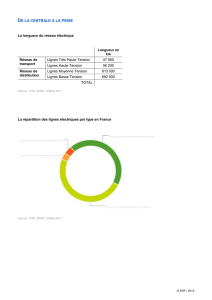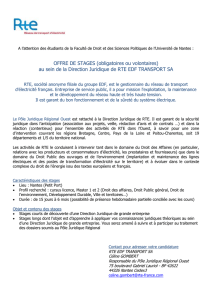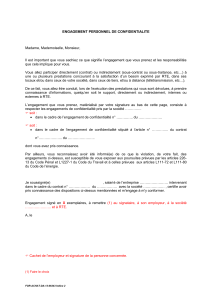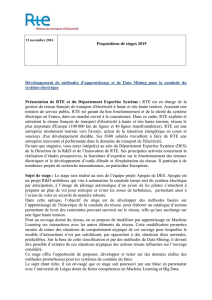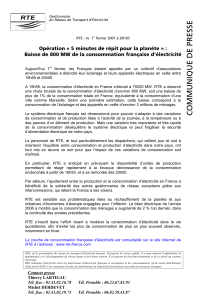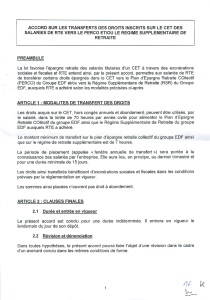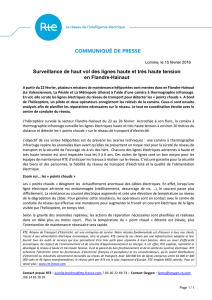Consulter le rapport de concertation du GT SSY Tension de

1
Evolutions des Règles Services Système sur
le réglage de la tension
Rapport de concertation du GT SSY Tension
4 mai 2016

2
Sommaire
SYNTHESE ............................................................................................................................................ 4
1 CONTEXTE ET OBJET ............................................................................................................... 7
2 TRAVAUX DU GT SSY TENSION ............................................................................................. 8
3 ENVELOPPE DE REMUNERATION ........................................................................................ 9
3.1 Enveloppe initiale ................................................................................................................................ 9
3.2 Enveloppe actuelle .............................................................................................................................. 9
3.3 Estimation Producteurs ....................................................................................................................... 9
3.4 Estimation RTE ................................................................................................................................... 10
3.5 Analyse des écarts ............................................................................................................................. 12
3.5.1 Volet 1 : Impact de la clé de répartition .............................................................................................. 13
3.5.2 Volet 1 bis : gains sur les pertes liés au surdimensionnement ............................................................ 16
3.5.3 Volet 2 : Coûts de maintenance .......................................................................................................... 24
3.6 Proposition RTE pour l’enveloppe de rémunération .......................................................................... 25
4 MODELE DE REMUNERATION ............................................................................................ 27
4.1 Modèle actuel.................................................................................................................................... 27
4.2 Nouveau modèle de rémunération .................................................................................................... 28
4.2.1 Part fixe................................................................................................................................................ 28
4.2.2 Part variable ........................................................................................................................................ 30
5 SYSTEME D’ABATTEMENT ET DE PENALITES .............................................................. 33
5.1 Gestion des indisponibilités ............................................................................................................... 33
5.1.1 Système actuel..................................................................................................................................... 33
5.1.2 Evolutions envisagées .......................................................................................................................... 35
5.1.3 Position de RTE et des acteurs ............................................................................................................ 35
5.2 Gestion des défaillances de réglage ................................................................................................... 35
5.2.1 Système actuel..................................................................................................................................... 35
5.2.2 Evolutions envisagées .......................................................................................................................... 36
5.2.3 Position de RTE et des acteurs ............................................................................................................ 37

3
6 COMPENSATION SYNCHRONE ........................................................................................... 38
7 REFERENCES ............................................................................................................................ 38
8 ANNEXE : ANALYSE DE LA CLE DE REPARTITION ....................................................... 39

4
Synthèse
Ce rapport constitue la synthèse de la concertation du groupe de travail « Services Système Tension »
qui s’est déroulée entre octobre 2015 et avril 2016. Le document présente les travaux de RTE et des
Producteurs qui ont porté sur l’enveloppe de rémunération, les principes d’évolutions du modèle de
rémunération et du système d’abattements et de pénalités. La note précise pour chacun de ces trois
points la position de RTE et celle des acteurs.
Enveloppe de rémunération
Le coût global du réglage de la tension est estimé par les Producteurs à 189 M€/an et à 89 M€/an par
RTE (hors compensation synchrone), sachant que l’enveloppe actuelle est de 110 M€/an (hors
compensation synchrone).
Les principaux écarts entre les estimations finales de RTE et des Producteurs sont représentés dans le
graphique ci-dessous :
Ces écarts se répartissent en trois grandes catégories :
1. Les gains sur les pertes liés au surdimensionnement chiffrés à 21 M€.
Le volet 1 bis lié aux gains sur les pertes avec le surdimensionnement a fait l’objet de nombreux
échanges détaillés en 3.5.2. RTE et les Producteurs sont en désaccord sur 3 points pour la prise en
compte de ces gains dans l’enveloppe de rémunération :
89
21
55
24
0
189
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ESTIMATION RTE (Y
COMPRIS GAINS SUR LES
PERTES)
GAINS SUR LES PERTES ECART VOLET 1 :
SURDIMENSIONNEMENT
ECART VOLET 2 :
MAINTENANCE
ECART VOLET 3 : PERTES
LIÉES AU RÉGLAGE
ESTIMATION
PRODUCTEURS
Ecart final estimation haute RTE / Producteurs (M€)

5
D’un point de vue économique, certains Producteurs (ENGIE et Direct Energie) considèrent
que ces gains ne leur profitent pas directement, mais RTE conteste ce point car les producteurs
bénéficient systématiquement d’un effet volume (cf § 3.5.2.2.1) ;
Les Producteurs s’opposent à la prise en compte de ces gains qui conduit à la baisse de
l’enveloppe de rémunération et qui sont liés aux modalités de refroidissement d’un type
d’alternateurs, mais RTE considère que l’approche d’estimation des coûts et des gains qui a
prévalu et fait consensus jusqu’à présent est une approche globale et non une approche filière
par filière visant à rémunérer ces dernières de façon différenciée ;
Les Producteurs (principalement ALPIQ, CNR et EDF) contestent techniquement les résultats
de l’étude SUPELEC sur ce volet mais RTE considère avoir pris en compte à la fois leurs
remarques, pour affiner l’étude SUPELEC, et l’analyse d’un fabriquant d’alternateurs (General
Electric).
En effet, en intégrant les retours de General Electric (cf § 3.5.2.2.3) sur les calculs de pertes dans les
alternateurs, RTE valorise les gains sur les pertes liés au surdimensionnement à 21 M€.
2. Les coûts de surdimensionnement liés au réglage de la tension (volet 1) de 55 M€ dont 48 M€
principalement dus au choix de la « clé de répartition ».
Cette clé détermine la part du dimensionnement nécessaire pour avoir la capacité à régler la tension
(cf. § 3.5.1). A l’issue de la concertation, RTE et les Producteurs sont en désaccord sur cette clé. Les
Producteurs souhaitent utiliser la « clé FERC ». La position de RTE consiste à raisonner en marginal
pour estimer le surdimensionnement en utilisant les résultats de l’étude SUPELEC. L’impact de cette
divergence de position est de 48 M€.
3. Les coûts de maintenance (volet 2) conduisant à un écart de 24 M€.
Sur ce volet, RTE a révisé son chiffrage pour intégrer les montants de maintenance préventive et de
maintenance fortuite fournis par certains Producteurs mais en appliquant la clé de répartition retenue
par RTE (cf écart n°1). A l’inverse, RTE n’a jamais été favorable à l’intégration des pertes d’opportunité
(non valorisation d’actifs suite à fortuits) mis en avant par certains producteurs pour les raisons
explicitées dans le rapport remis à la CRE le 1er octobre 2015 [1]. L’écart résultant est de 24 M€, dont
9 M€ dus à la clé de répartition et 15 M€ liés aux pertes d’opportunité.
Modèle de rémunération
Pour les évolutions du modèle de rémunération, RTE retient une approche de couverture des coûts et
considère qu’il doit y avoir égalité entre l’enveloppe de rémunération et l’estimation des coûts du
réglage de la tension. Il est proposé de conserver le découpage actuel avec une part fixe pour couvrir
les coûts d’investissement (volets 1 et 1bis pour le surdimensionnement) et une part variable pour les
coûts d’exploitation (volets 2 et 3 pour les surcoûts de maintenance et pertes).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%