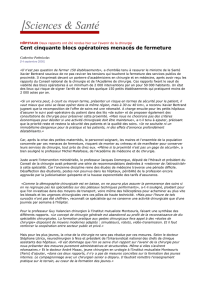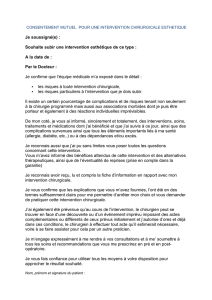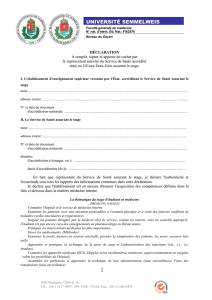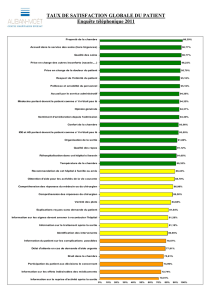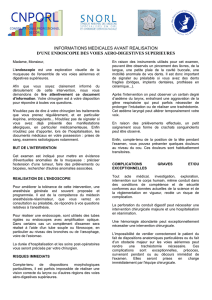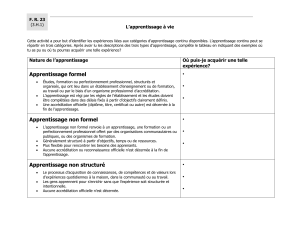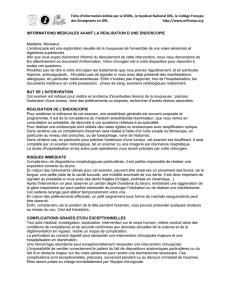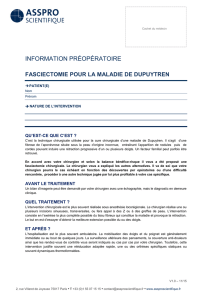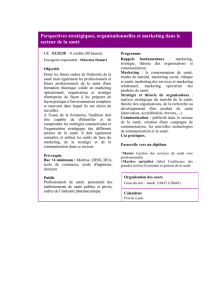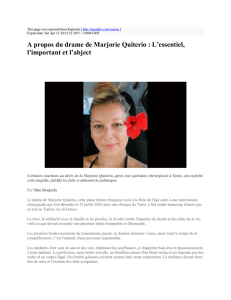Plaidoyer pour une amélioration de l`accréditation des

Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(3) : 133-134 133
tribune libre
nos pratiques professionnelles doivent être évaluées en continu.
L’accréditation repose sur la déclaration d’événements porteurs
de risques (EPR), la mise en œuvre de recommandations par
les sociétés savantes, l’évaluation des pratiques (Epithor®, RMM,
EPP…), la participation aux congrès, aux Collèges d’enseigne-
ment, e-learning… Mais cette accréditation a des limites rapide-
ment atteintes, comme le prouve l’exemple rapporté de la mise
à pied de ce chirurgien dûment accrédité par sa société savante.
L’accréditation actuelle est essentiellement une «e-évaluation»
par écran interposé. Elle n’intégre pas la pratique chirurgicale.
Elle n’évalue pas les organisations chirurgicales. Elle ne suit pas
l’évolution de la chirurgie. Au total, son contenu ne permet pas
de prévenir, de dépister, de résoudre la dégradation de la pra-
tique chirurgicale.
Depuis les années 2000, la chirurgie s’est profondément modi-
fiée : elle est devenue mini-invasive, hypertechnologique, hy-
perspécialisée. Les équipes chirurgicales ont dû s’agrandir, les
plateaux techniques ont dû se suréquiper et l’obligation de résul-
tat s’est substituée à l’obligation de moyen.
Ainsi, que ce soit en chirurgie programmée ou d’urgence, le
patient doit être pris en charge dans un établissement, par des
praticiens et par des techniques adaptés à la pathologie à trai-
ter. L’évaluation doit donc intégrer ces nouvelles exigences et
évaluer la pratique chirurgicale, le mode de fonctionnement de
l’équipe chirurgicale, l’organisation de la prise en charge chirur-
gicale des patients.
L’accréditation doit prévenir la dégradation de la pratique
chirurgicale. La formation théorique proposée est très correcte
avec les congrès, les réunions de Collège, la mise en place du
e-learning. La formation pratique peut être entretenue par la
pratique chirurgicale dans un centre, diérent de son propre éta-
blissement, en la reconnaissant comme «formation continue»
et en l’intégrant dans le DPC. Ainsi, on peut se faire aider à opérer
le patient que l’on a confié à la filière de soins ou, si la réalisation
de l’acte est au-delà de ses compétences, aider l’intervention du
patient. Cela favorise les contacts professionnels, les brassages
d’expériences, l’émulation et le décloisonnement des services de
chirurgie.
L’accréditation doit dépister la dégradation de la pratique
chirurgicale. Seule une évaluation sur le terrain peut atteindre cet
objectif. Elle permet une évaluation individuelle et d’équipe de la
pratique chirurgicale. Elle analyse les organisations chirurgicales
locales et territoriales. Elle analyserait les EPP, les comptes ren-
dus de RMM, les stas... Un entretien personnalisé avec chaque
chirurgien sur la perception de son travail clôturerait cette éva-
luation sur site (dépistage des addictions, des sourances pro-
fessionnelles…).
Cette accréditation, ainsi conçue, beaucoup plus pertinente, né-
cessite des moyens adaptés. Des chirurgiens, jeunes retraités ou
en fin de carrière, ayant reçu une formation spécifique, pour-
raient assurer cette tâche. Ces collègues pourraient également
Plaidoyer pour une amélioration
de l’accréditation des chirurgiens
Bernard Lenot*
* Correspondance: [email protected]
1. Les initiales du nom de ce collègue ont été modifiées.
Âgé de 51 ans, chirurgien depuis 16 ans dans un CHG, le Dr B.L.1
est accrédité pour la deuxième fois dans sa spécialité. Il sera
pourtant «mis à pied» par la direction de son établissement pour
insusance professionnelle et anomalies comportementales.
C’est par mon activité syndicale que j’ai eu accès à ce dossier; la
décision de son établissement était justifiée. Cet exemple montre
que l’accréditation actuelle est très partielle et insusante pour
évaluer la pratique chirurgicale. Son seul mérite – et il est im-
mense– est que le principe de l’accréditation pour 4 ans est dé-
sormais accepté par les chirurgiens.
Retournons-nous sur notre expérience professionnelle par un
quizz «tabou». Répondre par oui ou non:
– Avez-vous déjà côtoyé un chirurgien incompétent en activité?
– Avez-vous côtoyé un chirurgien alcoolique en activité?
– Avez-vous côtoyé un chirurgien dépressif en activité?
– Un bon chirurgien peut-il devenir médiocre?
– Avez-vous eu un interne en chirurgie inadapté pour la chirurgie?
Si vous avez répondu « non » à toutes ces questions, vous êtes
démasqué ! vous n’êtes pas chirurgien… mais vous pouvez quand
même continuer à lire ce plaidoyer.
Question subsidiaire: quelles mesures ont été prises? En règle
générale, aucune ! En tout cas, aucune procédure n’existe pour
traiter ces situations.
Atul Gawande est chirurgien endocrinien à Boston, écrivain et
promoteur de la «check-list». Dans son livre, Complications: a
surgeon’ notes on an imperfect science (2002), il consacre un
chapitre au sujet « when good surgeons go bad ». Il rapporte
le cas d’un orthopédiste réputé qui, après une dizaine d’années
d’installation, va opérer de plus en plus vite, et… de plus en plus
mal avec un taux de complication croissant. Pendant 3 ans, les
membres de son équipe tenteront par tous les moyens de lui
faire prendre conscience du problème. Ce praticien s’enferme-
ra dans le déni, s’exclura progressivement de l’équipe. C’est la
direction de l’établissement qui le licenciera brutalement en ré-
ponse aux plaintes croissantes des patients. Divorce, TS, hospita-
lisations émailleront les mois qui suivront avant une reconversion
salvatrice comme médecin d’assurance.
Le problème n’est donc pas que français. Avons-nous une
voie, moins rustique, moins brutale, pour résoudre cette situa-
tion. Avons-nous une procédure qui puisse prévenir, dépister
et résoudre ces situations de dégradation professionnelle d’un
chirurgien? L’accréditation, délivrée pour 4 ans par l’HAS, après
validation par les experts des sociétés savantes, devrait assurer
cette fonction.
L’accréditation, apparue en 2007, considère de façon implicite
que notre formation n’est jamais définitivement acquise et que

134 Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 2015 ; 19(3) : 133-134
B. Lenot | L’accréditation des chirurgiens
assurer la gestion des situations dégradées de pratique chirur-
gicale.
Les outils de l’accréditation doivent permettre de résoudre
les situations de dégradation des pratiques chirurgicales. L’ac-
compagnement des équipes qui dysfonctionnent mais aussi
l’accompagnement individuel avec possibilités de reclassement
professionnel. Devant une situation dégradée, la saisine d’un ex-
pert, mandaté par la société savante du chirurgien, devrait être
possible par la direction ou le président de CME afin de faire un
rapport et des recommandations qui serviront de référence.
En conclusion, l’accréditation dans sa forme actuelle est très
partiellement adaptée à la pratique chirurgicale et à sa mission.
Trop prégnante, sans intérêt pour le chirurgien, elle risque d’être
contournée et d’épuiser les experts. Pour être reconnue et res-
pectée par les chirurgiens, il faut qu’elle évalue la pratique chirur-
gicale, prévienne et dépiste sa dégradation. Les outils qu’elle
utilisera doivent également permettre de résoudre les situations
dégradées. C’est aux sociétés savantes de revendiquer cet en-
richissement du contenu de l’accréditation auprès de l’HAS et
des CNP.
1
/
2
100%