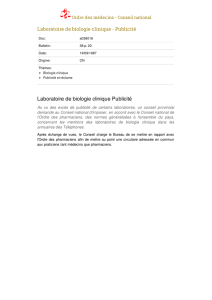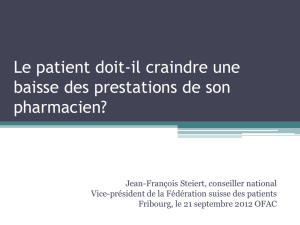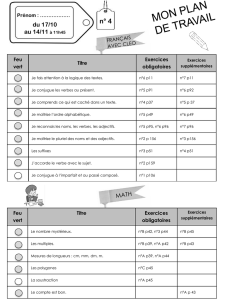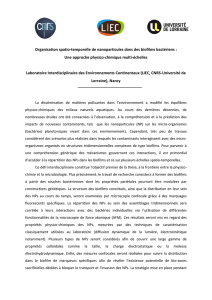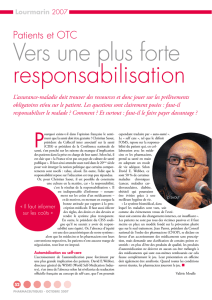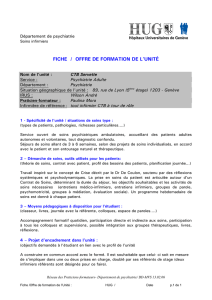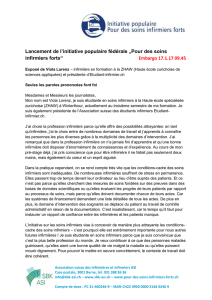Représentations sociales de la maladie

1
Représentations sociales de la maladie :
Comparaison entre savoirs « experts » et savoirs « profanes »
Christine JEOFFRION1
Pauline DUPONT2
Introduction et objectifs
En posant la question : « Qu’est-ce qu’une maladie ? », Cathébras (1997) souhaitait
illustrer deux principes aussi incontestables qu’ils paraissent contradictoires : la maladie est
une catégorie naturelle et une construction sociale. Le terme « maladie » est en effet complexe
et renvoie à de nombreuses situations qui peuvent aller du simple rhume ou état de fatigue à la
maladie chronique, dont la maladie mentale. Par nos expériences personnelles et/ou
professionnelles, mais aussi à travers l’information qui circule dans la société, nos
représentations à propos de la maladie se structurent.
Notre étude a donc pour objectif de mettre à jour les différences pouvant exister entre
les représentations sociales de la maladie chez les Professionnels de la Santé (PS), groupe
composé de médecins, de pharmaciens, et d’infirmiers, et les Non-Professionnels de la Santé
(NPS), composés de personnes « qui suivent un traitement » versus celles qui sont « sans
traitement ». Encore située à un stade exploratoire, elle vise à souligner l’importance de
prendre en compte ces représentations sociales pour favoriser la compréhension et la
confiance entre les PS et les NPS ainsi qu’une prise en charge plus adaptée et une meilleure
acceptation de la maladie chez les NPS.
Ce travail s’inscrit dans la suite d’un programme de recherche que nous avons mené
avec la CNAMTS3 (Jeoffrion, Lafon, Imbert De Balorre, 2004). En souhaitant comparer les
RS des PS et des NPS, il part du présupposé selon lequel les savoirs experts se différencient
des savoirs profanes (Morin, 2004), et que la pratique (Guimelli, 1989) et le statut
professionnel (Piaser, 2000, 2004) influencent les représentations sociales.
1. Contexte théorique
La maladie est à la fois une réalité décrite, expliquée, traitée par la médecine, et une
expérience individuelle comportant des retentissements psychologiques, sociaux, culturels,…
pour ceux qui en sont atteints, d’où les différents termes anglo-saxons pour l’évoquer
(Pedinielli, 1999). L’anthropologie médicale propose de distinguer trois réalités distinctes
sous les différents termes désignant la maladie en anglais : les altérations biologiques
(disease), le vécu subjectif du malade (illness) et le processus de socialisation des épisodes
pathologiques (sickness). Nommer une maladie est donc un acte aux conséquences humaines
et sociales considérables. De plus, les changements sociétaux profonds du dernier siècle ont
tranformé le nouveau « droit à la maladie et au soin » en « devoir de santé » (Pierret, 2008).
Nous assistons par ailleurs aujourd’hui à un double mouvement de désocialisation de la
maladie et de médicalisation de la société (Laplantine, 1986).
Etudier la représentation sociale de la maladie, c’est donc observer comment cet
ensemble de valeurs, de normes sociales et de modèles culturels, est pensé et vécu par des
individus de notre société.
1 Maître de conférences en psychologie sociale, Université de Nantes.
2 Consultante en ressources humaines, Nantes.
3 CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

2
1.1 Les représentations sociales
Le terme de « représentation sociale » a été introduit par Moscovici (1961) qui a ainsi
développé une approche nouvelle dans l’étude de la connaissance humaine. Moscovici s’est
appuyé sur le concept de « représentations collectives » de Durkheim afin de développer une
théorie située à l’interface du psychologique et du social. Elaborée et partagée par les
membres d’un même groupe, une représentation sociale est une « forme de connaissance
courante, dite « de sens commun » qui a comme finalité l’organisation et l’orientation des
communications et des conduites permettant d’acquérir une vision de la réalité commune à
tous les membres d’un ensemble social déterminé (Jodelet, 1989). Certains aspects des
représentations sont explicitement véhiculés dans les discours et d’autres sont enfouis dans les
pratiques. Il serait vain de chercher à savoir si ce sont les pratiques sociales qui produisent la
représentation ou l’inverse, la quasi-totalité des chercheurs s’accordant à dire que les
représentations et les pratiques sociales s’engendrent mutuellement.
Les modes d’approche de ce concept sont variés et complexes. Nous avons donc opté
pour la théorie dite du noyau central élaborée par Abric. Selon cette théorie fondée sur de
nombreux travaux débutés dans les années 1970 et validée expérimentalement par Moliner
(1989), les représentations sociales se forment autour d’un « noyau central » qui détermine la
signification de la représentation ainsi que son organisation. Des éléments périphériques sont
structurés autour du noyau central, et de manière hiérarchisée, constituant la partie la plus
concrète et accessible de la représentation (stéréotypes, croyances, préjugés). Le système
central est essentiellement normatif et le système périphérique est fonctionnel, c'est-à-dire que
c’est grâce à lui que la représentation peut s’ancrer dans la réalité du moment. Les éléments
périphériques exercent alors une véritable fonction de défense de la représentation afin d’en
éviter la transformation. C’est au niveau de ces éléments périphériques que la représentation
sera susceptible de se transformer et que l’individu pourra supporter des contradictions. D’un
point de vue quantitatif, les éléments centraux se distinguent des autres par une plus grande
saillance, dans la mesure où ils entretiennent un lien privilégié avec l’objet de représentation.
Etudier les RS de la maladie via cette théorie du noyau central va nous permettre de
comparer les groupes concernés : les Professionnels de la Santé (PS) d’un côté, qui côtoient
la maladie quotidiennement de par leurs fonctions, et les Non-Professionnels de la Santé
(NPS) qui peuvent être amenés à en vivre une expérience intime.
1.2 Les représentations professionnelles
Piaser (2000) s’est intéressé plus spécifiquement aux représentations professionnelles,
en tant qu’elles sont spécifiques à un groupe professionnel délimité. Elles sont élaborées dans
l’action et l’interaction professionnelles qui les contextualisent, par des acteurs dont elles
fondent les identités professionnelles correspondant à des groupes du champ professionnel
considéré, en rapport avec des objets saillants pour eux dans ce champ (Bataille, Blin,
Jacquet-Mias & Piaser, 1997). Ces représentations, si elles sont confirmées par notre étude,
viendront réaffirmer la distinction entre savoirs profanes et savoirs experts soulignée dans la
littérature.
La différenciation des deux groupes que nous avons investigués présente en effet
l’intérêt d’avoir été affinée par rapport à nos premières études en différenciant, au sein de nos
PS, trois professions médicales, en tant qu’elles risquent d’affecter le lien que les individus
entretiennent avec les objets de représentation et de modifier ce qu’Abric appelle la « distance
à l’objet » (2001). Cette distance permet en effet d’envisager le rapport à l’objet à travers une
élaboration composite qui prend en compte diverses dimensions signifiantes du lien à l’objet :
la connaissance plus ou moins grande de l’objet, l’implication du groupe par rapport à cet
objet et le niveau de pratique de l’objet. Des travaux récents ont formalisé cette notion dans le
champ des RS (Morlot & Sales-Wuillemin, 2008 ; Salesses, 2007 ; Dany & Abric, 2007).

3
2. Problématisation et hypothèses
De nombreux travaux ont montré qu’il existe une pensée « profane » sur la maladie
distincte de ce qu’en disent les « experts » et que ces deux types de pensée peuvent être
appréhendés par l’étude des représentations sociales des PS et des NPS (Jeoffrion, 2009).
L’objectif de cette étude est d’affiner la catégorisation PS-NPS afin de prendre en compte du
côté des PS les représentations professionnelles, et du côté des NPS la « pratique » reliée à
l’expérience ou non de la maladie. Trois métiers ont donc été différenciés du côté des PS : les
médecins, les pharmaciens et les infirmiers, et deux groupes ont été constitués du côté des
NPS : les personnes qui suivent un traitement de celles qui n’en suivent aucun. Cette variable
a été contrôlée du côté des PS en prenant le parti de retirer tous ceux qui suivent un
traitement, de manière à s’assurer que les représentations résultent de leur profession et non
de leur vécu personnel.
2.1. Hypothèses générales concernant l’échantillon global
Les représentations sociales des PS et des NPS, articulée autour d’un noyau central
commun, donneront lieu à des représentations spécifiques liées au statut professionnel propre,
à des connaissances différentes, et à une « pratique » différenciée.
Hypothèse opérationnelle liée aux PS
Les PS devraient se référer davantage à des aspects descriptifs de la maladie et du
suivi des patients.
Hypothèse opérationnelle liée aux NPS
Les NPS devraient se référer davantage au vécu de la maladie et aux aspects
émotionnels.
2.2. Hypothèses concernant les Professionnels de Santé (PS)
Les médecins, les infirmiers et les pharmaciens présenteront, par-delà des RS
partagées, des représentations spécifiques à propos de la maladie : la maladie sera perçue
comme objet de recherche pour les médecins, comme objet de soin pour les infirmiers et
comme objet d’application du diagnostic pour les pharmaciens.
Hypothèse opérationnelle liée aux médecins
Les médecins auront des représentations de la maladie axées plutôt sur des
connaissances scientifiques descriptives et sur la prise de décision ; leurs représentations se
situeront plutôt du côté du diagnostic.
Hypothèse opérationnelle liée aux pharmaciens
Les pharmaciens auront des représentations de la maladie fondées sur l’application du
diagnostic et le suivi du traitement ; leurs représentations se situeront à la fois sur les aspects
médicaux et relationnels.
Hypothèse opérationnelle liée aux infirmiers
Les infirmiers auront des représentations de la maladie basées sur le suivi du patient et
sur la réalité du traitement ; leurs représentations se situeront du côté des effets de la maladie
et de l’accompagnement du patient.
2.3. Hypothèses concernant les Non-Professionnels de Santé (NPS)
Les personnes confrontées régulièrement à la maladie et celles qui ne suivent pas de
traitement, par-delà des RS partagées, des représentations spécifiques à propos de la maladie

4
: la maladie sera plus située du côté du ressenti pour les personnes qui suivent un traitement
médical régulier et sur un plan plus cognitif pour celles qui ne suivent aucun traitement.
Hypothèse opérationnelle liée aux personnes qui suivent un traitement médical
Les personnes qui suivent un traitement médical régulier auront des représentations
sociales de la maladie concrètes, qui seront axées sur leurs expériences personnelles de la
maladie au quotidien. Ils utiliseront un vocabulaire qui se situe sur un plan émotionnel et
affectif.
Hypothèse opérationnelle liée aux personnes qui ne suivent pas de traitement médical
Les personnes qui ne suivent pas de traitement auront des représentations de la
maladie plus « abstraites », basées sur des connaissances générales. Les mots cités
appartiendront davantage aux caractéristiques communes de toute maladie.
3. Méthodologie
Si les concepts de référence paraissent parfaitement adaptés à l’étude des connaissances
groupales, reste la nécessité de recourir à un ensemble de techniques de recueil et d’analyse
des données qui permet d’accéder au contenu et à l’organisation des représentations sociales
et professionnelles de la maladie.
3.1. Le questionnaire
Le travail repose sur un questionnaire d’associations libres constitué par une question
d’évocation (ou associations de mots) : « Lorsque l’on vous dit “MALADIE ”, quels sont les
mots ou expressions qui vous viennent à l’esprit ? ». La question d’évocation est suivie d’un
recueil de diverses variables classiques : âge, sexe, niveau d’études et emploi du sujet
interrogé, reliées à d’autres types de variables pertinentes eu égard à nos hypothèses : secteur
d’exercice de la profession si celle-ci s’inscrit dans le domaine de la santé, lieu d’exercice
(rural ou urbain), et pour tous, une question qui vise à savoir s’ils suivent ou non un
traitement médical, et le cas échéant, si ce traitement est momentané, à long terme ou à vie.
Les données ont été soumises à une analyse prototypique (classement des associations en
fonction de leur fréquence et de leur rang d’apparition) et catégorielle (classement
sémantique) à partir du logiciel « EVOC » créé par Vergès (Scano, Junique et Vergès, 2002).
3.2. L’échantillon
L’échantillon a été constitué à partir de contacts pris au sein de plusieurs structures
hospitalières d’une grande agglomération de l’Ouest de la France, et par la méthode des
« contacts en chaîne ». Les environnements professionnels des PS et des NPS sont de fait
diversifiés, et les NPS qui suivent ou non un traitement sont des « tout-venants » (Cf. Annexe
1). Au final, 270 questionnaires ont pu être exploités, dont 135 PS et 135 NPS, répartis de la
manière suivante :
Tableau 1. Composition de l’échantillon
Professionnels de la Santé
Non-Professionnels de la Santé
Total
135
135
270
Médecins
Infirmiers
Pharmaciens
Traitement
à long terme
Pas de
traitement
45
45
45
67
68

5
3.3. L’analyse des données
3.3.1. Analyse prototypique
Il s'agit d'une analyse quantitative qui met en évidence la structure de la RS. On obtient un
tableau de quatre zones ayant chacune une signification particulière par rapport à la RS. La
case 1 correspond aux éléments faisant partie de la zone centrale. Les mots qu’elle contient
sont cités fréquemment et dans les premiers. Ils donnent une signification, une cohérence à la
RS. Il s’agit des termes les plus saillants et les plus significatifs (Vergès, Op. Cit.). Pourtant
d’après Abric (2003), si le noyau central est bien dans cette case, elle comprend aussi des
éléments qui ne sont pas pour autant centraux. Les cases 2 et 3 sont plus ambiguës. Elles
comprennent des mots fréquents mais moins bien placés, ou bien placés mais peu fréquents.
Ceux-ci font partie de la périphérie, mais peuvent agir sur l’organisation de la représentation.
Il s'agit des "zones potentielles de changement". La case 4 enfin correspond à la zone dite
"périphérique". Les mots sont ici peu cités et en dernières positions.
Tableau 2. Les zones résultant de l’analyse prototypique
Rang moyen
Zone centrale
Fréquence élevée et rang faible
(Case 1)
Zone potentielle de changement
Fréquence élevée et rang élevé
(Case 2)
Fréquence
moyenne
Zone potentielle de changement
Fréquence faible et rang faible
(Case 3)
Périphérie extrême
Fréquence faible et rang élevé
(Case 4)
3.3.2. Analyse catégorielle
L'analyse catégorielle consiste à regrouper dans des catégories ad hoc les mots qui sont
proches d’un point de vue sémantique. On crée autant de catégories que nécessaire pour
classer toutes les évocations des sujets. Cette analyse permet d’approfondir l’analyse
prototypique et de vérifier que les mots repérés par la première analyse relèvent bien des
thèmes les plus récurrents dans les réponses des sujets. En effet, certains thèmes peuvent
contenir une multitude de synonymes qui n’apparaîtront pas forcément dans l’analyse
prototypique.
L’analyse catégorielle a permis de créer 6 catégories, renvoyant au total à quatorze sous-
catégories présentées dans le tableau ci-dessous.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%