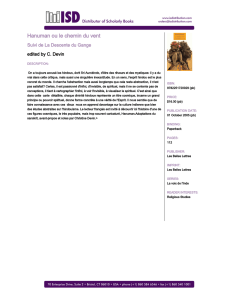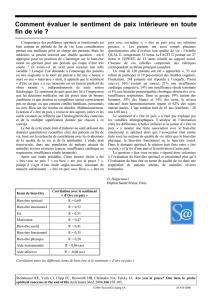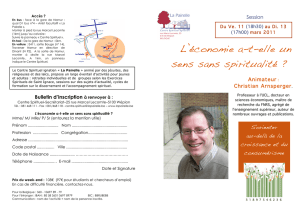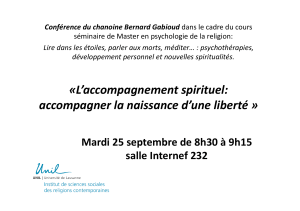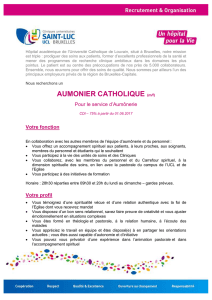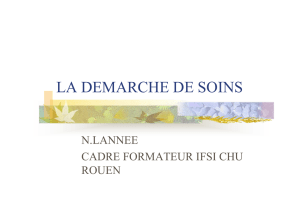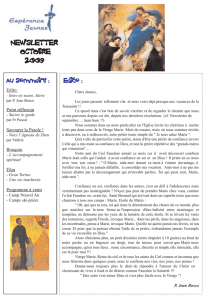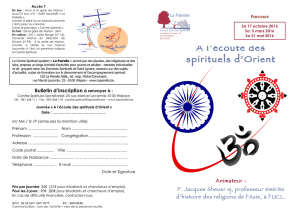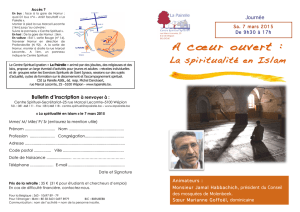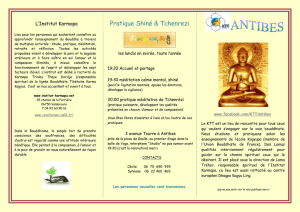Concept de visite pastorale

1
La visite pastorale à l’hôpital
INTRODUCTION
Au-delà des symptômes, de l’anamnèse, du diagnostic et des soins, qu’en est-il de la
personne ? Avec son histoire, les émotions, les blessures et les ressources qui lui
appartiennent.
Dans le cadre de mon engagement professionnel dans le milieu hospitalier, j’ai développé une
conception personnelle et spécifique de l’accompagnement spirituel chrétien auprès des
patients de tous horizons religieux.*
J’exerce mon ministère dans le cadre particulier qu’est le CHUV à Lausanne. Je vis ainsi une
tension permanente entre le monde de l’Eglise, qui m’envoie, et celui de l’hôpital, qui
m’accueille. Je peux très bien être considéré comme un ecclésiastique par le personnel
soignant non averti ou alors être assimilé aux soignants de l’hôpital par les membres de
l’Eglise. Je développe ici une pratique qui favorise le dialogue entre ces deux institutions.
J’ai fait le choix de me présenter comme « accompagnant spirituel » et non comme
« aumônier » pour traduire une ouverture certaine de ma part à la confession et à la religion
des personnes que je rencontre. Je suis également une personne relais quand un patient désire
rencontrer un accompagnant de sa sensibilité religieuse.
Il m’arrive aussi de représenter clairement mon Eglise quand je suis appelé pour un
sacrement.
Ouverture à l’autre et distinction du rôle
Je suis ouvert à l’autre, quelles que soient ses croyances et/ou sa préférence religieuse. Je
n’éprouve pas le besoin d’exprimer immédiatement mon identité de pasteur protestant, mais je
la décline à un moment favorable au cours de l’entretien. Je respecte d’abord le patient dans
sa différence avant de risquer une parole autre, dans un esprit de partage et non de
prosélytisme.
Je tiens à focaliser prioritairement ma visite sur la personne hospitalisée que je rencontre. Je
ne parlerai pas ici de l’accompagnement des proches de patients en fin de vie, ni des soignants
dans ces circonstances.
J’accepte de ne pas avoir de prise sur le spirituel. Je n’ai pas d’obligation de résultat dans la
pratique de mon ministère. J’accompagne l’autre avec l’ouverture au Mystère.
Je désire permettre à l’autre d’entrer dans un processus de développement et de
croissance spirituelle dans la mesure du possible et avec l’accord de la personne.
Je ne vais pas évoquer ici l’importance de la collaboration interdisciplinaire qui s’avère
fondamentale pour définir le champ d’action de chaque intervenant. Même si des similitudes
apparaissent, je reste pastoral dans mon approche, car je ne suis pas psychologue, ni assistant
social, ni infirmier de liaison. Je crois qu’il est important de pouvoir contribuer, dans la
mesure du possible, à une plus grande humanisation des soins, avec le respect du choix de vie
ou de non-vie du patient visité. Chaque professionnel, dans ce sens, peut être porteur d’une
information utile pour un autre collègue. Je n’ai pas le monopole du spirituel.
* Je m’appuie sur des valeurs communes à l’aumônerie œcuménique telles que l’écoute,
l’empathie, la réponse aux besoins spécifiques, les collaborations interdisciplinaires, le non
prosélytisme.

2
Dedans ou dehors du soin ?
J’ai un statut un peu particulier dans le sens où j’appartiens à une équipe de soins comme
personne de référence pour ce qui concerne le domaine spirituel, et en même temps je suis en
marge puisque je suis présent dans plusieurs services. Ma place est en permanence à redéfinir
afin que la confiance subsiste et que les collaborations puissent se vivre avec sérénité. Une
bonne intégration permet de me considérer comme un collaborateur pastoral, accompagnant la
personne, et non comme un ecclésiastique qui intervient quand le médical n’a plus rien à
offrir.
Ce modèle est personnel et non normatif. Chaque accompagnant spirituel est invité à
découvrir son propre concept, en fonction de sa sensibilité et de ses compétences.
J’exprime ici mon enthousiasme et ma passion à exercer ce ministère dans lequel je peux
vivre au quotidien l’amour du prochain.
Point d’ancrage
L’objectif de mon approche et mon intention dans la visite se fondent sur le passage biblique
qui évoque le Christ ressuscité rejoignant ses disciples sur le chemin d’Emmaüs (Luc 24.
15ss), faisant route avec eux et les laissant poursuivre leur chemin. Mon approche consiste à
rejoindre l’autre là où il est et de pouvoir lui donner la possibilité de faire un pas (ou plus)
avec moi. Dans une perspective plus ambitieuse, je désire permettre à l’autre de goûter de
manière implicite ou explicite la présence de Dieu au-delà de la rencontre simplement
humaine, dans sa vie à l’hôpital.
Un des moyens utilisé consiste à permettre l’expression d’une parole qui fait sens en
retraçant des moments importants d’une histoire de vie. Je tente, comme accompagnant
spirituel, d’explorer avec la personne comment la trace du divin a pu se frayer un chemin afin
d’offrir un regard différent sur une vie, avec de la profondeur et de l’épaisseur. Il m’importe
aussi d’accueillir la personne avec le sentiment d’absence du divin dans sa vie, en étant non-
jugeant, et le cas échéant en lui permettant de nommer son sentiment d’abandon ou de rejet.
La personne s’exprime généralement à partir de son vécu, de ses expériences. Dans ce
contexte, nous pouvons dialoguer et cheminer ensemble avec cette présence ou cette absence
nommée.
Je désire également offrir la possibilité d’entrevoir une lueur d’espérance pour aujourd’hui
et/ou pour demain. Etre porteur d’espérance donne sens à mon humanité et à ma vie.
Voici en 5 points le parcours de ma démarche pastorale :
1. Le contrat de présence
2. L’ « ici et maintenant » de la visite
3. Le regard sur le passé
4. La perspective d’avenir
5. L’au revoir
1. Le contrat de présence
La prudence et la discrétion s’imposent dans la mesure où je suis conscient de la
difficulté pour un patient d’oser dire NON à une présence d’un représentant du spirituel
dans un établissement de soins.
Dans un cadre hospitalier, les malades ne peuvent pas refuser la présence des médecins,
autrement ils sont renvoyés à la maison. Ce n’est pas le cas de la nôtre qui nécessite une
approche délicate, respectueuse, avec des compétences spécifiques au niveau relationnel.

3
Comme toute rencontre est plutôt basée sur une relation individuelle, je ressens un facteur
stress à l’approche d’une chambre de deux patients ou plus. J’ai confiance que Dieu
m’accompagne dans mon ministère et dans cette nouvelle aventure relationnelle qui se
prépare.
Je frappe à la porte, entre, et m’approche de la personne que je vais visiter. Je la salue en
disant mon nom et prénom et en précisant que je suis l’accompagnant spirituel du
service.
Je demande ensuite le nom de la personne afin d’établir une relation de sujet à sujet de
type "je-tu ." Ce n’est plus le CA * ou l’AVC* de la 216.
Même si le nom du patient est écrit au pied ou à la tête de son lit, je lui donne la possibilité de
le dire. Se nommer peut être l’occasion de se remettre en contact avec son identité. Suivant
l’origine de la personne, j’entends aussi la manière de prononcer son nom et/ou son prénom,
avec sa musicalité. Le prénom est souvent le premier mot qu’un enfant entend lors de sa
naissance.
J’expose ensuite mon intention de lui rendre visite et lui fais la proposition de rester un
instant auprès d’elle.
Ceci permet à la personne de dire clairement « oui » ou « non », ou encore de proposer un
moment plus favorable pour la rencontre. Je ne veux pas imposer ma présence auprès de
quelqu’un qui ne la désire pas. Je fais confiance à la capacité d’affirmation de la personne qui
peut dire également ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas.
En cas de doute, je vérifie si elle préfère que je me retire.
Au-delà du NON
Lorsqu’une personne ne veut pas ma visite, il m’arrive de lui demander si son refus est lié à
une mauvaise expérience dans ce domaine, ou si elle désire simplement que je passe à un
moment plus favorable. Je me laisse guider par mon intuition pour poser ce genre de question.
Lorsque c’est effectivement le cas, j’ai l’impression parfois que des vannes s’ouvrent et
qu’une colère contenue et tue peut enfin se libérer. La mise en mots de souffrances vécues au
sein d’une communauté religieuse ou ecclésiale peut ouvrir la porte à la restauration d’une
relation entre le patient et son institution religieuse et parfois à la reconstruction d’une
spiritualité blessée. Que ce soient des catholiques ou des protestants qui se sentent victimes.
Il m’arrive également d’informer le patient de mon passage régulier dans le service et de
vérifier avec lui si je peux venir le saluer. Rares sont ceux qui refusent complètement. Je reste
attentif à ce qu’exprime le patient, par des mots, des gestes, une émotion explicite. Pour me
centrer pleinement sur l’autre et ses attentes, je maintiens une certaine ascèse. Je constate que
le respect de la distance voulue par le patient dans un premier temps facilite une approche
voire un accompagnement lors d’une seconde ou troisième visite. La création d’une relation
respectueuse et de confiance permet parfois un contact au-delà de l’impasse apparente.
Il arrive aussi que des personnes refusent de parler après une ou plusieurs rencontres. Je me
résous à l’accepter dans le respect de l’autre. Le non-dit est parfois nécessaire ou protecteur
pour la personne. La parole n’est pas prête à être dite, ni même balbutiée.
*Cancer, Accident vasculaire Cérébral

4
2. L’ « ici et maintenant » de la visite .
Recentrage
Les personnes qui viennent d’arriver à l’hôpital sont souvent orientées vers le passé, avec
regrets, remords, culpabilité :
- « J’aurais dû…, je n’aurais pas dû…, si j’avais su, je ne pouvais pas prévoir
que… »
L’envie est bien réelle de vouloir rembobiner le film de l’histoire avec le secret désir qu’elle
puisse se dérouler selon un autre scénario. Ceci habite particulièrement l’esprit de certains
patients qui portent une part de responsabilité dans ce qui leur arrive, en lien avec le
tabagisme, l’alcoolisme, des comportements à risques, le stress professionnel et personnel.
D’autre part, les personnes qui séjournent à l’hôpital depuis quelques temps se projettent
déjà dans l’étape suivante, celle du retour à domicile, du placement à court ou long terme,
ou encore celle du transfert dans un centre de réadaptation avec des deuils à vivre de mobilité
ou/et d’autonomie, ou de soins palliatifs en attendant la mort.
Ceci met en évidence les difficultés que rencontrent les patients à se centrer sur ce qu’ils
vivent dans l’ici et maintenant de leur hospitalisation.
Sentiments du moment
Après le premier contact contractuel de ma présence, il m’arrive souvent de demander à la
personne comment elle se sent maintenant. Je crois que cela ouvre un espace, une occasion
de rencontre authentique, un moment favorable, le kairos cher à l’apôtre Paul. Le verbe
sentir met l’accent sur les sentiments, le ressenti, et favorise l’expression d’une émotion,
telles la peur, la colère entre autres. Il permet également de parler sur deux niveaux :
- celui qui touche à l’état moral, psychique, émotionnel, spirituel du patient
- celui qui concerne son état physique, pathologique, thérapeutique, algique, médical.
Théologiquement, je donne place à l’expression d’une parole qui peut faire sens ou dire le
non-sens de ce qui est vécu. Au cœur de la parole, c’est la vie qui s’exprime.
La question ouverte laisse l’autre acteur de sa prise de parole et lui permet de s’exprimer dans
le registre qu’il choisit ou qui lui vient spontanément à l’esprit. Je fais confiance a la personne
qui peut communiquer ainsi ce qui la concerne directement et ce qui la touche le plus dans ce
temps de rencontre. Il est fréquent que la première parole qui émerge se concentre sur l’aspect
médical, qui n’est pas mon domaine, mais qui est prioritaire chez la personne. C’est une
manière de poser cette première émotion avant de passer à autre chose.
Il arrive aussi que la personne exprime son inquiétude en attendant un résultat d’examen ou
une opération chirurgicale.
Elle peut dire parfois son soulagement d’avoir reçu une bonne nouvelle ou sa tristesse d’en
avoir appris une redoutable.
Au-delà de tout ce que la personne peut nommer de ce qu’elle vit, je vais me centrer
prioritairement sur la personne, le sujet. Dans le contexte interdisciplinaire qui est le nôtre, je
pourrais le cas échéant transmettre des informations aux soignants, avec l’accord de la
personne, sur ce qu’elle révèle d’important pour la suite de son traitement : Désir de vivre, de
mourir, les ressources essentielles, les attentes, les craintes.
J’ouvre ainsi un espace pour accueillir ce qui est important pour la personne « ici et
maintenant », et donne le temps nécessaire à l’autre de se dire dans sa vérité, quel que
soit son état physique, psychologique ou spirituel.

5
Passé ce temps de recentrage, suivant l’étape que le patient vit dans son temps
d’hospitalisation, j’ouvre un questionnement de type chronologique, qui touche à l’histoire de
vie du patient.
3. Le regard sur le passé
Accueil de l’autre
Une fois que la personne a pu poser ses sentiments du moment, prendre conscience de ce
qu’elle vit dans le présent de la rencontre, je pose une question relative à son histoire,
en lui demandant ce qui s’est passé pour qu’elle se retrouve ici à l’hôpital.
Dans tout ce qui est bouleversé, par la maladie ou l’accident, je lui permets de remettre une
structure dans son parcours de vie.
Dans le récit de la personne, je vais avoir des repères qui vont me permettre de cheminer avec
elle dans une direction adéquate. J’ai plusieurs options et en dialogue nous avançons dans la
rencontre. La personne découvre un espace de liberté pour commencer son histoire là où elle
le désire.
Les réponses sont très variables. Elles vont de la chute incompréhensible dans la cuisine il y a
deux jours, à l’évocation de problèmes qui ont commencé pendant la petite enfance.
Raconter des événements d’une histoire de vie permet parfois de replacer l’épisode de la
maladie ou de l’accident dans un contexte et lui donne ainsi l’occasion de faire sens.
Au-delà d’une souffrance exprimée qui peut s’apparenter à toutes les autres souffrances, celle-
ci soudainement se singularise. Elle prend une autre dimension, elle touche une personne
reconnue dans son unicité.
Une parole dite à haute voix peut avoir un effet thérapeutique et libérateur. D’où l’importance
qu’elle soit entendue si possible par un professionnel de l’écoute, témoin de ce cheminement.
Je veux dire par là quelqu’un capable d’entendre la parole de l’autre quel que soit son
contenu, afin de permettre la rencontre. Et ceci, que le récit exposé s’appuie sur de faits
objectifs ou non. Une personne peut par exemple signaler de très fortes douleurs, alors
qu’objectivement ce n’est pas possible. Nous avons un cas explicite de la part de celle qui se
plaint de son pied amputé qui la fait souffrir terriblement. Les douleurs fantômes peuvent faire
très mal. Il est important pour moi de croire ce que l’autre me dit, sans avoir besoin de vérifier
la véracité de ses propos. Je crois au rapprochement créé par le simple accueil du récit, vécu
comme un moment de partage. Le temps de la confrontation peut parfois se vivre à un
moment plus opportun.
Ressources et Valeurs essentielles
Parcourir ainsi l’identité d’une personne, ou du moins ce qu’elle en révèle, peut conduire à
nommer les valeurs importantes qui ont jalonné cette histoire et comment elles ont pu
contribuer à l’épanouissement de l’être. Il m’arrive de l’inviter à dire ce que la transcendance
représente pour elle et dans quelle mesure elle peut être une valeur ressource. C’est parfois un
chemin à découvrir, à explorer, à tracer.
La spiritualité de la personne dans un sens large, peut constituer un soutien, et il m’importe de
favoriser sa mise en évidence en lui demandant de nommer les ressources sur lesquelles elle
s’est appuyée quand elle a traversé des épreuves ou vécu des coups durs dans sa vie.
C’est l’occasion de voir si elles peuvent être activées pendant l’hospitalisation. Je pense
notamment à celles dont elle a pu bénéficier auparavant afin de pouvoir surmonter les
épreuves, reprendre confiance en la vie, garder ou trouver une espérance. Ces ressources, très
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%