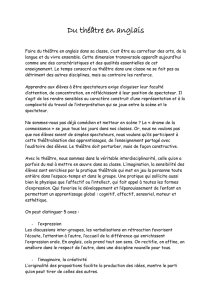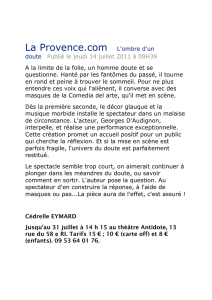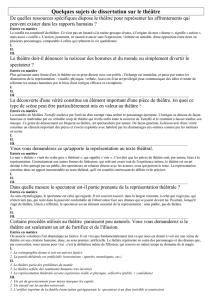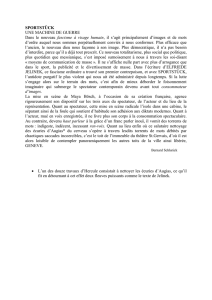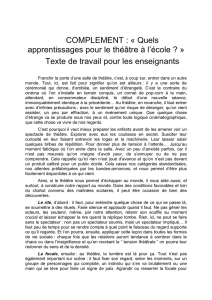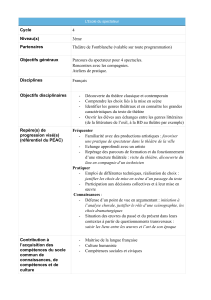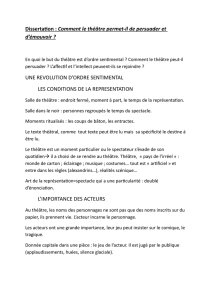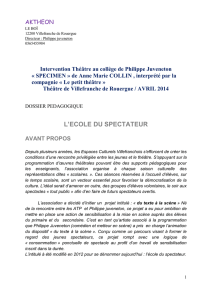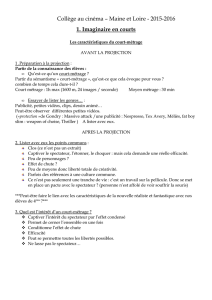La mobilité du spectateur

1
Article paru dans Le théâtre de rue, Un théâtre de l’échange,
sous la direction de Marcel Freydefont et Charlotte Granger (assistés de V. Lemaire et A. Wibo),
Études théâtrales, n° 41-42, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 192-221, et bibliographie, p. 272-274
Emmanuel Wallon
La mobilité du spectateur
Chaque spectacle suscite son propre spectateur. Il sollicite à des degrés divers sa faculté d’émotion
et sa liberté de jugement, selon qu’il procède à la capture des regards ou qu’il favorise la projection
imaginaire, suivant le dispositif scénographique et le mode de jeu dramatique qu’il déploie. Le
spectateur fait aussi sa scène. La régie a beau s’affranchir de la séparation coutumière entre la salle et
le plateau, le récit s’émanciper des distinctions usuelles entre le réel et la fiction, un contrat de
représentation, tacite et informel, ne s’établit pas moins entre le public et les interprètes. Révisable à
tout instant mais reconductible en cas de succès, une pareille convention requiert un effort de
définition, tant elle est chargée de suggestions esthétiques et de significations politiques. L’extrême
variété des genres réunis sous l’expression d’arts de la rue offre une infinité de situations pour exercer
cette réflexion.
Les spectacles urbains convoquent plusieurs espèces de témoins, du badaud sidéré par des
apparitions au partenaire impliqué dans une relation. Simple mateur ou sincère amateur, le client du
théâtre en espace ouvert semble versatile : il s’investit dans l’action ou se retire du jeu sans crier gare.
De même le public des féeries foraines se montre instable : il s’attroupe puis se disperse au gré des
occasions. Et la foule des festivals paraît fluide : elle circule, elle déambule, son libre-arbitre emprunte
petits et grands véhicules. Mais comment savoir si cette motricité physique s’accompagne d’agilité
mentale ? À quel point les pactes de fiction passés dans le mouvement de la ville mobilisent-ils la
pensée ? Une interrogation sur la mobilité du spectateur – tant corporelle qu’intellectuelle – invite à
ressaisir certaines notions empruntées à la sociologie des publics comme à l’esthétique de la réception.
Une telle approche impose au surplus d'examiner la manière spécifique dont chaque proposition
artistique s'inscrit dans un contexte urbain influencé par les circonstances sociales et les contraintes
économiques de la manifestation. L’ensemble de ces données déterminent les clauses implicites du
marché conclu – sous l’enseigne de la gratuité – entre acteurs et spectateurs, que ces derniers se
réservent le droit de récuser dès qu’ils cessent de consentir à l’illusion.
La querelle des assis et des levés
Après trois ans de mobilisation professionnelle et de mesures ministérielles, le « Temps des arts de
la rue » (2005-2007) s’est achevé en France sur le concert d’initiatives de « Rue libre ! », le 27 octobre
2007. Les sirènes et les applaudissements ont ouvert une phase de bilan. Un malentendu persiste
néanmoins concernant la valeur esthétique des œuvres et la portée politique des actes. Tandis que les
artistes de rue vantent l’audace de leurs inventions et l’intensité de leurs échanges avec le public, des
esprits sceptiques considèrent avec commisération les multitudes festivalières comme des masses
manipulées par une politique consensuelle dans une logique occupationnelle. Les deux partis
empruntent des raccourcis presque symétriques.
Chez les adeptes d’une scène sans bord, on oppose les manifestations aux institutions. Celles-ci
sont par essence subordonnées au pouvoir, elles servent à la perpétuation d’un ordre qui les entretient
par de grosses dotations. Celles-là lèvent l’étendard de la liberté, elles heurtent les certitudes et ne
récoltent que de maigres subventions. L’affrontement des événements et des établissements ne serait
pas tant le choc du siècle avec la règle qu’un conflit entre le dehors et le dedans, la lutte des places
ouvertes contre les salles closes. C’est pourquoi le débat glisse assez vite vers l’alternative de
l’élitisme et de l’accessibilité. Les militants de la démocratisation culturelle accusent leurs
contradicteurs de se faire les agents de la distinction sociale. Promoteurs de l’égalité devant l’art, ils
dénoncent les garants de la hiérarchie des genres. Pour ceux qui préfèrent Guy Debord à Régis
Debray, les spectacles en espace public ont le mérite de substituer un régime de participation au règne

2
de la séparation. Bref, c’est « la faute à Rousseau »1 et la fête de Bourdieu.
Parmi les contempteurs des arts mineurs, au contraire, on départage les œuvres et les fêtes, le lent
travail de la critique et les engouements soudains du public, le recueillement nécessaire au jugement et
les étreintes étouffantes de l’opinion, la distance propice à la contemplation et les urgents appétits de la
consommation. Optant pour Paul Valéry plutôt que pour Marcel Duchamp, les gardiens de la
hiérarchie des genres s’élèvent contre la contamination du signe par la chose. En d’autres termes ils
prônent les abstractions de la représentation comme remède aux mirages de la fusion.
Dans une version moins caricaturale, cette « querelle du spectacle », pour reprendre le titre du
premier numéro des Cahiers de médiologie2, pourrait par exemple exposer leur rédacteur Daniel
Bougnoux, professeur émérite, à une tirade de Jean-Georges Tartar(e), auteur-interprète dans le rôle de
composition du « Maire de… » à Aurillac.
« Le couperet du rideau, rouge encore,
a tranché le cou de la représentation.
Voici qu’après le désordre des temps chahutés par les comédies et les drames
voici qu’après le chaos des contes et des mythes,
le temps physique reprend ses droits.
Pourtant, l’espace du spectacle mort accouche
d’une promesse ignorée des prophètes.
Ça bouge encore !
Le silence après la musique, c’est encore de la musique...
Écoutons-la !
Voyons au-delà ! » 3
À cela l’éloquent avocat de la coupure sémiotique rétorquerait sur le champ :
« Réalisme, présence, pertinence sont autant de conquêtes précieuses à défendre, mais elles peuvent
s’inverser en défauts si l’on songe par exemple aux excès du présentisme (au détriment de la
profondeur historique), ou aux victoires de l’ubiquité et d’une communication (« Je suis présent
partout ») qui joue contre la transmission (…). La représentation n’est donc pas l’ennemie de la
présence, mais elle modifie quelque peu celle-ci. Elle la sémiotise, la cadre ou la hiérarchise ; elle
contribue peut-être, du même coup, à desserrer son carcan. »4
Il est à craindre qu’aucune des deux doctrines ne procure à elle seule les armes pour résister aux
assauts d’une industrie de la communication qui menace d’emporter leurs redoutes respectives, tant en
instrumentalisant le récepteur (réduit au statut d’auxiliaire de la programmation) qu’en domestiquant
le destinataire (assigné à résidence ou arrimé par des prothèses). À l’heure de l’interactivité télévisée,
des sondages instantanés, de la politique scénarisée, de la présidence-spectacle et des cyber-
consultations, il serait rusé de savoir pratiquer la « différance », selon le mot de Jacques Derrida qui
allie le différé à la distance, aussi bien que l’« immédiateté », pour citer une expression familière de
Félix Guattari : la première formule promet de s’élever au plan symbolique, la seconde permet
d’évoluer sur les plateaux de l’immanence. Quoi qu’il en soit, avant de rapprocher ces thèses
opposées, il faut les confronter aux expériences. Avant de discerner si le spectateur s’éveille ou
s’endort dans son fauteuil, s’il s’ébroue ou s’abrutit sur le pavé, il s’agit de déterminer ce à quoi il
assiste.
Pour se faire une idée de la diversité des productions prenant la ville pour scène, il convient
d’abord de se reporter à l’index alphabétique des disciplines du Goliath: « arts de prouesse, arts
plastiques urbains, construction monumentale, danse de rue, magie, marionnettes et théâtre d’objets,
musique de rue, parade urbaine, pyrotechnie, théâtre » 5. L’énumération ressemble à une alternance
d’irruptions artistiques et d’éruptions festives, mais la dernière catégorie recouvre le plus grand
nombre de professionnels. Après avoir reconnu la substance théâtrale de la plupart des propositions,
tentons donc un classement plus synthétique, en l’illustrant par des compagnies ou des spectacles

3
emblématiques de ces formes.
- Exhibitions : spectacles fixes, en plein air ou dans une aire non spécialisée (360° par Amoros et
Augustin, Tempête par les Passagers, Le P.U.F. [Produit utile aux festivaliers] par Cirkatomik,
Le Train Phantôme par le Phun …).
- Déambulations : spectacles itinérants, avec ou sans chars et machines (Taxi par Generik
Vapeur - Trafics d’acteurs et d’engins, le cycle des géants [Le Géant tombé du ciel, Retour
d’Afrique, Les Chasseurs de girafes, La Visite du Sultan sur son éléphant à voyager dans le
temps] par le Royal de Luxe, Transhumance, l’heure du troupeau par Oposito…).
- Interventions : intrusions discrètes ou indiscrètes d’acteurs dans l’espace public (le Circuit D
de Délices Dada, la Ballade des Piétons, les « commandos poétiques » des Souffleurs, le Safari
intime d’Opéra Pagaï, État(s) des lieux du Deuxième groupe d’intervention…).
- Installations : inclusion dans l’environnement d’objets ou de dispositifs, animés ou non (les
« univers singuliers » d’Opus, le Musée de la vie quotidienne des Cubiténistes Aha, les féeries
de feu de Carabosse ou du Groupe F, le mobilier urbain revu et corrigé d’Ici Même [Paris], le
Chant des sirènes de Mécanique vivante, Roman Fleuve de KMK…).
En pratique, les troupes les plus en vue alternent ou combinent ces quatre grands modes de
représentation dans leur répertoire. C’est notamment le cas d’Ilotopie, de la Compagnie Off, de Transe
Express, de Kumulus, de Zur et bien d’autres… Solange Oswald, metteuse en scène du Groupe Merci,
conçoit l’espace de jeu et la place du spectateur en intelligence avec le plasticien Joël Fesel, de
manière à « re-conditionner » le travail des comédiens et la réception de la pièce ; dans Colère !, le
spectateur se meut dans une aire délimitée, se hisse sur des échelles, scrute les acteurs enfermés dans
des caissons, puis circule autour des tapis roulants qui les font défiler6. Les réalisations de
KomplexKapharnaüM commencent toujours par des enquêtes, que ce soit auprès des habitants d’un
quartier (SquarE, télévision locale de rue, 2000) ou des retraités des usines Kodak (PlayRec, 2006). La
compagnie dirigée par Pierre Duforeau manie de multiples médias au cours de ses pérégrinations
urbaines. Les matériaux recueillis et recyclés par cette « archéologie du XXIe siècle » sont aussi
nombreux que les rôles impartis à la population visitée, à la fois interprète, intermédiaire et
observatrice7. Il arrive néanmoins que les artistes procèdent par soustraction d’actions au lieu
d’additionner les formes. Depuis 1997, Jean-Daniel Berclaz invite ainsi les habitants d’une région à
inaugurer un panorama de son choix lors des vernissages de son Musée du point de vue, avec le
concours d’organismes locaux. Un kit portatif de vernissage est d’ailleurs fourni sur commande aux
volontaires8.
La séquence du spect’acteur
Pour définir leur audience, les compagnies travaillant en milieu urbain se fient volontiers à la
formule de Michel Crespin, fondateur du Festival d’Aurillac, de Lieux publics (Centre national de
création pour les arts de la rue) et de la Formation avancée itinérante pour les arts de la rue (FAI-AR),
à savoir « le public-population ». Certains artistes aimeraient même substituer cette expression à celle
de « non-public », avancée par Francis Jeanson en 1968 pour souligner les limites de la
démocratisation culturelle dans les institutions subventionnées. De la sorte, le peuple passerait sans
frein ni filtre à l’état d’assistance, un peu comme si le théâtre pénétrait à six heures du soir dans ce
wagon de métro dont Jean Vilar souhaitait accueillir la bigarrure dans sa salle de Chaillot. Il est vrai
qu’Augusto Boal avait déjà inversé la proposition vilarienne en investissant une véritable rame avec
son Théâtre de l’Opprimé9. Dans son manifeste « Rue libre ! » (2007), la Fédération des arts de la rue
proclame en tous cas le désir de toucher l’ensemble des citadins, sans restriction ni distinction : « Les
gens nous rencontrent souvent par hasard, parfois sans le savoir, nous sommes pour tous les yeux et
toutes les oreilles […] »10 . D’après Sylvie Clidière, il existerait tout de même deux catégories de
spectateurs, qu’on pourrait nommer les initiés et les innocents : « Socialement, le spectacle s’adresse
ensemble aux spectateurs prévenus et aux passants de hasard, au public averti et au public
“vierge“. »11
En vérité, loin d’opérer par surprise, l’entrepreneur de spectacles prend très souvent la précaution

4
de prévenir les habitants et de préparer le terrain, qu’il soit directeur de festival, programmateur de
salle, responsable municipal ou administrateur de compagnie. Un ouvrage pratique paru à la faveur du
Temps des arts de la rue lui conseille de prendre en considération les différents corps de la commune,
porteurs d’usages variés de la cité, afin qu’ils s’accommodent d’un possible dérangement. « Avant
l’arrivée des artistes, l’espace public vit déjà de ses occupants, permanents ou éphémères : des
habitants aux commerçants, des usagers aux agents des services publics. » Leur complicité ou tout au
moins leur consentement devient le gage des métamorphoses promises : « La proposition artistique
[…] constitue pour ses habitants et leur quotidien un événement porteur de relations et d’interactions
nouvelles, en une démarche qui transforme de fait le lien entre les occupants et l’espace public, voire
entre les occupants eux-mêmes. »12. L’enjeu de l’œuvre est de taille, car il s’agit rien moins que de
« vivre ensemble et autrement sa ville »13 . Il ressort à la lecture de ce guide qu’une médiation se
révèle propice en amont de l’acte pour en favoriser les effets, comme il est depuis longtemps admis
dans les théâtres « en dur », dans les auditoriums, les galeries et les musées. « Echanger abondamment
[avec les occupants de l’espace public] peut permettre de créer un lien et susciter un intérêt pour
l’événement à venir. Au delà, une véritable implication peut être proposée14.» L’avertissement
préalable influera donc sur la réception au delà du déroulement du spectacle lui-même : « Au terme
d’un événement dans lequel chacun s’est investi, le sentiment d’en subir les contraintes et les
désagréments laisse place à la satisfaction d’y avoir participé15. »
À défaut d’être l’immédiate incarnation du peuple, le public des arts de la rue peut-il à bon droit se
féliciter d’en refléter la composition sociale ? On en sait davantage à ce sujet depuis l’enquête menée
par Floriane Gaber (avec les conseils de Jean-Michel Guy) auprès de 8.000 spectateurs de neuf
festivals européens appartenant au réseau Eunetstar16. Ses conclusions sont claires : « Dans leur
majorité, les publics européens interrogés ont un fort niveau d'éducation, des pratiques culturelles
supérieures à la moyenne, et beaucoup appartiennent aux catégories socioprofessionnelles les plus
élevées. Ils sont majoritairement jeunes (plus de la moitié ont moins de trente-cinq ans), célibataires et
présentent le profil-type des personnes maîtrisant leur temps et leurs loisirs, et profitant pleinement de
l'offre culturelle qui leur est faite. La rue est un domaine relativement nouveau qui est intégré, au
même titre que les autres sorties (théâtre, concert, expositions, cinéma), dans les habitudes de ces gros
consommateurs de culture. »17 Un pareil constat s’applique sans doute aux quelque 650.000
festivaliers qui, bon an mal an, fréquentent les plus grosses manifestations françaises selon les
évaluations du ministère de la Culture18 et de HorsLesMurs. La similitude entre le gros des effectifs et
ceux que fédèrent les autres disciplines ne doit quand même pas faire oublier qu’un spectacle de rue
attire souvent des personnes qui échappent à la plupart des pratiques tarifées. « Et si […] on ne se
contentait plus de ”compter” le public mais qu’on essayait de le raconter ? ». Cette démarche,
entreprise lors d’un colloque à Sotteville-lès-Rouen en 2005, a été poursuivie méthodiquement dans sa
thèse par Anne Gonon19. Les portraits de groupes et d’individus qu’elle y dresse permettent de vérifier
l’aptitude du théâtre de rue à élargir les contours du public et à enrichir les fonctions du spectateur. Il
n’est pas dit pour autant que les autres arts seraient incapables d’atteindre ce résultat.
Un leitmotiv dans la rhétorique des professionnels du secteur consiste à louer le dynamisme du
spectateur debout, qui contrasterait avec l’inertie de l’observateur assis. Une suspicion pèse sur
l’abonné du centre dramatique ou de la scène nationale : non seulement il s’avérerait un nanti,
privilégié par l’instruction et la culture sinon par la naissance et la fortune, mais encore il se révélerait
un oisif, traînant sa paresse dans le cocon des salles climatisées. L’idée s’adosse à tout un système de
valeurs où l’action l’emporte sur l’attente, la liberté sur l’aliénation, l’engagement sur le retirement.
« Le spectateur n’est plus dans une posture figée. Il est pleinement engagé dans la représentation,
complice volontaire ou involontaire. Dans certaines occasions, il devient même un spect’acteur. Sans
lui la représentation ne peut avoir lieu. Il en est l’interprète principal, ou même l’auteur car il lui faut
parfois écrire la pièce ou la scène qu’on l’a invité à jouer. »20 Un florilège de l’Esthétique des arts de
la rue édité sur DVD par HorsLesMurs illustre ce postulat par des extraits de plusieurs pièces. Le
Concert de public d’Allegro Barbaro, comme les créations participatives de Décor sonore, témoignent
parmi beaucoup d’autres que l’implication du spectateur alimente l’œuvre en substance, qu’elle en
fournit la source et pas seulement le débouché. L’apologie du spectateur actif découle certes d’une
sous-estimation des facultés du récepteur fixe, qu’on tentera bientôt de réhabiliter. Elle tait en outre les

5
conditions de déroulement d’environ deux tiers des spectacles qui ont lieu, notamment dans le cadre
des festivals, dans des aires bornées devant un public sédentaire. Il s’agit alors d’une assemblée
expressément convoquée pour la représentation, consciente de sa fonction collective bien que chacun
de ses membres se soucie de la place qui lui est accessible pour tout voir et bien voir. Il faut à ce
propos relever le retour dans les arts de la rue de la notion de jauge qu’on croyait réservée aux
remplisseurs de salles. Le guide déjà cité est explicite là-dessus : « Finalement la détermination de la
jauge est une démarche centrale du projet et s’articule autour de trois axes que sont l’adéquation avec
la proposition artistique, l’adéquation avec le lieu, et le respect des règles de sécurité. »21 La
spontanéité dût-elle en souffrir, il préconise à cet effet le recours à des moyens de contrôler l’affluence
(une signalétique, des parkings, des barrières, un éclairage, des points d’eau, des toilettes, des rampes
pour les fauteuils roulants, voire des médiateurs), y compris l’instauration d’une billetterie gratuite,
laquelle devient payante dans certains festivals22. Il a maintes fois été signalé que la gratuité avait une
visée symbolique excédant sa portée économique. Elle signifie le libre accès en même temps que
l’affranchissement des conventions, comme si le tarif exonéré appelait l’acte gratuit. On comprend dès
lors ce qu’il en coûte d’y renoncer. La quête, travail « au chapeau » ou labeur « à la manche », ne
déroge pas au principe, mais elle est réprouvée par l’Inspection du travail et des affaires sociales sous
couvert de chasse à la fraude. Sous peine de verser dans le bénévolat ou de courir après le mécénat, il
faut donc que le spectacle ait été payé par la collectivité, laquelle ne souhaite en guise de bénéfice
qu’une meilleure concorde entre ses membres.
Il reste donc à démontrer que la perception du spectateur urbain affecte et informe son intellection
au point de modifier son comportement politique. Le citadin est loin d’être un quidam tiré de son
hébétude par l’irruption des œuvres ou l’intervention des artistes qui lui enjoindraient de se
transformer en super-citoyen. La ville abritant son quotidien, il l’habite aussi à un étage imaginaire,
qu’il en partage certains secrets depuis l’enfance, qu’il s’approprie un recoin dans son dédale, qu’il y
subisse les rigueurs de l’exil ou de l’exclusion. Du reste la pièce peut lui paraître une distraction
passagère, comme la navigation urbaine en ménage souvent : manifestation syndicale, parade
commerciale, chantier de construction, dispute de voisinage, incident insolite, accident de la
circulation. La fiction affronte partout alentour la rude concurrence de la réalité. C’est pourquoi il peut
se laisser détourner par d’autres scènes suscitant son intérêt, autant de spectacles autour du spectacle
qui le distraient des subtilités du théâtre dans le théâtre.
De la dissipation en milieu urbain
Au Musée de Rome, on peut voir un tableau daté de 1656, immortalisant le carrousel allégorique
donné cette année-là par les Barberini au pied de leur palais, en l’honneur de Christine de Suède23.
Deux artistes se sont partagé la tâche de dépeindre le spectacle, le premier s’attachant à l’architecture,
à la ronde des chars et aux personnages en costumes, le second s’attardant sur les attitudes et les
visages des multiples spectateurs. Ces derniers composent un panorama captivant pour le regard de
leurs semblables, malgré la magnificence de la cavalerie caparaçonnée, enrubannée et emplumée, la
splendeur des chars ornés et dorés de toutes parts, la beauté des dragons ondulant entre des vases de
feu et la présence de musiciens chamarrés. Toute la hiérarchie sociale, incluant les nobles et les prélats
(y compris ceux qui justifient du double état), s’étage selon le rang et l’habit sur des galeries et des
gradins tout autour de la cour, sans égard pour les retardataires que des gardes repoussent ni pour les
imprudents qui s’accrochent tant bien que mal aux fenêtres. Les uns pensent et les autres parlent,
certains s’effrayent et plusieurs s’émeuvent, mais il en est aussi beaucoup qui lisent le programme,
commandent à boire ou à manger, montrent un détail à leur voisin, enfin s’absorbent dans
l’observation mutuelle.
Deux siècles plus tard, le spectacle a beau s’être enfermé dans la conque du théâtre, le jeu des
regards persiste à chercher des tangentes à la scène, comme dans cette toile de Mary Stevenson
Cassatt, au musée de Boston, où un homme au second plan scrute de son balcon une femme qui, dans
sa propre loge, braque ses jumelles vers un sujet situé hors du cadre24. De nos jours certains metteurs
en scène enrôlent cette curiosité au service de la dramaturgie. Au Théâtre national de l’Odéon, Éric
Louis et ses complices surprirent ainsi les spectateurs d’un Tartuffe et les promeneurs du Luxembourg,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%