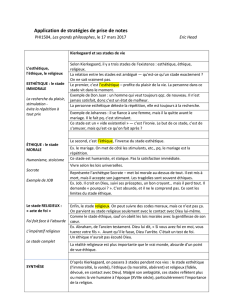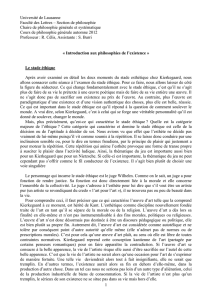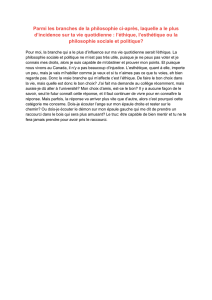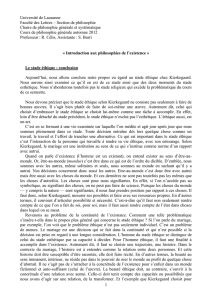1 INTRODUCTION Fidèle à l`enseignement de Socrate, Kierkegaard

1
INTRODUCTION
Fidèle à l'enseignement de Socrate, Kierkegaard (Copenhague, 1813-1855) s'est lui-
même efforcé, par une ironie constante et méthodique, d'éveiller l'attention de ses
contemporains à la nécessité de retrouver le sens d'un idéal véritable. Refusant toute
démarche spéculative, il ne prétend jamais dire le quoi de cet idéal, mais préfère indiquer
comment on s'y rapporte. Cette distinction est ici décisive dans la mesure où elle met
d'emblée en exergue la césure fondamentale entre l'existence et la pensée, le réel et le virtuel,
ou encore l'être et le dire, sur laquelle se fonde la philosophie kierkegaardienne. Alors tracée,
cette ligne de démarcation nous permet de nous orienter directement vers ce qui constitue
l’originalité de son œuvre dans l’horizon philosophique du 19ème siècle, c’est à dire cette
volonté de suspendre le sens au profit du geste, la théorie à celui de l’existence.
Tandis que le philosophe classique tente d’ordonner le monde sensible aussi bien que
le monde intelligible selon les principes de la raison, Kierkegaard, lui, se détache nettement
de cette philosophie qui appréhende la réalité selon les normes d’une intelligibilité abstraite.
L’homme n’est pas le détenteur de la vérité. Il ne la possède pas, mais il est bien plutôt
possédé par elle. L’individu ne peut être que le témoin d’une vérité qui toujours déjà lui
échappe. Irréductible à l’ordre de la parole et de la raison, la vérité demeure au-delà de toute
dicibilité. Socrate déjà l’annonçait : l’essence de la vérité est d’être insaisissable ; elle ne se
laisse nullement exposer par le langage humain et c’est pourquoi le penseur existentiel ne
peut communiquer que de manière indirecte, en procédant par allusions. Conformément au
message socratique, Kierkegaard ne fait qu’orienter ironiquement son interlocuteur vers cette
seule certitude : l’homme n’est pas en mesure de posséder une quelconque certitude. De là,
la multiplicité des voies empruntées par Kierkegaard : tantôt esthète, tantôt penseur
religieux, ou bien encore, virtuose de l’ironie ; la diversité concrète de sa pensée marque sa
volonté de s’opposer à l’unité abstraite et impersonnelle de la philosophie classique en
général, et systématique en particulier. Il ne s’agit que – tel que le faisait Socrate – d’épuiser
par le questionnement les contenus apparents et contradictoires des réponses, afin de les
annuler et de laisser place au néant. Tel est précisément le sens de la méthode ironique : « On
peut, en effet, interroger avec l’intention d’obtenir une réponse qui donne pleine satisfaction,
de sorte que, plus on interroge, plus aussi la réponse prend de profondeur et d’importance ;

2
ou bien on peut interroger, non pas en vue de la réponse, mais pour épuiser par sa question le
contenu apparent et laisser ainsi un vide. La première méthode suppose naturellement qu’il y
a une plénitude, et la seconde qu’il y a un vide ; la première est la méthode spéculative, la
seconde la méthode ironique. »1. L’ironie socratique demeure infiniment négative ; elle ne
comporte ni synthèse ni progrès. Elle se contente de nier en interdisant ainsi toute
progression dialectique. En d’autres termes, elle ne donne naissance à aucune positivité.
Socrate se contente en effet de s’interroger sur l’essence et ne fait qu’indiquer le sens de
l’idéal, contrairement à ses contemporains qui transforment l’idéal en objet de savoir.
La philosophie platonicienne est celle qui inaugure l’incompréhension de la pensée
de Socrate : Platon s’est leurré en croyant que la négativité de l’ironie fonde en réalité une
positivité : celle du concept. Or, en réalité, le discours socratique ne fait que suggérer l’idée,
mais ne renvoie jamais à la pleine présence de cette dernière. Il aboutit toujours à une idée
vide de tout contenu. Cette erreur, Hegel la reproduit : il fait de la négativité de l’ironie
socratique un moment de la dialectique, entièrement absorbé par la positivité qui lui succède.
L’opposition Hegel-Kierkegaard2 repose ici sur l’interprétation de la méthode socratique et
se justifie par les présupposés de leurs philosophies respectives. Hegel fait de l’ironie le
premier moment de la dialectique. La méthode socratique repose, selon lui, sur une double
détermination. L’une, positive qui correspond au moment maïeutique : là, elle fait naître
l’universel à partir du cas particulier et met ainsi au jour l’idée qui est en soi dans chaque
esprit. L’autre, négative, détruit les opinions, les certitudes, et jette le trouble dans les
consciences. Tandis que Kierkegaard ne retient que ce moment négatif, Hegel fait de
Socrate, un personnage bifrons balançant perpétuellement entre positivité et négativité. Le
négatif pour lui n’étant jamais une fin en soi ; si l’ironie détruit les certitudes, ce n’est que
dans le but d’orienter l’individu vers le bien véritable, vers l’universel. Et en ce sens, elle
n’est utilisée qu’« au profit de l’idée de justice et de vérité contre l'imagination de la
conscience inculte ou sophiste. »3. La figure de Socrate se trouve ainsi inscrite par Hegel, au
cœur de la pensée systématique : la négativité de l’ironie n’est plus qu’un moment
dialectique, entièrement absorbé par la positivité qui lui succède, et c’est pourquoi,
1OC II ; Concept d’ironie, p.35
2 Sarah Kofman a mis en lumière la différence essentielle existant entre la conception hégélienne de la
maïeutique, et celle de Kierkegaard : « Après de longs travaux de sape, Socrate, observateur ironique, jouissait
de la surprise de l’interlocuteur de voir ainsi tout s’écrouler, sans que rien ne soit offert par ce maître à la place.
(…) Tel était l’art socratique de la maïeutique à qui Kierkegaard, contrairement à Hegel, ne donne donc aucune
orientation positive (…), en accoucheur incomparable, Socrate hâte seulement la délivrance spirituelle de
l’individu, coupe le cordon ombilical qui le rattache à la substantialité, sans engager aucunement sa
responsabilité sur l’avenir de l’accouché. » S. Kofman, Socrate(s), Paris, Galilée, 1989, p. 273
3 Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 140 ; trad. de l'allemand par André Kaan, Paris, Gallimard, coll.
« idées », 1940, p.183

3
Kierkegaard reproche à Hegel de confondre Socrate avec Platon, faute de distinguer deux
types de dialectiques, deux façons d’interroger radicalement divergentes. Mais c’est aussi la
raison pour laquelle, la position de Kierkegaard face à Hegel, recouvre précisément celle de
Socrate face à Platon. Tandis que Hegel progresse dialectiquement jusqu’à l’idée, réalisant
ainsi pleinement l’idéal spéculatif, Kierkegaard, lui se tient toujours en deçà de la pleine
possession de l’idée ; il exprime ainsi cet effort incessant d’appropriation, cette tension
infinie vers un idéal se dérobant sans cesse.
En mettant l’accent sur l’impossibilité d’atteindre effectivement le vrai par le biais
de l’abstraction, il semble ainsi indiquer la nécessité d’un retour à un savoir bien plus
primordial : celui de la signification de l’existence pour un individu existant, savoir ne se
laissant jamais appréhender par la simple pensée. L’homme doit apprendre à se connaître
avant de vouloir saisir le reste du réel, c’est pourquoi l’auteur du Post-scriptum souligne :
« Socrate a dit non sans ironie qu’il ne savait pas avec certitude s’il était un homme ou
quelque chose d’autre ; mais un hégélien peut dire au confessionnal en toute solennité : je ne
sais pas si je suis un homme, mais j’ai compris le Système. Je préfère pourtant dire : je sais
que je suis un homme et je sais que je n’ai pas compris le Système »4. Cette relation mettant
en évidence le parallélisme existant entre Socrate et Kierkegaard n’est pas simplement
fortuite ou anecdotique. Bien au contraire. Celle-ci nous permet de découvrir, de façon
symétrique, la méthode proprement kierkegaardienne qui repose sur une méthode identique à
celle qu’inaugurait la maïeutique socratique. Kierkegaard évoque lui-même dans ses Papirer
« ce lien inexplicable » qui le lia à Socrate dès « sa prime jeunesse »5. Dans l’une des notes
datant de 1843, relatant très probablement sa propre situation, il évoque la situation d’un
jeune homme, qui, échouant à trouver un maître parmi ses contemporains, exprime le désir
de devenir lui-même Socrate : « Il y avait un jeune homme comblé de dons comme un autre
Alcibiade. Sa vie s’égara. Dans sa détresse il se mit à la recherche d’un Socrate, mais sans en
trouver parmi ses contemporains. Alors il pria les dieux de le muer lui-même en Socrate. »6.
Et en effet, tel Socrate, s’attachant à mettre en exergue par son ironie, l’illusion sophistique,
Kierkegaard s’efforça quant à lui, par cette même méthode, de réveiller la chrétienté afin de
lui faire retrouver le sens d’un idéal véritable. Il ne prétend cependant jamais dire le quoi de
cet idéal, mais se contente d’indiquer comment on s’y rapporte. C’est pourquoi, par le biais
d’une ironie constante et méthodique, que l’on retrouve du Concept d’ironie (1841), jusque
4Post-scriptum aux Miettes philosophiques, trad. du danois par P. Petit, Paris, Gallimard, coll. « tel », 1949,
p.208
5 Pap. X 5 A 104 (1853)
6 Pap. IV A 43 (1842)

4
aux derniers articles de l’Instant (1855), publiés juste avant sa mort, Kierkegaard n’indique
pas le lieu de la vérité ; il se borne à signaler que si une vérité existe, elle ne se trouve sans
doute pas à l’endroit où ses contemporains semblent vouloir la chercher. D’où les critiques,
plus ou moins virulentes, à l’égard de certains penseurs de son époque, mais aussi et surtout
à l’égard de l’Eglise officielle qui falsifie le christianisme7. C’est pourquoi, selon G.
Malantschuk, cette symétrie entre les deux penseurs nous autorise à qualifier Kierkegaard de
« Socrate de la chrétienté »8. En effet, tandis que le penseur grec s’attachait à éveiller
l’attention de ses contemporains à la plus haute vérité du paganisme, Kierkegaard essaye
quant à lui d’attirer le regard des siens en direction de la vérité du christianisme. Toutefois, si
cette situation dénote d’une grande proximité, celle-ci se limite pourtant à la méthode
employée par les deux penseurs. Un événement majeur les sépare en effet ; celui de la
Révélation divine dans laquelle, selon Kierkegaard, s’est manifesté l’Etre de la Vérité. En ce
sens, l’ironie ne fait que rendre l’individu attentif au sens de la vérité, elle n’en révèle pas le
lieu. C’est pourquoi, Kierkegaard remarque dans ses Papirer : « Socrate n’avait pas le vrai
idéal ; ni l’idée du péché, ni celle non plus que le salut de l’homme exigeait la crucifixion
d’un Dieu (…). Aussi conservait-il l’ironie qui exprime seulement qu’il était au dessus de la
méchanceté du monde. Mais pour un chrétien l’ironie est trop peu, elle ne peut jamais
correspondre à cet épouvantement que le salut exige la crucifixion d’un dieu, alors que dans
la chrétienté elle peut certes pour un temps faire office de réveil. »9.
Le pouvoir de l’ironie ne se limite cependant pas au réveil de la chrétienté.
Kierkegaard entend également dénoncer, par une ironie mettant en exergue le décalage
existant entre l’être et la pensée, ou encore entre le discours et le sens, cette prétention de la
philosophie classique à vouloir appréhender objectivement ou rationnellement le vrai. La
vérité, pour lui, ne se découvre jamais par le biais de l’objectivité. La raison n’est que
l’incarnation d’une forme suprême de mystification qu’il s’attache à dénoncer, une simple
tromperie retenant l’homme captif de l’illusion selon laquelle la vérité est objectivement
accessible. Selon lui, cette dernière se situe à un autre niveau : contre le primat accordé par
la philosophie classique à l’objectivité du savoir et à la systématisation de la pensée, il
affirme l’absolue nécessité de penser l’homme sous l’angle de la subjectivité ; l’auteur du
7 Et c’est pourquoi Kierkegaard répondra, dans un article de Fædrelandet datant du 27 avril 1855, au pasteur V.
Bloch, qui réclamait que les portes de l’Eglise lui soient fermées, que depuis longtemps, il a « choisi pour des
raisons chrétiennes » de ne plus fréquenter le lieu du culte. Cf. OC XIX ; Vingt et un article de Fædrelandet, p.
59-62
8 OC XX ; Index terminologique, p. 170
9 Pap. X 3 A 253 (1850)

5
Post-scriptum écrit en effet : « le malheur de notre époque est l’excès de savoir et l’oubli de
l’existence et de l’intériorité. »10. La raison ne fait que cacher l’existence en la dénaturant : il
s’agit de retrouver la réalité de l’existence derrière le voile que la raison a jeté sur elle. En ce
sens, Kierkegaard délimite dans sa quête de vérité deux formes distinctes du savoir. Le
savoir objectif, dans son indifférence à la vie du sujet, ne s’intéresse qu’au monde fini et
quantitatif. Il est le domaine d’investigation privilégié de sciences telles que les
mathématiques, l’histoire, ou encore les sciences naturelles. Ou pour le dire en termes
proprement kierkegaardiens, ce savoir ne concerne que le quoi de la quantité. Dans cette
perspective, la vérité se détermine comme accord de l’être avec la pensée (idéalisme), ou
vice versa, de la pensée avec l’être (matérialisme). Mais dans les deux cas, il ne s’agit
toujours que d’une vérité abstraite, étrangère à l’existence de l’individu. C’est pourquoi, à
cette région du savoir qui ne fournit qu’une description objective et abstraite de la réalité
phénoménale, Kierkegaard oppose une connaissance ayant pour objet l’homme lui-même,
car lui seul possède cette capacité de se rapporter à cet éternel, devenant alors le seul garant
de la vérité et de la liberté.
En nous proposant de revenir à cette connaissance primordiale, Kierkegaard nous
invite par là même à retrouver un savoir primitif, enfoui de façon immémoriale au cœur de
l’oubli. Cet oubli constitutif qu’il s’agit de restituer est l’oubli même de la vie. Le savoir
désintéressé élude le problème de l’existence en le reléguant aux confins de son domaine
d’investigation. Ne se laissant pas approcher de façon objective, celui-ci demeure
irrémédiablement extérieur à son champ d’observation. En ce sens, la pensée spéculative
demeure incapable de résoudre les problèmes purement existentiels. Elle se révèle
impuissante à fournir à l’individu un principe directeur lui permettant de s’orienter sur le
chemin de la vie. Ainsi, comme l’écrit Kierkegaard dans son Journal de 1846 : « La difficulté
de toute spéculation philosophique augmente à mesure que dans l’existence on doit appliquer
ce dont on spécule. (…) d’ordinaire il en va pour les philosophes (Hegel comme tous les
autres) comme pour la plupart des gens : au fond leur existence, dans le train de tous les
jours, se situe dans de tout autres catégories que celles de leur réflexion, ils se consolent avec
tout autre chose que ce dont ils parlent sentencieusement. De là toute cette menterie et
confusion qui règnent dans la pensée philosophique. »11.
Ainsi, Kierkegaard nous propose de faire retour à cette question la plus primitive qui
est celle de l’individu même ; comme il l’indique dans ses leçons sur la dialectique de la
10 PM p. 179
11 Pap. VII A 80 (1846)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
1
/
292
100%