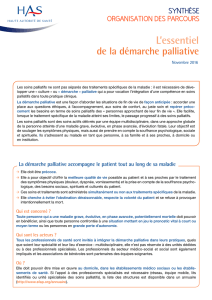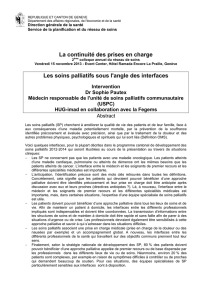Lire l`article complet

64
La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - n° 2 - mars-avril 2004
VI E P R O F E S S I O N N E L L E
L
e stress professionnel n’est pas l’apanage des profes-
sions de santé. Néanmoins, de nombreuses études en
attestent l’existence chez les soignants. Les médecins,
de manière générale, restent en France une catégorie de soignants
peu étudiée ( 6 ), par opposition aux infirmières (17, 33). Leur santé
mentale est pourtant une préoccupation ancienne des pays anglo-
saxons (5, 18, 24, 31). La solitude de l’exercice médical est-elle
la seule raison de cette carence en France ?
L’évolution des attentes des patients face à la médecine, le
développement incessant et exponentiel du savoir biomédical,
le poids croissant des contraintes économiques hospitalières,
les tâches administratives lourdes et répétitives retentissent sur
le médecin. Stress répétés et souffrance peuvent conduire au
burn out – état d’épuisement physique et émotionnel décrit
depuis longtemps ( 4 ) , aux causes multiples et aux consé-
quences préjudiciables sur la prise en charge des malades.
Souffrir de soigner : le burn out des médecins
travaillant en soins palliatifs
Suffering in giving medical care: burn out syndrome
among physicians working in palliative care
●
P. Fournier*
“
Les valeurs dominantes de notre société occidentale sont le bien-être physique, la satisfaction des plaisirs... et l’illusion de la toute-
puissance de l’homme. L’infirmité, la maladie et la mort sont devenues anormales et doivent être combattues. Nous vivons une ère de
confort où tout concourt à l’éviction des situations pénibles ; la douleur se confond avec le ‘mal’ et n’est plus supportable. La perte de
proches paraît incroyable et paradoxale : nous vivons aveugles à la mort...
... Nous vivons ainsi une situation éminemment temporelle où la notion de bien est matérielle et celle de mal exprime l’inconfort... Quant
à la mort, elle n’est plus un tremplin vers autre chose, mais une fin inavouable dépouillée de tout contenu. L’homme moderne vit inten -
sément, puis bascule dans le néant...
... Cette crise aboutit à la perte de repères essentiels tels que la conscience de notre finitude.
”
M.L. Lamau. Manuel de soins palliatifs. Paris : Édition Dunod, 1996 ; 13.
“
Choisir d’être médecin, ce n’est pas choisir entre deux spécialités ou deux modes d’exercice, mais d’abord entre deux attitudes, entre
deux positions. Celle de ‘docteur’, celle de soignant. Les médecins sont plus souvent docteurs que soignants. C’est plus confortable, c’est
plus gratifiant, ça fait mieux dans les soirées, les dîners... Le docteur ‘sait’ et son savoir prévaut sur tout le reste. Le soignant cherche à
apaiser les souffrances. Le docteur prescrit. Le soignant panse. Le docteur cultive le verbe et le pouvoir. Le soignant dérouille
”
.
M. Winckler. La maladie de Sachs. Paris : Édition POL, 1998 ; 415-6.
Force est de constater la rareté des publications, enquêtes ou
réflexions sur les sources de stress, le degré et les causes de
souffrance, et enfin la fréquence du burn out chez les médecins
travaillant en soins palliatifs.
Ces derniers – entendus ici comme soins prodigués en fin de vie
( 2 1 ) , et non pas forcément leur restriction localisatrice à des uni-
tés spécialisées – font-ils disparaître la souffrance ? Terrible illu-
sion, car, compte tenu de l’angoisse de la société et de l’individu
face à la mort et à l’au-delà, le médecin confronté à la fin de vie
reste lui aussi vulnérable. Cette vulnérabilité peut déboucher sur
l’épuisement, la “brûlure intérieure” et le besoin de se protéger.
Une deuxième illusion serait de supposer que les soins pallia-
tifs transforment l’expérience du mourir et la rendent plus
h u m a i n e ! Cette “belle mort”, aseptisée, “palliativement cor-
recte” (15), n’aurait-elle pas pour but de protéger le médecin ?
Malmené, surchargé, surmené, épuisé, le médecin doit affron-
ter la peine personnelle résultant de la rupture que la déchéance
et la mort d’un malade sont en train de provoquer en lui (16).
*Service SSR, hôpital de Poissy, 78303 Poissy.

VI E P R O F E S S I O N N E L L E
65
La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - n° 2 - mars-avril 2004
Après un survol de l’originalité du mouvement des soins pal-
liatifs, on s’attardera, à travers l’analyse de quelques articles de
la littérature, à identifier les sources de stress et de satisfaction
au travail, en essayant de savoir si le burn out chez le médecin
de soins palliatifs trouve son origine dans le caractère singulier
de la relation médecin-malade ou dans la confrontation avec la
souffrance et la mort, ou tout simplement dans les conditions et
l’environnement de travail, principalement constitué par l’équipe
et la hiérarchie hospitalière.
Menace pour les patients, fatalité, prix à payer, fréquence,
ampleur, modes de prévention, autant de questions sur cet épui-
sement, questions parfois sans réponse devant le peu d’enquêtes
auprès des médecins. Il serait temps pour les autres soignants de
découvrir que le médecin travaillant en unité de soins palliatifs
(USP), en équipe mobile ou en réseau, est vulnérable, et que sa
parole, qui exprimera doute et désillusion, peut être entendue.
Car notons que la mort de ses patients le laisse parfois sans voix
( 1 6 ) au sens propre et figuré, qu’il n’a presque rien à dire, ou à
en dire, et qu’il n’a personne pour l’écouter (40, 41).
Soigner, panser, penser, réfléchir, souffler, mais aussi parler, tel
est l’univers du médecin. Son métier est porteur de satisfaction au
plan professionnel et au plan humain. Le stress apparaîtrait comme
la rançon d’une qualité de soins préservée, d’exigences profes-
sionnelles satisfaites. Mais le burn out ne finit-il pas par compro-
mettre ces soins mêmes que le médecin cherche à préserver ?
LA DÉMARCHE PALLIATIVE : UN CHANGEMENT
DE LOGIQUE... UNE MENTALITÉ
Depuis une quinzaine d’années, les soins palliatifs se sont large-
ment implantés au sein des institutions hospitalières et à domi-
cile. Cette tentative louable d’humanisation comporte un aspect
p o s i t i f : répondre à la crainte de personnes malades d’un cancer
d’être abandonnées et de décéder dans un univers hautement
spécialisé ou technicisé où leur corps ne serait qu’un objet
d’étude entre les mains de la science. L’aspect négatif de ce
courant est de continuer à médicaliser la mort, car ce mouve-
ment aboutit à ce contre quoi il voulait lutter : dans notre
société actuelle ultramoderne, on assiste à la promotion d’une
nouvelle catégorie de citoyens, la catégorie des “mourants”, et
d’une nouvelle catégorie de médecins, celle qui “sait faire de
l’accompagnement”. Certes, le mouvement “des soins palliatifs”
a pour mérite de reparler de la mort dans une société où elle est
(était) occultée, rejetée, niée, et véhicule ainsi une certaine idée
de la vie, de la solidarité humaine devant la souffrance et une
certaine idée de la mort. Or, celle-ci n’est pas un événement
m é d i c a l : sa survenue en milieu hospitalier ou institutionnel fait
illusion. C’est un événement personnel auquel chacun est tenu
de se préparer.
La remise en question par la souffrance de l’autre
Travailler en soins palliatifs, c’est côtoyer journellement, régu-
lièrement, sans cesse l’autre, le malade souffrant... et, de manière
inéluctable, souffrir de cette souffrance (29, 31, 32).Souffrir de
voir ces corps “morcelés”, dégradés, objets de dégoût et de
peur, malodorants, remaniés, attaqués..., ces corps qui nous ren-
voient à ce que nous sommes et à ce que nous pourrions devenir
ou deviendrons. Souffrir d’entendre le cri, la plainte, les hurle-
ments, l’appel ou, au contraire, le silence de celui qui ne peut ou
ne veut plus parler. Souffrir de voir l’entourage, la famille (unie
ou, au contraire, éclatée) qui parle, crie, se lamente, juge, récri-
mine ou se renferme dans le chagrin. Mais le médecin – comme
tout soignant – n’est-il que le récipiendaire de la souffrance de
l ’ a u t r e ? Cette souffrance ne vient-elle que de l’autre ?
Le couple “savoir-pouvoir”
Soigner, réparer, recoudre, suturer, cajoler, nourrir, bercer, conso-
ler... Pourquoi ces aspirations si impératives pour le médecin ?
La médecine sert-elle à former le praticien à jongler avec des
connaissances ou à soigner ?
“La longue formation universitaire le façonne pendant un mini -
mum de huit à dix ans dans une collectivité où l’excellence se
définit par de très amples connaissances d’objectivation du corps
de l’autre. Les études médicales consistent à absorber un savoir.
La compétence de chacun sera évaluée par cet acquis, dont les
examens, et notamment l’internat, puis les publications scienti -
fiques constituent le gage de légitimité. Le savoir fonde l’identité
du médecin : il donne accès au pouvoir sur le patient et les
collègues. Dans l’institution hospitalière, celui qui possède le
savoir médical semble avoir tout le pouvoir” ( 2 6 ) .
Ce couple “savoir-pouvoir” (26) a évidemment une fonction de
protection, comme un bouclier que le soignant utilise contre
l’angoisse générée par des situations médicales délicates. Mal-
heureusement, il peut se révéler inopérant lorsque la médecine
se trouve confrontée à ses limites, quand la maladie cancéreuse
progresse, et que l’état physique de la personne malade continue
de s’altérer. Dans le contexte de soins d’accompagnement, si ce
référentiel “savoir-pouvoir” s’effondre ou se révèle inadéquat,
le médecin se retrouve laminé par la souffrance de l’autre, sur-
tout lorsqu’elle entre en résonance et fait écho à sa propre souf-
france (36).
La médecine palliative requiert un changement de mentalité.
Au lieu de se sentir investi d’un pouvoir et d’une responsabi-
lité de “sauver des vies humaines” par l’intermédiaire de tous
les progrès techniques et thérapeutiques ( 2 8 ) mis à la disposi-
tion du corps médical, le médecin renonce à cette attitude.
Proclamant cette impuissance à guérir, mais ne l’acceptant
pas réellement, il reste traversé par un sentiment d’échec, de
tristesse et de culpabilité, notamment lors de la confrontation
directe avec la mort de l’autre (syndrome du survivant), qui le
renvoie à sa propre mort et à l’angoisse qu’elle génère, culpa-
bilité et échec du savoir. Mais, dans ce désir louable d’une
prise en charge de qualité des patients, resurgit bientôt en lui
un sentiment de toute-puissance. À l’opposé, confronté à cet
incessant souhait de savoir et de pouvoir souvent inhérent à sa
fonction médicale initiale, il risque de chercher (à tort) à quitter

VI E P R O F E S S I O N N E L L E
66
La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - n° 2 - mars-avril 2004
celle-ci pour s’identifier dans une autre fonction ou s’occuper
d’autres territoires (philosophique, psychologique...).
La pression institutionnelle
Le médecin hospitalier se présente généralement comme celui
qui sait. Il a le plus souvent une approche individuelle du soin e t
un faible sentiment d’appartenance à la structure hospitalière.
Toutefois, c’est souvent autour d’enjeux institutionnels ( 3 0 ) q u e
se situe une concurrence féroce de laquelle émerge une autre
reconnaissance, celle de ses pairs et de l’administration, et que
se jouent souvent sa carrière et sa place dans l’institution et les
différentes instances que celle-ci comporte.
La mentalité de la société actuelle
L’approche actuelle de la souffrance du médecin favorise une
explication psychologique : les difficultés relationnelles avec le
patient, les familles, l’équipe soignante et l’institution sont abon-
d a m m e n t décrites et les explications pertinentes. N’y aurait-il
pas une vision plus sociologique ( 2 7 ) ? Dans le contexte “d e
médecine performante, de succès thérapeutique, d’incontes -
tables progrès scientifiques, d’utopie collective de santé par -
faite, d’une société qui refuse la souffrance et qui proclame le
droit à la santé (et par-là même à la guérison), confondu avec
le droit et l’accès légitime aux soins, le médecin est en position
de souffrance, car il reçoit une demande qui se heurte à la dégra-
dation du corps humain, au vécu du malade et à la mort ”(27).
Dans ce contexte sociologique, le médecin ne serait qu’un “auxi-
liaire de santé” (la question au patient “De quoi souffrez-vous ? ”
est remplacée désormais par “Que désirez-vous ?”), qui n’aurait
qu’à exécuter les prescriptions médicales. Tout contribue à ce
que la médecine donne “de la guérison” sous la forme d’une
ordonnance. C’est ce qu’il est censé faire ou, en tout cas, ce que
la société attend de lui. Le médecin travaillant auprès de patients
en fin de vie résiste à ce courant sociologique, car il a déjà com-
pris qu’une partie de la souffrance est générée par la rencontre
entre cette utopie collective de la santé parfaite et la réalité de
l’homme souffrant.
Tout faire, mais ne rien dire
Deux lois régissent le monde médical. Premièrement, la “loi du
tout” (38). Tout doit être fait pour le malade, aussi bien sur le
plan médical que technique, voire idéologique. Le respect de cette
loi, de cet impératif, porte à mobiliser toutes les énergies pour
que l’espace entre tâche prescrite et tâche réalisée soit quasi
nul, et conduit à un investissement presque total dans l’activité
de soin avec, à terme, un sentiment d’échec, voire de déses-
poir, si tout ne peut ou n’a pu être fait. L’humilité du médecin
consiste souvent à savoir “passer le relais”, ses collègues et
l’équipe étant là pour assurer la continuité des soins.
La seconde loi est la “loi du silence” (4, 38),qui va bien au-delà
du secret professionnel et dépasse amplement les obligations
déontologiques. Elle camoufle des dysfonctionnements de
l’équipe et signifie que la souffrance du médecin ne peut jamais
être exprimée, reconnue, dite, parce que jugée inacceptable. Il est
interdit au soignant de penser et de parler. Cette loi du silence est
entretenue et aggravée par le corporatisme médical qui protège
le confrère malade, l’autorise au recours à l’autoprescription et
nie son épuisement psychique.
GÉNÉRALITÉS SUR LE BURN OUT DU SOIGNANT
Le burn out est initialement introduit par Freundenberger en
1 9 7 4 : il se décrit comme une grande fatigue professionnelle
attribuée “à la mise à l’épreuve des idéaux professionnels
par des sollicitations multiples et souvent contradictoires”.
La modélisation psychologique de ce concept ( 4 ) est due à
Maslach, qui le décompose en trois dimensions :
✓l’épuisement émotionnel (tant physique que psychique) ;
✓le désinvestissement de la relation ou dépersonnalisation,
la relation devenant impersonnelle, vide d’affects, le patient
étant considéré, à l’extrême, avec cynisme et détachement ;
✓la diminution du sentiment d’accomplissement personnel
au travail, avec le sentiment d’être incompétent et inefficace.
Maslach élabore ( 4 ) un instrument de mesure fiable, le MBI
(Maslach Burn Out Inventory), autoquestionnaire à 22 i t e m s
dont 9 mesurent l’épuisement émotionnel, 5 le retrait et le
désinvestissement, 8 la satisfaction au travail. Ces trois compo-
santes sont indépendantes, mais aussi liées entre elles : l’épui-
sement apparaît comme le résultat de sollicitations environne-
mentales excessives pour les ressources de l’individu ; le
désinvestissement de la relation peut être compris comme une
tentative de s’opposer à cet épuisement, mais conduit à une
diminution de la satisfaction liée au travail, puisque la relation
désinvestie n’apporte plus la même satisfaction.
Définition, description et limites du concept de burn out (à ne
pas confondre avec une dépression), outils d’évaluation de cet
épuisement et analyse des facteurs de stress, stratégies préven-
tives individuelles et institutionnelles préconisées sont décrits e n
détail dans de nombreux documents et ne seront pas rappelésici
(4, 37).
Les professionnels de l’aide dispensent sous une forme ou une
autre un secours, une assistance, des soins, des conseils... à autrui.
L’investissement dans la relation à l’autre est au centre de leur
activité professionnelle. De par la nature même de leur travail,
ils sont régulièrement confrontés à la détresse humaine ( 3 7 ).
Dans ce champ des professions d’aide, le burn out survient lorsque
l’individu ne parvient plus à faire face à ces contraintes de travail
et renonce... trahissant en quelque sorte les valeurs associées à sa
profession. La déshumanisation de la relation à l’autre – d e u x i è m e
dimension et noyau dur du syndrome – signifie que le soignant
adopte une attitude et un comportement contraires à l’éthique et
à l’essence même de la profession qu’il a embrassée : cette dis-
tanciation à l’autre, d’installation parfois insidieuse et progres-
sive, conduit à soigner l’organe avant l’individu (considéré comme
un objet ou une chose), avec toutes les conséquences néfastes que
cela peut avoir sur la qualité de la prise en charge ( 2 1 ).

67
La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - n° 2 - mars-avril 2004
VI E P R O F E S S I O N N E L L E
Poser le problème de l’épuisement émotionnel des soignants,
c’est reconnaître la violence des émotions qu’ils peuvent ren-
contrer et mettre en évidence l’humanité de la fonction d’aide
aux soignants par rapport à la technicité des actes.
Né d’une interrogation sur la souffrance au travail, le syndrome
d’épuisement prend, spécialement dans le champ de la santé, un
développement inquiétant. Malaise professionnel intemporel ou
actuel, crise au sein de certains corps de métier ou phénomène
social, cet état de fait va de pair avec une problématique exis-
tentielle propre à notre époque. Comment une société occiden-
tale peut-elle tolérer que ceux auxquels elle confie sa santé et
souvent sa mort s’épuisent tant, en donnant aux autres ? Le b u r n
ou t n’est pas une maladie. Assumer plusieurs décès par semaine,
prendre des décisions thérapeutiques difficiles, être confronté
de façon répétée aux progrès et aux échecs de la médecine reste
lourd. Expression d’une crise d’identité, il signifie au soignant
que le sens de son action, c’est l’autre. La valeur de l’acte réside
non dans la technique, mais dans la relation : en ce sens, la
médecine resterait-elle un art ?
LE BURN OUT DES MÉDECINS TRAVAILLANT
EN SOINS PALLIATIFS
Généralités – Études préliminaires
Le travail de soins comporte donc une charge mentale et psy-
chique qui renvoie le médecin (et tout personnel soignant) à son
seuil de tolérance et à sa capacité à mobiliser ses ressources per-
sonnelles ( 3 9 ). Chaque spécialité médicale possède ses particu-
larités et rend compte de difficultés spécifiques pour le praticien
qui y exerce son métier. Travailler en pédiatrie ( 4 2 ), en réani-
mation ( 4 ), en cardiologie (4, 14), en maladies infectieuses,
notamment avec les sidéens ( 6 ), en chirurgie ( 3 ), voire en radio-
logie ( 2 0 ) , engendre de la souffrance, même si certaines causes
paraissent directement liées à la spécialité concernée : les
valeurs retrouvées au MBI dans ces différentes populations
varient suivant les caractéristiques de celles-ci (âge, type
d’exercice...), mais relativement peu suivant la spécialité ( 1 3 ).
Le milieu oncologique (7, 13, 18, 24, 39), hématologique (9) et
les services de radiothérapie (1, 39) font l’objet d’études
approfondies dans lesquelles apparaît un niveau élevé d’épui-
sement et de désinvestissement – comparable à celui observé
dans des services de soins intensifs, d’urgence ou pour soins de
sidéens (6, 13) –, mais un niveau d’accomplissement personnel
moindre, le milieu cancérologique apparaissant comme protec-
teur (25). L’alternance curatif/palliatif, la surcharge de travail,
la fréquence de répétition de la prise en charge de symptômes
difficiles tels que douleur, dyspnée, tumeur putride, hémorra-
gies extériorisées, la répétition de décès ont amené, dans la
décennie écoulée, une réflexion palliative au sein de ce milieu
oncologique (2, 7, 11, 24). Déjà, en 1991, Whippen et al. (46)
font état de difficultés à prendre en charge des patients en
phase palliative au sein de services aigus où alternent “chimio-
thérapie et décès” : dans leur enquête, 60 % de 1 000 abonnés à
la revue Journal of Oncology tirés au hasard renvoient leur
questionnaire, et 56 % de ceux-là déclarent avoir expérimenté le
burn out dans leur vie professionnelle avec, comme raisons invo-
quées, l’insuffisance de temps de vacances, la charge de travail
clinique, les deuils répétés et l’accompagnement de patients en
fin de vie. Cette prise de conscience incite certains auteurs à pro-
poser de “décloisonner” le milieu oncologique et les services de
soins de confort ( 7 ). Une circulaire récente du ministère de la
Santé en France, qui met l’accent sur “les lits identifiés ou dédiés
de soins palliatifs” dans des services de courte durée ou de SSR,
irait dans le même sens ( 8 ). Cette pratique bouscule les mentali-
tés, puisque ce qui unifie le groupe ou l’équipe, la logique cura-
tive, disparaît au profit du patient, qui retrouve sa place centrale.
Du coup, les hiérarchies sont bousculées, le questionnement et le
doute font irruption et des conflits peuvent apparaître ( 1 0 ).
Le milieu spécifiquement palliatif fait l’objet de peu d’études.
Dès 1995, Vachon (psycho-oncologue, Canada) constate, au
cours d’une revue de littérature exhaustive ( 4 4 ), que l’épuise-
ment dans les services de soins palliatifs est loin d’être universel,
et le montre comme étant moins élevé que pour d’autres spécia-
lités. L’identification précoce d’un stress potentiel intrinsèque,
lié à l’individu ou à sa fonction, et extrinsèque, lié au dysfonc-
tionnement de l’équipe ou du système de soins ( 1 1 ) , et la mise
en œuvre de stratégies appropriées individuelles et de groupe
(formation continue, projet d’équipe, groupe de parole) expli-
quent sûrement ce niveau plus bas du burn out. Des travaux ulté-
rieurs ( 4 5 ) corroborent ce fait, et Vachon démontre que l’essen-
tiel du stress observé est dû le plus souvent à des facteurs
indépendants des soins donnés aux malades tels que l’organisa-
tion du service, le fonctionnement de l’équipe et la pression
administrative. Sans le nier complètement, l’auteur semble mini-
miser le rôle de la confrontation avec la mort comme source de
stress ( 4 5 ) , contrairement à d’autres auteurs (39, 41) c o m m e
Shaerer ( 4 3 ) , qui suppose que la souffrance du médecin “ne se
trouve pas dans les difficultés auxquelles il fait face, mais dans
celles qui le surprennent faute de temps, de réparation, de sou-
tien”. L’impréparation professionnelle à travailler en équipe, la
persistance fréquente d’un esprit de rivalité et la solitude du
médecin contribuent largement à ce syndrome ( 3 8 ).
Enquête française, 1994
Dans le cadre de sa thèse de doctorat, A. Coulon, aidée dans son
travail par l’équipe de M. Filbet (Lyon), envoie 220 questionnaires
à des médecins travaillant en soins palliatifs en France, Suisse et
Belgique de langue française : 68 questionnaires sont renvoyés
( 3 1 %) dans un délai demandé de trois mois ( 1 2 ) . La moyenne
d’âge est de 42 ans et l’ancienneté de la pratique en soins pallia-
tifs est en moyenne de 6 ans, avec une formation spécifique faite
dans 52 % des cas – ce qui tendrait à prouver un choix “prémé-
dité” d’exercer en soins de confort. Soixante-trois pour cent des
personnes interrogées participent à un groupe de soutien, et un
psychiatre et/ou une psychologue travaillent dans l’équipe dans
73 % des cas. La part d’activité en soins palliatifs est de 61 % du
temps de travail en moyenne, et 28 % des praticiens interrogés
voudraient diminuer leur activité dans ce domaine. Le nombre
d’heures de travail par semaine est de 49,14 heures en moyenne,

VI E P R O F E S S I O N N E L L E
68
La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - n° 2 - mars-avril 2004
avec un minimum de 14 heures et un maximum de 84heures, ce
qui va ici dans le sens d’un surmenage certain ; 11 % des col-
lègues ont eu un arrêt de travail durant la dernière année écoulée,
et 18 % ont augmenté leur consommation d’alcool et de tabac
durant cette même année.
Les résultats de cette enquête permettent de constater des scores
élevés d’épuisement émotionnel, des scores faibles de dépersonna-
lisation et des scores moyens d’accomplissement, alors que s’occuper
de personnes en fin de vie semblerait a priori peu gratifiant.
Retenons encore quelques “leçons” de cette étude :
✓Les caractères démographiques n’ont aucune influence sur la
constitution du burn out, que ce soit l’âge, le sexe ou le nombre
d ’ e n f a n t s .
✓Le pourcentage élevé d’activité en soins palliatifs semble favo-
riser le syndrome d’épuisement, résultat qui confirme l’idée qu’il
est préférable de diversifier son activité professionnelle, l’inten-
tion de baisser son activité étant directement liée à cet épuise-
ment. En revanche, ancienneté d’exercice, formation spécifique à
la pratique de fin de vie, temps de travail hebdomadaire en tant
que tel n’ont pas d’incidence directe sur l’épuisement.
✓Les convictions personnelles religieuses ou philosophiques,
la présence d’un(e) psychologue ou psychiatre dans l’équipe, la
formation de l’équipe, les groupes de soutien ne protégeraient
pas de la survenue du burn out ! Reste à savoir comment se
déroulaient exactement ces groupes de parole.
✓ La prise de médicaments psychotropes et/ou l’augmentation
de la consommation d’alcool et de l’intoxication tabagique sont
corrélées à l’épuisement.
Considérée initialement comme un travail préliminaire devant
s’étendre de manière plus exhaustive en éliminant les biais de
l’enquête, cette excellente thèse n’a malheureusement pas été sui-
vie de travaux ultérieurs à l'échelle nationale pouvant être coor-
donnés ou demandés par la Société française d’accompagnement
et de soins palliatifs (SFAP).
Étude de Graham et Ramirez, 1995
Prévalence et causes du burn out parmi les médecins oncologues,
les radiothérapeutes et les médecins travaillant en soins palliatifs
sont analysées à travers une enquête nationale réalisée au
Royaume-Uni ( 3 9 ) . Tous les praticiens de ces différentes spéciali-
tés sont interrogés, soit 476 individus, mais seuls 393 d’entre eux
renvoient leurs questionnaires (83 %) : la répartition du taux de
participation suivant la spécialité est donnée dans le tableau I.
L’enquête comprend un MBI (4) et un questionnaire “psycholo-
gique de santé” qui correspond à douze items du GHQ (39).
Le constat est que, pour toutes les catégories de facteurs de stress,
les médecins de soins palliatifs sont en situation plus favorable : la
prévalence du syndrome d’épuisement chez eux s’avère moins
importante que chez les radiothérapeutes et équivalente à celle des
oncologues médicaux (tableau II), avec un score d’épuisement à
2 3 % et un score de satisfaction personnelle à 25 %. Un âge infé-
rieur à 55 ans serait plus fréquemment associé à l’épuisement et à
la dépersonnalisation, résultat qui irait à l’encontre d’une hypothèse
cumulative du stress dans la survenue du burn out. La vulnérabilité
de la population des jeunes médecins hospitaliers (42, 44) s e r a i t
liée à plusieurs facteurs, dont les lourdes charges horaires, les
contrats plus précaires, la moindre rémunération, les pressions
hiérarchiques, l’encadrement insuffisant ou trop contraignant.
Les facteurs de stress (tableau III), regroupés en quatre items, et
les facteurs de motivation (tableau IV) sont analysés avec soin.
Globalement, les médecins de soins palliatifs semblent moins vul-
nérables que leurs collègues cancérologues ; le stress des radiothé-
rapeutes est aggravé par la charge de travail (avec son retentisse-
ment sur la vie privée) et par le risque d’erreurs médicales ; les
responsabilités professionnelles et les conflits génèrent plus de
stress chez les oncologues médicaux.
Tableau II. Prévalence du burn out
(mesuré par le MBI) suivant la spécialité (39).
Différences significatives entre (valeur du p)
Oncologues Radiothérapeutes Médecins Radiothérapeutes Oncologues Radiothérapeutes
Facteurs médicaux de soins palliatifs et oncologues et médecins et médecins
de soins palliatifs de soins palliatifs
Nombre % Nombre % Nombre %
Épuisement 15 25 79 38 29 23 0,10 0,86 0,006
émotionnel
D é p e r s o n n a l i s a t i o n
9 15 64 31 16 13 0,03 0,81 0,0003
A c c o m p l i s s e m e n t 20 34 78 38 31 25 0,71 0,25 0,02
personnel
Tableau I.
Taux de réponse aux questionnaires (39).
Nombre Nombre Pourcentage
d’envois de réponses de réponses
Oncologues médicaux 69 60 87
Radiothérapeutes 253 207 82
Médecins de
soins palliatifs 154 126 82
Total 476 393 83
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%