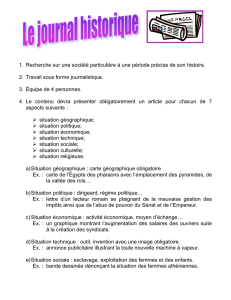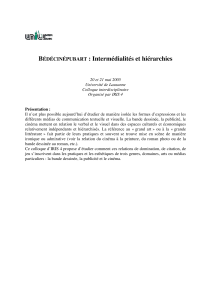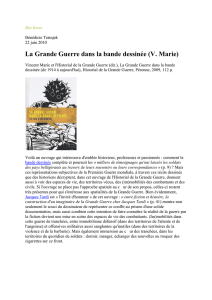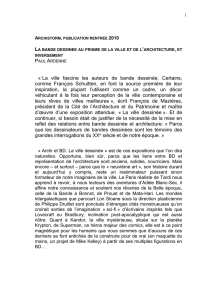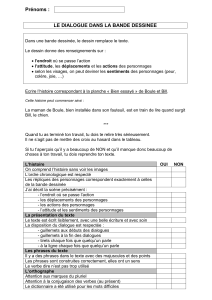théâtre - Neuvième Art

neuviemeart2.0 > dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée > théâtre
théâtre
par Thierry Groensteen
[Juin 2015]
Théâtre et bande dessinée ont une histoire commune qui remonte au XIXe siècle. Inventeur de la
littérature en estampes, Rodolphe Töpffer était aussi un auteur dramatique. Dans les mêmes années
qui le virent composer ses albums, il écrivit quelque huit pièces, des comédies jouées dans la pension
qu’il dirigeait à Genève, dans lesquelles il figurait lui-même en tant que comédien. Ses talents
d’acteur comique régalaient ses proches. On imagine qu’il se souvenait des moyens de produire tel
ou tel effet sur le public quand il dessinait ses personnages et inventait pour eux des saynètes
bouffonnes.
Dans son gros livre consacré à Gainsbourg, Joann Sfar rend compte de son travail avec les
comédiens : « c’est exactement du dessin, leur art : ne jamais chercher à faire joli mais traquer le
geste juste » (2009 : n.p.). Cette convergence est ancienne. À l’époque de Töpffer, peintres et
illustrateurs s’inspiraient de la tragédie, du mélodrame et de la pantomime pour animer leurs figures.
Les acteurs leur enseignaient comment exprimer les sentiments – ou, comme l’on disait à l’époque,
les « passions ». L’éloquence du corps apparaissait comme une science partagée par les acteurs et
par les faiseurs d’images. Des traités tels que l’Idée sur les gestes et l’action théâtrale, de J.J. Engel,
prescrivaient, gravures à l’appui, les postures et attitudes appropriées pour manifester visiblement les
mouvements qui agitent l’âme. Il est patent que Töpffer s’en inspira, sans se priver de grossir les
effets. Moins contraints par le vraisemblable, les acteurs de papier pouvaient parodier les acteurs de
chair.
Dans un autre ordre d’idées, la bande dessinée pré-cinématographique partageait avec les arts de
la scène le fait de représenter presque systématiquement ses personnages en pied. Les vues
rapprochées, les « gros plans » n’apparaîtront que plus tard, et ne se généraliseront que sous
l’influence du 7e Art. Longtemps, les personnages restèrent identifiés à des silhouettes complètes,
toujours observées à même distance, comme depuis un fauteuil dans une salle de spectacle.
Si un théâtre genevois pour enfants (situé avenue Eugène Pittard) porte aujourd’hui le nom de
Töpffer, les pièces de l’intéressé ne sont que rarement montées. J’ai connaissance d’une production,
dans ce lieu, des Aventures de Monsieur Coquemolle, en 1999 (reprise en 2007), dans une mise en
scène de Maurice Gabioud. En 2004, François Rochaix montait trois autres textes töpffériens au
Théâtre de Carouge : Les Quiproquo, Les Grimpions et Briolet ou le dernier voyage d’un bourgeois.
Le dessinateur Poussin signait les décors et costumes. Libération écrivit à cette occasion que Töpffer
représente « le chaînon manquant entre Molière et Courteline ou Labiche ».
Par ailleurs, les histoires dessinées de Töpffer n’ont pas été sans susciter quelques adaptations. Ainsi,
la Compagnie Caroline Gautier a monté en 1991 une comédie-ballet d’après Les Amours de

Monsieur Vieux Bois (avec l’Histoire de Monsieur Cryptogame en seconde partie). Ce spectacle était
né de la rencontre entre une chorégraphe, un peintre, un compositeur et un danseur. Auteure du
livret, Caroline Gautier déclarait : « Renonçant d’un commun accord à reproduire sur scène ce qui
se lit admirablement dans les albums de Töpffer, nous avons opté pour une forme de spectacle
résolument contemporaine où divers langages artistiques se superposent en conservant une relative
autonomie ».
En choisissant la forme de la comédie-ballet, elle renouait en quelque sorte avec une pratique qui
s’était développée très tôt en terre états-unienne. En effet, quelques-uns des personnages les plus
emblématiques des newspaper strips, à savoir Happy Hooligan, The Katzenjammer Kids, Buster
Brown, avaient vu dès avant 1905 leur existence prolongée sur les planches. Mais c’est bien la
comédie musicale qui se révéla le genre le plus apte à transposer efficacement les figures stylisées
des comics. Little Nemo triompha à Broadway, au New Amsterdam Theater, d’octobre 1908 à
janvier 1909, dans un spectacle au budget record de 100 000 dollars : vingt-deux rôles principaux,
cent cinquante choristes, et un nain pour interpréter le personnage titre. Le spectacle tint l’affiche
pendant quinze semaines avant de partir en tournée dans plusieurs grandes villes. D’autres
productions de musicals jalonneront la deuxième moitié du siècle, de Li’l Abner, d’après Al Capp, en
1957, jusqu’à Garfield, en 2011, en passant par Peanuts, en 1967 (You’re a Good Man, Charlie
Brown) puis 1975 (Snoopy : The musical), Annie, d’après le strip d’Harold Gray Little Orphan Annie, en
1977 (un succès qui tint l’affiche pendant près de six ans), et Doonesbury, d’après Gary Trudeau, en
1983. Plus inattendu : le récit autobiographique d’Alison Bechdel Fun Home (dont les thèmes
principaux sont le suicide, la relation père-fille et l’homosexualité) a lui aussi fait l’objet d’une
comédie musicale présentée off-Broadway de septembre 2013 à janvier 2014, au Public Theater. La
publicité pour le spectacle (favorablement accueilli par la critique) tirait argument du fait qu’il
s’agissait du premier musical ayant une lesbienne pour héroïne. Très satisfaite du résultat, Bechdel a
témoigné du fait que la représentation de son histoire familiale sur scène avait été pour elle une
expérience d’une intensité émotionnelle particulièrement forte.
En France, c’est dans le cadre d’un théâtre destiné à l’enfance que l’on vit des héros de bande
dessinée monter sur les planches. Le répertoire, constitué jusque-là de pièces inspirées des classiques

de la littérature enfantine, s’ouvrit aux personnages des illustrés sous l’impulsion de Pierre Humble, le
directeur du Théâtre du Petit Monde. Entre 1921 et 1940, quelque vingt-quatre spectacles furent
produits d’après Bicot, Mickey et Félix le chat, mais aussi les créations de Saint-Ogan (Zig et Puce,
Prosper), Pinchon (Bécassine, Frimousset), Christophe (Fenouillard, Cosinus, Camember), Rabier
(Gédéon), sans oublier André Daix et son Professeur Nimbus ‒ dont les strips ne visaient pourtant pas
particulièrement un public enfantin.
Tintin connut une première aventure scénique en 1941, avec la pièce Tintin aux Indes, le mystère du
diamant bleu, co-écrite par Hergé et Jacques Van Melkebeke dans le cadre du Théâtre de la
Jeunesse. Le rôle du jeune reporter avait été confié à une comédienne, Jeanne Rubens. La même
année, il y eut récidive avec Monsieur Boullock a disparu – pièce dans laquelle Tintin se rendait, pour
la première fois, au Tibet. Hergé ne semble pas avoir accordé une grande importance à ces
pochades. Beaucoup plus récemment, le Théâtre Am Stram Gram, de Genève, a adapté Les Bijoux
de la Castafiore, dans une mise en scène de Christiane Suter : une production très fidèle, impliquant
vingt comédiens et une marionnette pour figurer Milou.
Depuis quelques décennies, la bande dessinée ne nourrit pas seulement en sujets l’industrie
cinématographique, elle a aussi, de plus en plus, les faveurs du monde théâtral. Les dessinateurs
satiriques ont été les premiers à en bénéficier, sans doute parce que leurs œuvres reposaient
principalement sur les situations, le dialogue, qu’elles étaient en prise avec l’air du temps et
pouvaient se satisfaire de productions légères, ne nécessitant qu’une distribution réduite et peu de
décors – en un mot paraissaient proches de l’esprit du café-théâtre. Claude Confortes a adapté
Reiser (Vive les femmes) et Wolinski (Je ne veux pas mourir idiot, en 1968, puis Je ne pense qu’à ça et
Le Roi des cons), tandis que Lauzier était à l’affiche avec Le Garçon d’appartement, d’après ses
Tranches de vie. Les Bidochon, de Binet, Le Café de la plage, de Régis Franc, Carmen Cru, de
Lelong, ont aussi inspiré des spectacles, cependant que Jérôme Savary jetait son dévolu sur
Superdupont. La comédienne Michèle Bernier (fille du professeur Choron) a triomphé en 2003 avec
l’adaptation du Démon de midi, d’après l’album de Florence Cestac.
En 1987, le Centre d’Action Culturelle d’Angoulême commandait au Centre Dramatique National
pour l’Enfance et la Jeunesse La Pomme Verte un spectacle sur la bande dessinée, qui serait joué
pendant le festival. Françoise Pillet (texte) et Dominique Serreau (mise en scène) conçurent un
spectacle intitulé Le Pollen de la Place des Vosges – Paris IV et suggérèrent au jeune dessinateur
Sylvain Chomet de réaliser un album en « tirant un fil » d’après le « scénario » de la pièce. Il en
résultat l’album Le Secret des Libellules, édité par Futuropolis. Dans sa préface, Françoise Pillet
explique : « Théâtre et bande dessinée, un mariage hasardeux ! Pas question d’adapter un album au
théâtre : les dessins devenus décors s’empâteraient, s’alourdiraient, et les bulles sans dessin
crèveraient vite d’ennui. Alors, s’inspirant du rythme, des atmosphères, des plongeons dans
l’irrationnel, du découpage du temps qui passe, nous avons écrit et mis en scène un spectacle dont
le personnage central est le mystérieux tome III d’un album bande dessinée (sic). Un récit naviguant
d’une vignette à l’autre, rythmé par l’emprisonnement des personnages dans le faisceau des
projecteurs de théâtre. »

Les hommes et femmes de théâtre ne partagent pas tous ces réticences, puisque le registre des
bandes dessinées portées à la scène s’est considérablement élargi. Bien après deux des « romans
graphiques » les plus marquants des années (À suivre), Ici Même, de Tardi et Forest (monté au
Théâtre en Kit, de Nancy), et Silence, de Comès (adapté une première fois par une compagnie
liégeoise, puis, en France, par le Théâtre des Trois Gros), ce sont des œuvres aussi diverses que De
Cape et de crocs, d’Ayroles et Masbou (Cie Les Mille Chandelles), Quartier lointain, de Jirô Taniguchi
(Cie Super Trop Top, associée à la Comédie de Genève), Le Combat ordinaire, de Manu Larcenet
(Compagnie L’Outil de la ressemblance), Pourquoi j’ai tué Pierre, de Ka et Alfred (Cie
Transhumance), ou Le Chat du rabbin, de Joann Sfar (Cie La Fourmilière, encore une troupe
genevoise !), pour ne citer que celles-là, qui se sont, avec bonheur, incarnées sur la scène.
Little Nemo ayant gagné ses galons de classique par excellence, il a lui aussi fait retour, mais cette
fois à l’initiative d’une troupe de théâtre de rue, Les Plasticiens volants (Graulhet). Création
2014-2015, Little Nemo in Slumberland est un « voyage onirique » proposé sous la forme d’un
spectacle déambulatoire ou fixe. Autour de trois personnages principaux, Nemo, Flip et la princesse,
les rêves de l’enfant se matérialisent avec le concours d’un lit surdimensionné, de gonflables, de
volants, de comédiens, de marionnettes. Les tableaux se succèdent (l’iguanodon sylvestre, la
chenille humaine, le zeppelin fantastique, les framboisiers…) sans liens apparents entre eux.

Une manière originale et festive de diffuser l’imaginaire de la bande dessinée auprès d’un large
public ‒ même si l’on peut se demander ce que comprennent à ces différents tableaux les
personnes qui n’ont pas présentes à l’esprit les dessins qui les ont inspirés.
En sens inverse, l’intérêt des auteurs de bande dessinée pour la chose théâtrale est moins flagrant.
Même si un Lee Falk et un Jules Feiffer ont écrit pour la scène, le seul artiste depuis Töpffer qui se soit
pleinement investi à la fois dans la création graphique et dans l’art dramatique est sans doute
l’Argentin francophone Copi (1939-1987). Le dessinateur de La Femme assise a écrit et interprété une
quinzaine de spectacles, travaillant notamment avec Savary, Jorge Lavelli et Alfredo Arias. Le Belge
Philippe Geluck, de son côté, a mené une carrière d’acteur pendant une petite dizaine d’années,
avant de créer Le Chat. On sait moins que, dans les années vingt, George McManus interprétait lui-
même le rôle de Jiggs (Monsieur Illico) dans la pièce Father, tirée de son strip Bringing Up Father.
Les textes de théâtre sont beaucoup moins fréquemment adaptés en bande dessinée que les
romans. Le champion toute catégorie des dramaturges mis en cases est sans l’ombre d’un doute
William Shakespeare. Universel, le maître élisabéthain a inspiré des dessinateurs français (voir le
Macbeth de Philippe Marcelé et celui de Daniel Casanave), belge (Othello, de Denis Deprez)
allemand (Iago, de Ralf König, d’après Othello), italien (plusieurs albums de Gianni De Luca),
japonais (7 Shakespeares, d’Harold Sakuishi…), entre beaucoup d’autres, mais c’est évidemment
dans le monde anglo-saxon que les adaptations ont été les plus nombreuses, le plus souvent avec
des arrière-pensées didactiques. En terre britannique, Simon Greaves a créé la collection des
“Shakespeare Comic Books” en 1999, mais il avait été précédé et suivi de quantité d’autres
initiatives, dont la très honorable collection des “Cartoon Shakespeare Series” publiée par l’éditeur
britannique Oval Projects dans les années 1980, et quelque cinq volumes de la fameuse collection
américaine “Classics Illustrated” lancée en 1941.
Molière a été beaucoup moins bien servi. Et que dire du reste du répertoire ? Cyrano, Antigone,
Phèdre, Andromaque, Vladimir et Estragon et tant d’autres personnages attendent encore de se
réincarner sous un crayon inspiré. Quant aux auteurs contemporains (Grumberg, Vinaver, Koltès,
Gatti, Reza, Lagarce, pour ne citer que quelques francophones), ils semblent inconnus du monde de
la bande dessinée.
On retiendra tout de même quelques adaptations qui sont d’incontestables réussites : la version
d’Ubu roi donnée en 1970 par Franciszka Themerson, la Farce de maître Pathelin enluminée par
David Prudhomme (2006), ou bien encore Quelqu’un va venir, de Pierre Duba (2002), d’après Jon
Fosse.
Le scénariste Alain Ayroles se distingue par sa connaissance du théâtre classique, qui (à égalité
avec les récits de cape et d’épée et des éléments de fantasy) a nourri la série De Cape et de crocs,
créée en 1995 aux éditions Delcourt et dessinée par Masbou. Cyrano, Molière, Racine, Shakespeare
y sont cités ou convoqués tour à tour, mais, par-delà les références, l’écriture elle-même se veut
théâtrale. « C’est un récit d’aventures ouvertes (…) basé sur le théâtre, sur le principe de la
"Commedia dell’Arte". À savoir que j’ai un canevas, je connais les grandes lignes de l’histoire, mais
après, j’improvise. Si je vois traîner un sac et un bâton, par exemple, je vais m’en servir. Que ce soit
pour mettre quelqu’un dans le sac et le rouer de coups avec le bâton, ou bien le faire trébucher
avec le bâton et le frapper avec le sac... », expliquait Ayroles en 1997. Et de préciser ailleurs : « Ce
qui me sert de point d’ancrage quand j’écris, c’est que les protagonistes doivent toujours, même en
pleine fantasy, se comporter comme des personnages de théâtre. » Une pièce de théâtre en un
acte, Le Médecin imaginaire (parodie du répertoire classique), était d’ailleurs distribuée avec le
tome 4 de la série (Le Mystère de l’île étrange, 2000).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%