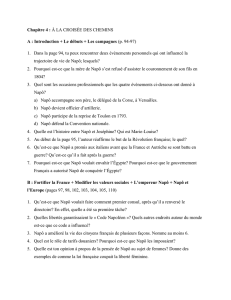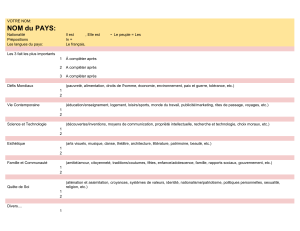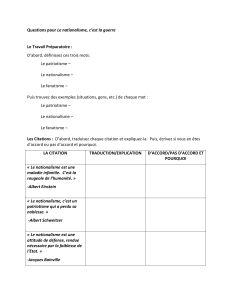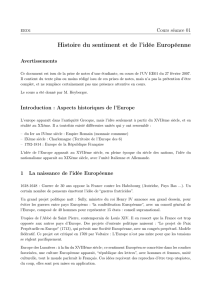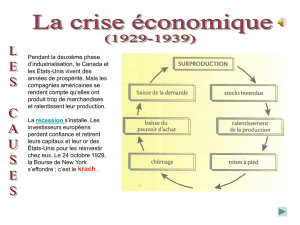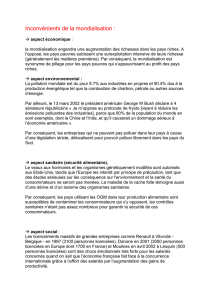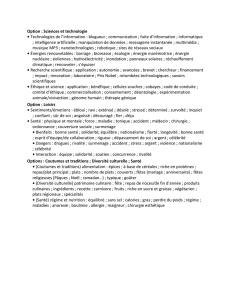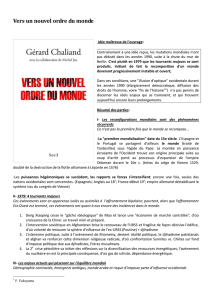Le nationalisme québécois dans une ère de surfusion

TEXTE A PARAITRE DES www.optimumonline.ca EN MARS 2011
Le nationalisme québécois dans une ère de surfusion
Gilles Paquet
www.gouvernance.ca
Février 2011
« Allons-y » + Ils ne bougent pas
Samuel Becket
(dernière réplique et prescription scénique dans En attendant Godot)
Introduction
Ceux qui comme Dominique Clift, pourtant un fin observateur de la scène québécoise,
voyaient monter, à la fin des années 1980, une nouvelle conscience au Québec, et se
consommer un certain étiolement du nationalisme de l’ethnie et de la langue
1
, n’avaient
peut-être pas complètement tort, mais ils surestimaient la vitesse avec laquelle allait se
faire à la fois le déclin des anciennes loyautés et l’épiphanie d’une sorte de patriotisme
constitutionnel à la Habermas. Au cours des quelques derniers 25 ans, le progrès dans ces
deux directions a été fort lent, et les cheminements surprenants.
Si, dans le discours public des dernières décennies, on a senti une dérive depuis la notion
tribale et ethnique de ‘nation’ vers un cadre nominalement plus inclusif et flou – ‘nation
civique’ est un marqueur vague de cette contrée incertaine
2
– aucun consensus ne semble
encore avoir émergé quant à la forme du nouveau nationalisme – culturel dira-t-on – en
train de prendre, non plus que dans quelle direction il va conduire le pays.
Cette dérive au niveau du discours – un certain adoucissement de la rhétorique
nationaliste incendiaire et une plus grande retenue dans la mise en scène des
psychodrames (sécession, crises linguistiques, crises référendaires) – ne signifie en rien
que le mouvement vers la séparation du Québec du reste du Canada a cessé. Il semble
plutôt que somnambulesquement il y a processus de séparation lente, tranquille, et
silencieuse – dérive effective vers une séparation tant dans les faits, dans l’administration,
dans les mots, que dans les esprits.
1
Dominique Clift, Le pays insoupçonné. Montréal : Libre Expression 1987.
2
Gérard Bouchard, La nation québécoise au futur et au passé. Montréal : VLB Éditeur 1999.

2
Il y a un combat de cosmologies. Les souverainisants cherchent à vendre aux citoyens
une cosmologie simple – le fédéralisme est un jeu à somme nulle (dans lequel tout ce que
l’un gagne l’autre le perd), et donc la collaboration entre le Québec et le reste du Canada
est un piège à cons. Il s’agit là d’une cosmologie étayée sur le recours sélectif à des
moments noirs de l’histoire et à des anecdotes, et confirmée à souhait par des médias
complaisants. La cosmologie confédérale de rechange est plus complexe : elle suggère
que le fédéralisme est un jeu à somme positive où tout le monde peut gagner si on arrive
à collaborer. Mais pour que la collaboration soit porteuse de fruits, il faut de l’affectio
societatis (l’engagement à travailler ferme au succès des partenariats) : c’est la condition
nécessaire à tout partenariat durable
3
. Cependant, une confédération, fondée sur le
pluralisme et sur le respect de l’intégrité des entités constituantes, réclame
continuellement tractations ardues et compromis. Voilà qui la rend très vulnérable à la
désaffection.
Une diète de débats harassants accompagnée d’une réflexion critique aurait pu contribuer
à créer au fil du temps une sorte de cohésion nouvelle (c’est la thèse Gauchet-Dubiel
défendue par Hirschman
4
) mais cela n’a pas été le cas. On peut donc penser que la
désaffection (alimentée par des tensions réelles mais infectées par des discours
intégristes) va continuer à faire son travail de corrosion, et que la séparation négociée à la
pièce (et censément chaque fois sans douleur véritable puisqu’accompagnée de transferts
de fonds fédéraux) va se traduire par une séparation tranquille qu’on ne sentira plus le
besoin de craindre ou de célébrer davantage que la fin d’une liaison. Y-aura-t-il
séparation politique formalisée, probablement déclenchée par des circonstances fortuites?
Ou d’autres circonstances fortuites vont-elles permettre de faire voir, derrière les
phénomènes de surface, un jeu à somme positive dans lequel il y aurait plus à gagner
qu’on l’avait cru
5
? L’un et l’autre scénario sont possibles.
Dans ce texte, on examine d’abord comment la notion de nationalisme a évolué sous
l’impact des grandes forces qui ont pénétré avec effraction dans les sociétés modernes, au
Québec comme ailleurs. Ensuite, on montre comment un nouveau nationalisme de
créances s’est cristallisé à la fois à cause de l’érosion du pouvoir de l’État-nation et du
grand relativisme moral qui a imbibé le Québec. Enfin, on propose certaines conjectures
quant à la direction dans laquelle nous entraîne le nouveau nationalisme – l’émergence,
au sein de la culture publique commune au Québec, d’un mélange de nationalisme
culturel et de cosmopolitisme intermédiaire qui pourrait tout aussi bien que non mener à
la souveraineté politique formelle – une souveraineté probablement accidentelle dans un
univers où la surfusion (naturelle et manufacturée) est telle qu’une transformation
dramatique peut être déclenchée par un changement ou un choc infiniment petit
6
.
3
Vincent Cuisinier, L’affectio societatis. Montpellier: LITEC 2008.
4
Albert O. Hirschman, A Propensity to Self-Subversion. Cambridge: Cambridge University Press 1995,
235ff.
5
Robert Wright, Nonzero. New York : Random House 2000.
6
Hubert Reeves a présenté ce principe physique de la surfusion en 1986 en choisissant l’exemple des
chevaux du lac de Ladoga. En 1942, des feux de forêt forcent 1000 chevaux à sauter dans le lac Ladoga
pour sauver leurs vies. Même si la température avait été très froide dans les derniers jours, le lac était
encore liquide. Mais pendant que les chevaux nageaient vers l’autre côté du lac, le lac soudainement gela.
Le lendemain, on retrouva les chevaux transformés en monuments de glace au centre du lac. L’explication

3
Évolution du nationalisme
L’après Seconde Guerre Mondiale a été marqué par de grands mouvements sociaux qui
ont transformé la face du monde. La baisse dramatique des barrières tarifaires et la
montée du commerce international, l’érosion des frontières, et la déterritorialisation et la
dénationalisation de la production ont été suivies par une globalisation de la finance.
Cette trans-nationalisation de l’économie a été accompagnée d’une cosmopolitanisation
de la société à cause des grands mouvements migratoires, et ces courants ont contribué à
une banalisation du nationalisme
7
. On en est venu, dans bien des milieux, à considérer les
identités collectives et les communautés imaginaires comme de simples construits
inventés, et à prendre des distances par rapport à l’ancien essentialisme basé sur l’ethnie,
le genre, les classes ou les traditions culturelles
8
.
Cela n’a pas nécessairement ou également anémié les ferveurs nationalistes partout. En
fait, loin d’annihiler le nationalisme, dans certains lieux, ces développements ont
enclenché une résurgence du sentiment national sous des formes inédites. C’est donc
paradoxalement une combinaison de post-modernisme et de relativisme moral, pour une
part, et de fondamentalisme et d’intégrisme à saveur parfois nationale, pour une autre part
– qui s’en est suivie.
Cette combinaison a surpris et inquiété. Les représentations et théorisations ont eu
tendance à éviter de la prendre en compte, et ont plutôt cherché un campement aux
marges de cette zone contestée : soit en cherchant à occulter ou à désacraliser les notions
de nation et de nationalisme, soit en cherchant au contraire à les sacraliser en tant que
références symboliques ncontournables à la communauté de base.
Dans ces débats autour du nationalisme, Isaiah Berlin et Joseph Raz occupent une
position assez particulière. Ils ne croient pas que la gouverne de nos sociétés puisse se
construire strictement sur des principes abstraits et des règles générales, et donc ne
répudient pas le sentiment national comme si c’était une pathologie, ainsi que le font les
libéraux purs et durs. Mais ils se distinguent également des communautariens qui voient
l’individu totalement et radicalement encastré dans son cadre communautaire
9
. Il s’en suit
que, pour Berlin et Raz, le nationalisme n’est ni aussi inimportant ni aussi important que
pour leurs collègues plus radicaux.
de Reeves est que quand la chute de température est trop rapide, l’eau n’a pas le temps de geler et reste
liquide à une température plus basse que zéro. Mais l’eau est instable, et il faut seulement un petit choc
pour que le processus de cristallisation en glace se fasse instantanément (Hubert Reeves, L’art de s’enivrer.
Paris : Le Seuil 1986). Hervé Sérieyx a appliqué le concept et l’exemple au monde des organisations (Le
Big Bang des organisations. Paris : Calmann-Lévy 1993). En état de surfusion, une société peut se
cristalliser brutalement en une nouvelle forme sous le coup de la plus petite contingence.
7
Michael Billig, Banal Nationalism. London: Sage 1995.
8
Ulrich Beck, “The Cosmopolitan Society and its Enemies” Theory, Culture & Society, 19(1-2) 2002, 37.
9
John Gray, Berlin. London : Fontana Press 1995, 99-102.

4
Confrontés à la définition du nationalisme de Gellner – comme une idéologie qui définit
la similarité culturelle comme le lien social de base
10
– Berlin et Raz adoptent une
position nuancée. Il s’agit d’un lien incontournable et pas facilement déracinable,
affirment-ils, mais un lien parmi d’autres qui se disputent la gouverne de l’individu en
tant que membre de nombreuses communautés dont aucun n’a un ascendant total,
permanent et complet sur lui. Pour Berlin et Raz, le pluralisme des valeurs est la réalité
dominante, ce qui fait que leur libéralisme est agonistique et source de tension continue:
en conséquence, Berlin et Raz ont été accusés de péché relativiste par les
communautariens, et de péché communautariste par les libéraux radicaux.
Dans les faits, la mondialisation, le malaxage croissant des populations, et l’érosion du
pouvoir des États-nations ont fait que beaucoup des grands problèmes semblent
maintenant requérir des solutions trans-nationales, et nécessiter des systèmes associatifs,
confédératifs ou méta-nationaux
11
. Ces forces à la fois dévaluent l’importance relative de
la similarité culturelle dans l’équation de la gouverne à proportion que cette similarité
tend à s’atténuer, mais aussi à en exhausser l’importance dans l’esprit de ceux qui veulent
préserver à tous prix cette identité. En parallèle, même si l’État-nation a été l’une des
formes organisationnelles qui ont le mieux réussi à assurer à la fois l’intégrité, la
coordination et la mobilisation nécessaires pour le vivre-ensemble, et que le lien à l’État
est au cœur même du nationalisme, ce lien de la nation à l’État s’est forcément atténué.
S’il est difficile de purger toute notion de nation d’un brin d’ethnicité, et toute notion
d’État-nation d’une connotation technocratique, dès qu’on permet aux notions de nation,
État et ethnie de se distendre (en parlant d’ethnicité symbolique, par exemple), les
fondements identitaires tendent à devenir bien abstraits, et on peut se demander s’ils
suffiront pour fonder des solidarités. Ce qui plus est, on peut se demander si l’État laissé
à lui-même est désormais vraiment capable de proposer autre chose que des promesses
vides. De là, on ne saurait que conclure qu’il existe bien des raisons pour ne pas trop
compter sur des épiphanies si l’État québécois devenait ‘totalement’ politiquement
souverain
12
.
La dérive d’un nationalisme étato-centrique à saveur ethnique vers une sorte de
patriotisme constitutionnel est perceptible, encore qu’on hésite à le dire ouvertement.
Pourquoi? Parce que le principe nationaliste (pour garder son allure de ‘théorie
universelle naturelle et nécessaire’) doit rester associé à la fois à la culture commune en
tant que ciment social de base, et à l’État qui lui correspond – un État qui doit exister
obligatoirement et donc est considéré seulement comme en dormition s’il n’existe pas ou
ne donne aucun signe d’existence tangible
13
.
10
Ernest Gellner, Nationalism. London : Weidenfeld & Nicolson 1997.
11
Edgar Morin, “L’État-Nation” in Gil Delannoy, Pierre-André Taguieff (sld) Théories du nationalisme.
Paris : Éditions Kimé, 1991, 319-324.
12
Même la carte linguistique qui pouvait mettre le feu aux poudres instantanément est condamnée à
devenir moins allumeuse à proportion que le pluralisme linguistique s’accroît, et que des écoles de
commerce comme celles des HEC ou de Laval offrent leurs cours en trois langues (français, anglais et
espagnol) parce qu’il y a évidemment un marché en croissance pour le plurilinguisme.
13
Ernest Gellner, op.cit. ch. 2

5
Ceux qui, comme Elie Kedourie
14
, proposent que le nationalisme est strictement un
accident contingent et non pas un phénomène universel et nécessaire, n’en nient pas pour
autant l’importance, mais attribuent le nationalisme et son coefficient d’émotion bien
davantage à des conditions sociales porteuses qu’à des forces qui joueraient
inconditionnellement partout et toujours
15
.
Nécessaire ou contingent, le sentiment national ne peut que s’effilocher à partir du
moment où ses assises et ses références sont moins profondément ancrées, où
l’affiliation nationale est moins robuste, et où le lien à un État de moins en moins
puissant devient de plus en plus ténu. Voilà qui semble être la grande tendance – une
tendance que peuvent moduler grandement les conditions sociales qui prévalent d’un
pays à l’autre, d’un moment à l’autre. Voilà qui n’a pas empêché certains théoriciens
aventureux de proposer des critères généraux qui pourraient justifier le passage du
nationalisme à l’auto-détermination et l’indépendance politique
16
.
Au Québec, après des périodes de nationalisme ethnique de ressentiment fortement ancré
dans des histoires de conquête, le nationalisme s’est quelque peu modifié en nationalisme
de la langue, avant de se transformer plus ou moins en nationalisme de projet politique
fondé sur les créances – mélange d’utopie juridique et socio-économique qui viserait à
prétendre protéger les nationaux des aléas engendrés par le reste du monde et à leur
conférer un grand nombre de droits et donc de prébendes. En parallèle, s’est développée,
au Québec comme ailleurs, une forme davantage symbolique et douce du nationalisme
qui tend à occuper le centre de la scène
17
: un nationalisme culturel qui fleurit sur
l’émergence d’une culture publique commune dans un échiquier pluriethnique – « une
culture métissée » – exactement ce à quoi certains sont tellement réfractaires
18
.
Si cette dérive est avérée, voilà qui permet un pari non point sur des principes arrêtés
d’avance mais sur des pratiques en évolution : il semble qu’on ne sache pas où on va
aboutir, mais qu’on accepte de construire sur des accords incomplètement théorisés
(comme dirait Cass Sunstein
19
) qui nous entraînent vers un cosmopolitisme intermédiaire
ancré dans des obligations envers les autres, mais des obligations qui peuvent être
graduées selon la ‘proximité’ de l’Autre, mais aussi sur une capacité à apprendre de lui –
un cosmopolitisme intermédiaire qui laisse place à tout un éventail de relations plus ou
moins minces ou épaisses
20
y compris diverses formes de nationalisme.
14
Elie Kedourie, Nationalism. Oxford: Blackwell 1993.
15
Il est intéressant de noter que le romancier-essayiste Daniel Poliquin utilise le même langage dans son
livre Le Roman colonial (Montréal : Boréal 2000) quand il distingue nationalité et citoyenneté -- que les
nationalistes veulent fusionner – « la nation est contingente, elle pèse moins lourd que ma citoyenneté »
(p.250).
16
Joseph Raz, Avishai Margalit, « National Self-determination » The Journal of Philosophy 87 (9) 1990,
439-461.
17
Liav Orgad « ‘Cultural Defence’ of Nations : Cultural Citizenship in France, Germany and the
Netherlands” European Law Journal 15 (6) 2009, 719-737.
18
Fernand Dumont, Raisons communes. Montréal: Boréal 1995, 67.
19
Cass R. Sunstein “Incompletely Theorized Agreements” Harvard Law Review, 108, 1995, 1733-1772.
20
Thomas W. Pogge, “Cosmopolitanism: A Defence” Critical Review of International Social and Political
Philosophy 5 (3) 2002 86-91; K Anthony Appiah, Cosmopolitanism. New York: Norton 2006.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%