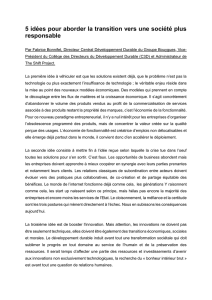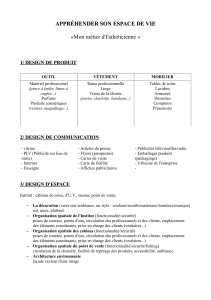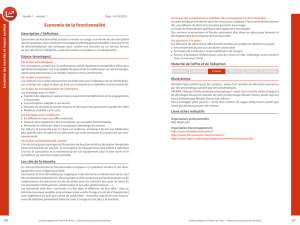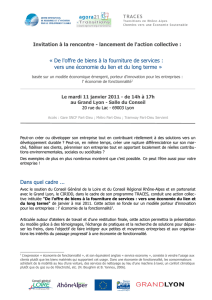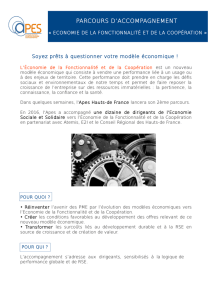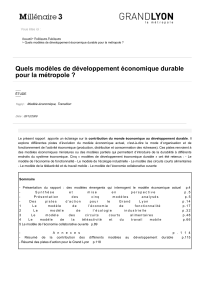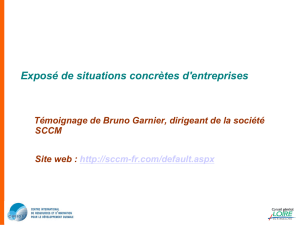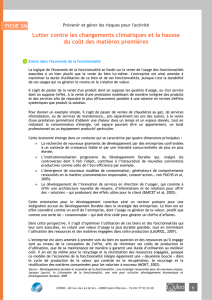Télécharger - Club économie de la fonctionnalité

1
Cette réunion a débuté par un long tour de table qui a permis de préciser dans quels
types de projets les individus présents sont engagés, tant du côté des acteurs du monde socio-
économique que des chercheurs. Ce long tour de table témoigne de la dynamique dans
laquelle se trouve le Club actuellement : après avoir exploré (même si beaucoup reste à
faire !) le modèle de l’économie de la fonctionnalité, après avoir tenté d’en saisir les
ramifications, les réunions du Club sont désormais davantage axées autour de projets qui se
réalisent en prenant appui, notamment, sur le Club. Ces projets peuvent aussi en partie utiliser
le modèle de la fonctionnalité comme inspiration.
Dans ce cadre, trois thématiques ont structuré les discussions. Une dernière (sur la
monétisation du développement durable, notamment s’agissant de la taxe _ en débat_
carbone) a juste été pointée et mériterait à notre sens une séance ad hoc. Cette thématique ne
sera pas abordée ici.
1. Conférence JADDE et Club Economie de la Fonctionnalité : quelle
parenté ? quelle volonté ?
La conférence JADDE réunit chaque année, dans la région Nord Pas de Calais, des acteurs
d’entreprise et territoriaux, sous l’impulsion de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Grand Nord. La parenté, telle que l’a avancée Christian Du Tertre, entre cette initiative
récurrente et le Club EF et DD repose sur deux aspects, qui sont cruciaux nous semble-t-il
dans la réflexion des entreprises présentes dans le Club :
- Volonté de penser de pair économie et développement durable, en mettant l’accent sur
l’idée que le développement durable est une opportunité de développement
économique.
- Réfléchir à l’émergence et la mise en œuvre de modèles économiques, sous appui
institutionnel, qui permettent l’articulation entre économie et développement durable.
Ce rappel étant fait, ce pari, cette tentative d’articuler dynamique économique et
développement durable ne va pas sans des difficultés considérables, qui font écho à la manière
ELEMENTS DE COMPTE RENDU REUNION DU
CLUB
« ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE », 15 OCTOBRE 2008

2
dont le développement durable se propage dans le monde de l’entreprise ou le monde
politique :
- Difficile généralisation de réussites locales ou ponctuelles, difficile transfert des
savoirs acquis lors d’une expérience en vue de sa réédition, de sa transplantation, de sa
répétition. Cela rappelle les limites du Knowledge management (management de la
connaissance) et de ses outils informatiques, identifiées dans plusieurs travaux de
recherche.
- Difficulté d’aller au-delà de l’évènement, de la rencontre, parfois de l’effet de
communication (au sens péjoratif du terme), de rendre concrets, acceptables des
intentions et des délibérations (pensons au Grenelle de l’Environnement sur le volet
des OGM et de la taxe carbone par exemple), de dépasser le stade de la « foire aux
bonnes idées » ou des « bonnes pratiques ».
La dynamique impulsée par les journées JADDE oblige à modifier le regard qui a auparavant
prédominé, au sein du Club, sur l’économie de la fonctionnalité et plus précisément sur le rôle
ainsi que la nature des entreprises. En effet, dès lors que l’émergence d’une fonction/solution,
par agrégation vertueuse de plusieurs acteurs, est initiée par l’échelon territorial, l’entreprise
ne se borne plus à être une unité de création de valeur. Elle devient (deviennent) un agent
d’agrégation, un vecteur de mutualisation, une exploratrice de ressources souvent
inexploitées. En somme, elle crée une valeur qui ne serait pas uniquement productive ou
monétaire et qui contribuerait à un développement qui la dépasserait très largement.
Enfin, nous voudrions conclure cette partie sur un point critique : dès lors que des évènements
sont organisés autour du développement durable, l’usage du terme « durable » est pléthorique
et désordonné, si bien que l’on ne sait parfois plus quel sens lui attribuer. Son sens peut même
être parfois dévoyé. Par exemple, une « nouvelle croissance durable » servirait-elle à
augmenter durablement les bénéfices d’entreprise mais au-delà, quelle est la signification de
cette expression ? Autrement dit, le terme « durable » est susceptible d’être pris dans un effet
de mode, comme pour ne plus s’interroger sur les activités auxquelles on l’accole (acheter,
vendre, entreprendre…). De plus, l’effet de mode, avec son évanescence, son effervescence,
son absence de cristallisation, est par définition antagonique avec l’adjectif « durable » et la
durabilité des produits/services, qui est précisément un point clé de l’économie de la
fonctionnalité.
2. De la spatialisation à la territorialisation des actions de l’entreprise
Ce développement est toujours lié aux discussions ayant eu lieu autour des journées JADDE.
Il est intéressant de noter que lorsque la question du territoire est abordée auprès des
entreprises, ou plutôt de sa possible valorisation par des entreprises, la réaction, presque
unanime est « On le fait déjà ». Cette réaction est compréhensible. Des grandes firmes comme
la Poste ou EDF sont ancrées, implantées dans les territoires, y sont des acteurs importants (au
premier chef en terme d’emploi). Or, la logique intellectuelle envisagée lors de cette réunion
est quelque peu différente que la simple localisation, que la simple (et commune)
spatialisation de l’action des entreprises. Il est possible, par opposition et par hypothèse, de
nommer cette logique « territorialisation ». Cela appelle à la discussion mais il y a un
décalage, semble-t-il, entre l’appréhension du territoire comme un niveau d’action, comme un
réceptacle d’actions, contingent, et l’appréhension du territoire comme un gisement potentiel
de ressources. En effet, dans le second cas, le territoire pourra, peut être, être davantage pris
en charge dans sa spécificité, avec ses qualités et lacunes et dans une optique partenariale

3
« forte ». Dans la première configuration (la spatialisation), le raisonnement a pour appui un
maillage plus général, le territoire envisagé est un point parmi d’autres et des effets
démultiplicateurs possibles, dans le territoire même, ne sont pas nécessairement pensés. La
logique partenariale engagée est aussi plus « faible ».
Même si cette distinction (spatialisation/territorialisation) est éminemment exploratoire, elle
peut être un repère, une balise, dans des discussions en interne des entreprises du Club, afin de
témoigner de l’angle de vue retenu dans la manière de s’emparer de la dimension territoriale.
En effet, les discussions au sein du Club font certainement écho à des débats internes au sein
des entreprises partenaires, et si le produit des discussions peut représenter des ressources
langagières, nous (les chercheurs) en serions satisfaits !
Dernier élément, mis en avant par F. Hubault, le rôle du territoire dans la dynamique
économique est comparable au rôle du travail réel dans l’analyse de l’activité. Pour tenter de
le dire simplement, le travail réel n’est pas le résidu du travail prescrit et il ne faut pas
s’arrêter au caractère irréductible du décalage entre travail réel et travail prescrit. Le travail
réel est tout simplement ce qui rend le travail possible ! De la même façon, l’échelon
territorial, par hypothèse, n’est pas juste un échelon correctif, d’ajustement, d’adaptation, de
décisions prises à des niveaux supérieurs : il rend incarnées des dispositions, par exemple en
matière de développement durable, il rend possible des transformations et du développement.
3. Mobilité et économie de la fonctionnalité
Ce thème est immédiatement « parlant » et fait écho à l’économie de la fonctionnalité. Pour
quelles raisons ?
- Parce que la mobilité concerne toutes sortes d’acteurs (entreprises, collectivités, clients,
salariés).
- Parce que les effets pervers ou les externalités engendrées par des mesures concernant la
mobilité sont immédiatement visibles.
- Parce qu’un des cas ayant alimenté le modèle de l’économie de la fonctionnalité concerne la
mobilité (Michelin).
- Parce que l’intermodalité (utilisation successive de plusieurs modes de transports) est
typique de la construction sociale et économique d’une « fonction » (ou plutôt d’une
« solution »).
Lors de la réunion, il a été question du projet à l’étude dans la région Acquitaine à l’initiative
de S. Cazenave (La Poste). Nous ne reviendrons pas ici sur les termes du projet mais
évoquerons quatre de ses aspects recoupant les réflexions au sein du Club :
- Le modèle de l’économie de la fonctionnalité, parmi évidemment d’autres facteurs,
peut inspirer une manière de faire, de s’y prendre, de tenter d’établir une communauté
de pensée et d’action autour de son projet (cf journée sur la mobilité avec les
correspondants « métiers » de la Poste).
- La sélection du thème de la mobilité n’est pas survenue in abstracto, il provient d’une
analyse de la spécificité du territoire et de la pertinence, a priori, de proposer une
« solution » de mobilité, au sujet de laquelle la Poste serait en première ligne.
- L’entrée par le modèle l’économie de la fonctionnalité implique une mise de côté, au
moins dans un premier temps, du critère de rentabilité du projet mené. L’angle est
celui, plus large, du développement d’un territoire, du pari de générer des externalités

4
positives, dont pourra également bénéficier économiquement l’acteur qui initie le
mouvement et/ou le coordonne.
- Du coup, on voit poindre de nouveaux critères d’évaluation (attractivité supérieure
d’un territoire, filialisation d’une activité, comme récemment, visiblement, avec l’éco-
conduite à la Poste…).
1
/
4
100%