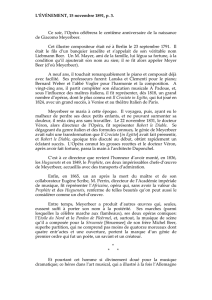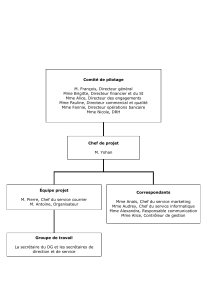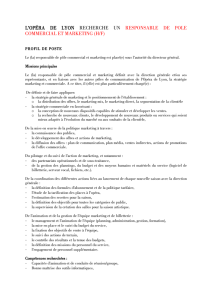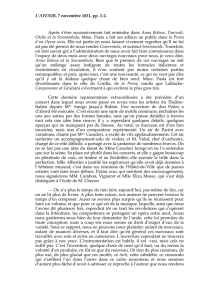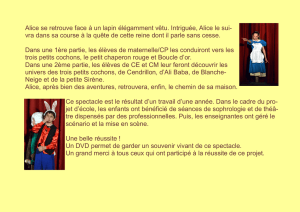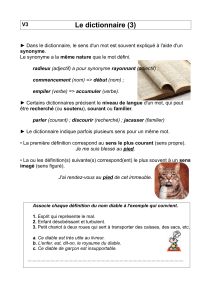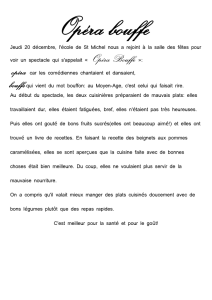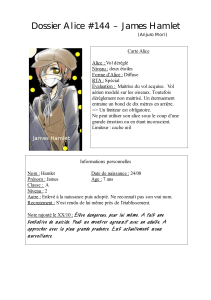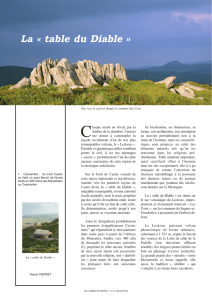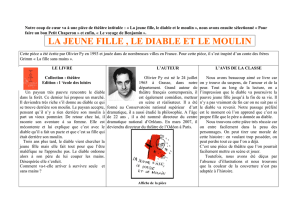- SAS

COURRIERDEL’EUROPE,5décembre1831,pp.1‐2.
J’aitâché,dansunpremierarticle,derendrecomptedes
impressionsquim’avaitlaisséeslapremièrereprésentationdeRobert‐le‐
Diable.Cesimpressionsétaientvaguesetconfuses,maisprofondes.Jen’ai
pascherchéàmettredel’ordredansmesidées,j’aivoulufairepartager
mesémotions.Depuislors,ilnem’apasétépermisderevenirsurun
ouvragequimanqueraàluiseulunépoquedel’art;etjecrainsque
l’espacequim’estaccordéaujourd’huinesuffisepasàuneanalysetelle
quejeladésirerais.Essayonscependant.
Inutiledeparlerdupoèmeetdefaireconnaîtredanssesdétailsque
MM.ScribeetG.Delavigneontimaginéed’aprèslachroniquedeRobert‐
le‐Diable,ducdeNormandie.Onsaitassezquelestlesujetdel’opéra,
aprèscinqreprésentations,etlorsquetouslesjournauxl’ontfidèlement
reproduit.Leslecteursn’ignorentplusqueleducdeNormandie,aime
Isabelle,princessedeSicile;qu’ilsetrouvesouslepatronagedeBertram,
hommeinfernal,qui,aprèsluiavoirfaitperdresafortuneaujeuetdans
lesplaisirs,luioffrelemoyend’obtenirlamaindelaprincesse.Ilfaut
pourcelaqueRobertmontredelarésolutionetducœur,qu’ildescende
danslecloîtredel’abbaye,et,qu’aprèsqueBertramauraévoquélesames
detouteslesreligieusesdontonvoitlestombeaux,Roberts’empared’un
rameauquiombrageletombeaudeSainteRosalie.Roberthésiteetse
décideenfin,maisaumomentoùilarrachelerameauilcroitconnaîtresur
levisagedeladéfuntelestraitsdesamèreencourroux.Néanmoinsilest
possesseurdecetalismanaumoyenduquelilserendchezlaprincesse.
Dominéeparcecharme,Isabelledemandegrâcepoursonhonneur,grâce
pourRobertlui‐même,quiserendcoupabledevantleciel.Robertselaisse
attendrir,ilbriselerameau,etperdainsisontalisman.Lesgensdela
princessesortentdeleurenchantement;onreconnaîtRobert,oule
poursuit,ilvientseréfugiersouslevestibuledelacathédraledePalerme,
lieud’asilepourlescondamnés.Bertraml’yjointbientôt.Iln’aplus
qu’uneressourcepourluifaireépouserIsabelle,ill’emploiera,maisilfaut
queRobertconsenteàluiengagersonamepourl’éternité.C’estalorsque
BertramrévèleàRobertl’affreuxmystèredesanaissance.Bertramaété
l’amant,l’épouxdesainteRosalie,mèredeRobert;ilestsonpère,ilest
damné.Robertdoit,enbonfils,nepasabandonnersonpèreetluitenir
compagniedurantl’éternité.Robertestsurlepointd’accepter,quand
Alice,messagèredelasainte,arriveetprésenteàRobertletestamentdesa
mère,danslequelellel’exhorteàfuirlesconseilsdeBertram.Robert
balancequelquesinstants,puisilsedécidepourAlice.Bertramretombe
dansl’enfer;lagrandeportedelacathédraledePalermes’ouvre,Robert
vajoindresavoixauxvoixdutemple,etprendplaceàcôtédelaprincesse
deSicile.
Voilàenrésumélesujetdupoème.Cecourtexposésuffitpour
démontrerquelelibrettonemanquepasdesituationfortesetdramatiques,
etoffreenmêmetempsunchampvasteaucompositeur,qui,dela
peinturedescènesinfernalesetdelaféeriedelamort,passeauxchants
religieuxdutemple,etréunitainsidansunmêmetableaulecontrastede
couleursopposées,d’inspirationsdifférents.Maislaprésenceàpeuprès
constantedeBertramsurlascène,enobligeantlemusicienàrevenirsans
cesseauxmêmeseffets,semblaitparcelamêmedevoirexclurelavariété,

COURRIERDEL’EUROPE,5décembre1831,pp.1‐2.
qualitéindispensablepartout,etsurtoutdansunouvragedelalongueur
decelui‐ci.AussilepremièreméritedeM.Meyerbeerestd’avoirtriomphé
decettedifficulté,etd’avoirévitélamonotoniedecouleursetlasimilitude
destylesauxquellesunemainmoinsexpérimentéeauraitétécondamnée.
Lepremieracteestunenchaînementmerveilleuxdechœurs,de
scènes,deballades,dechantschevaleresquesoupopulaires.Jeneconnais
pasd’opéraoùlerécitatifsoitmieuxcoupé,plusvarié,plusdramatique
quedansRobert‐le‐Diable.Jenereviendraipassurlesecondacte,dontj’ai
déjàparlédansmonpremierarticle,sicen’estpourfaireobserver,qu’il
renferme,commelepremier,certainesréminiscencesqu’onne
remarqueraitpasailleurs,maisquiblessentici,parlaraisonqu’unetache,
mêmelapluslégère,estd’autantplusremarquéequ’elleestsurunplus
richevêtement.Simessouvenirsnemetrompentpas,c’estdansle
troisièmeactequesetrouveunephrasequirappelleunpeutropcrûment
lastrettedufinaledeFidelio.Enfin,puisquejesuisnetraindecritiquer,je
diraiquel’ensembleduduod’IsabelleetdeRobert,audeuxièmeacte,ne
mesembleplussatisfaisant.Lesmotsquicomposentlastrophe:Moncœur
s’élanceetpalpite,sontcroisésd’unemanièredureetdésagréable.Parcette
franchise,jecroisdonneràM.Meyerbeerunepreuvedeplusdela
confiancequej’aidanssontalent.Apartirdutroisièmeacte,jenetrouve
plusriendefaibledanssapartition,etj’yrencontresouventdesublimes
beautés,soitinstrumentales,soitdramatiques,tantôtd’unstylesévèreet
religieux,tantôtdel’effetlepluspittoresque.
Lechœurdesdémons:
Noirsdémons,fantômes,
Oublionslescieux;
Dessombresroyaumes
Célébronslesjeux
estterrible.Toutlemondeenaétéfrappé.Maiscequiestmoins
remarqué,estcettedominantetenuesurunrhythmeàtroistempssurces
paroles:
Gloireaumaîtrequinousguide;
Aladansequ’ilpréside.
//2//Lescoupletsd’Alicesontd’uneinstrumentationaussineuve
quevariée.M.Meyerbeersegardebienderépéterlemême
accompagnementsurlesdiversesstrophes.Chacuned’ellesestpourainsi
direunsujetinconnudanslequelilfaitjaillir,surlamêmemélodie,des
faisceauxnouveauxd’harmonie.Leduod’AliceetdeBertramestsans
contreditundesmorceauxlesplusbeauxdel’Opéra.Lebassondialogue
aveclesvoix,funèbreavecBertrand,gracieuxavecAlice.Levasseurjoue
etchanteavecunegrandeintelligence.Sonaccentdevientsardonique
lorsqu’ils’écrie:Triomphequej’aime!etilyaquelquechosedesépulcral
danssavoixlorsqueengageantAliceàsetaire,ill’épouvanteparce
derniermot:Tais‐toi,sinonlamort!

COURRIERDEL’EUROPE,5décembre1831,pp.1‐2.
Aprèsceduoterrible,rienn’estplusdélicieuxqueletriosans
accompagnementquisuit.PuisvientleduodeRobertetdeBertram,où
l’élanchevaleresquesemêleàtouteslessuggestionsinfernales.Riende
plusmajestueusementdiaboliquequecesgammeslargesetmartelées
soutenuesdelavoixdestrombones,lorsqueBertramindiquéàRobertle
talismanredouté.Lafindecetacteestconsacréàdesévocations,des
apparitions,desfantasmagoriesfunèbres,oùlemusiciens’estmontré
peintreetpoètetoutàlafois.
Maisc’estsurtoutdanslesquatrièmeetcinquièmeactesquele
compositeurs’estélevéauplushautdegréd’expressiondramatique.Le
duod’IsabelleetdeRobert,lefinalequisuit,lechœurd’ermitesà
l’unisson,l’airdeBertrametletriosublimequiterminel’opérasontautant
demorceauxdupremierordre,danslesquelstouslesgenresdebeautés
sonttellementprodiguésqu’ilvautmieuxlessignalerqued’en
entreprendrel’énumération.
Ajoutonsenfinissant,queM.Meyerbeerestleseulcompositeurde
nosjoursquiaitcompriscombienestpuissanteetfécondel’inspiration
chrétienne.Riendeplusbeaudansl’opéradeRobert‐le‐Diablequece
contrastedeschantsdramatiquesetduplein‐chant,quecesoppositionsde
l’orgueetdel’orchestre.Voilàunesourceàlaquelleilfautallerpuisersur
lestracesdeM.Meyerbeer,etc’estpourcetteraisonquesonouvrage,
n’eût‐ilquecegenredemérite,devraitêtreencoreconsidérécommeunde
cesjalonsplacésenavantdelacarrièreetdesprogrèsdel’art.Maisoutre
lesgrandesbeautésdedétailqu’ilrenferme,ilenaunautreànosyeux,
c’estdesortirdecesystèmed’imitationetd’école,quiseformetoujoursà
l’apparitiondecespuissantsgéniesquiimprimentàl’artungrand
mouvement.Dansnotrepremierarticle,nousavionsditqueRobert‐le‐
Diabledevaitporteruncoupmortelauxformesrossiniennes.Quelques
personnessesontàtortimaginéquenousvoulionsfaireentendreque
l’auteurdeRobert‐le‐Diabledevaitdétrônerl’auteurd’Otello.Rienn’est
plusloindenotrepensée,etnoussommesbienaisedetrouverl’occasion
denousexpliquernettement.
Ilseformetoujoursautourd’ungrandhommeunessaimde
médiocritésqui,seformulantsurlui,lesingenttellement,lereproduisent
tellementsousunaspectridicule,qu’ilspeuventenêtreconsidéréscomme
lacaricature.Or,lesformesrossiniennesnesont,suivantnous,quela
parodiedesformespropresàRossini.Carc’estencoreunerusedel’école
d’usurperlenomdeceluiqu’elleinsulteenlefaisantainsigrimacer.Mais
Rossinilui‐mêmearompuavecsesformesdansGuillaumeTell.ADieune
plaisequenousayonsjamaisdésirévoirtomberlesouvragesdecegénie
fécond,quialimentepresqu’àluiseulnotrescèneitalienne,pourla
prospéritédelaquellenousferonstoujoursdesvœux!

COURRIERDEL’EUROPE,5décembre1831,pp.1‐2.
JournalTitle:COURRIERDEL’EUROPE
JournalSubtitle:None
DayofWeek:lundi
CalendarDate:5DÉCEMBRE1831
PrintedDateCorrect:Yes
Issue:ANNÉE1831–No306
Pagination:
1à2
TitleofArticle:ACADÉMIEROYALEDEMUSIQUE.
SubtitleofArticle:Robert‐le‐diable,opéraencinqactes;parolesde
MM.ScribeetG.Delavigne,musiquedeM.
Meyerbeer.(Deuxièmearticle)
Signature:O.
Pseudonym:None
Author:AttribuéàJosephd’Ortigue
Layout:Front‐pagefeuilleton
Cross‐reference:VoirLeCourrierdel’Europe,23novembre1831.
1
/
4
100%