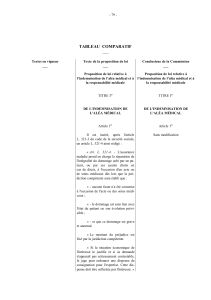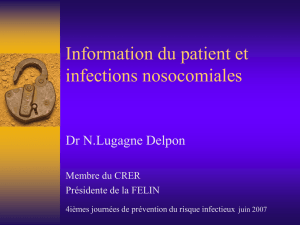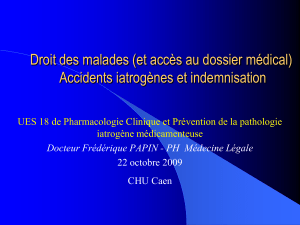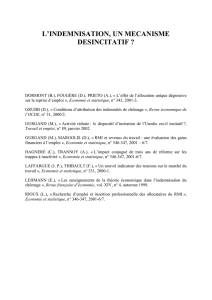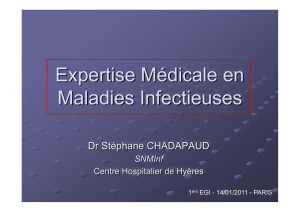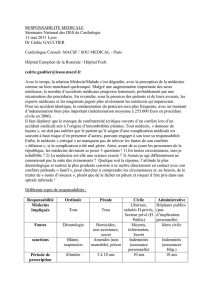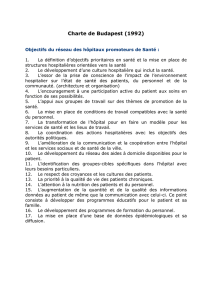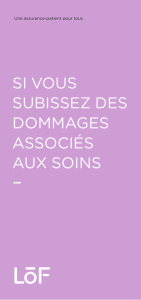Article RGDM - ORBi

© Les Études Hospitalières
En Belgique, la problématique des accidents thérapeutiques est depuis long-
temps, comme elle l’a été durant plusieurs années en France, aussi irritante pour
les théoriciens et praticiens du droit médical qu’elle est douloureuse et souvent
injuste pour les patients qui en sont victimes. Il s’agit en particulier (mais pas
seulement) des infections nosocomiales 1, qui sont, d’une part, absentes lors de
l’admission à l’hôpital et, d’autre part et surtout, indépendantes des soins prodi-
269 Revue générale de droit médical
n° 38 mars 2011
* Courriel : [email protected].
1. Que l’on s’accorde à définir comme les infections acquises au cours du séjour à l’hôpital, en
tenant compte d’un délai d’incubation généralement admis de quarante-huit heures (tribunal de
première instance de Liège, 7 janvier 2002, Revue générale des assurances et de la responsabilité
[RGAR], 2002, n° 13.573 ; M. VANDERWECKENE, « Les infections nosocomiales : une simple question
d’hygiène hospitalière ? », RGAR, 2002, n° 13.568).
Le nouveau régime belge
d’indemnisation des dommages
résultant de soins de santé
Gilles GENICOT
Avocat au barreau de Liège,
maître de conférences à l’université de Liège *
SOMMAIRE
I. – LES LIGNES DE FORCE DU NOUVEAU SYSTÈME D’INDEMNISATION
A. – Champ d’application et dommage indemnisé
B. – Système général élaboré par la loi du 31 mars 2010
C. – Le fonctionnement du nouveau système d’indemnisation
II. – LES CONSÉQUENCES ET LES LIMITES DU NOUVEAU SYSTÈME D’INDEMNISATION
A. – Cohérence du système avec les droits du patient
B. – Indemnisation des dommages et maîtrise corporelle
38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 269
téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]
diffusion interdite © Les Études Hospitalières

gués et de l’affection pour le traitement de laquelle l’hospitalisation a eu lieu. On
sait que, quelles que soient l’ampleur et la rigueur des mesures d’asepsie et de
désinfection mises en place, le taux d’infections nosocomiales est pour ainsi dire
incompressible, même s’il n’est pas forcément constant. Elles existent de manière
universelle dans toute institution hospitalière et il paraît impossible de les éradi-
quer, ne fût-ce qu’en raison de leur genèse très certainement multifactorielle et
quasiment toujours impossible à déterminer avec précision. Il est dès lors hardi
de déduire en soi de la survenance d’une telle infection l’existence d’une faute
dans le chef de l’hôpital ou de son personnel ; en conséquence, l’appréhension
de ce type d’infections, et plus généralement de tout accident médical non fau-
tif, au moyen des règles régissant la responsabilité civile médicale, apparaît sin-
gulièrement malaisée 2.
La Cour de cassation belge a au demeurant entrepris, depuis quelques années,
d’affermir, avec une ferme volonté d’orthodoxie, le paysage de la responsabilité
civile, qu’il s’agisse de la charge de la preuve, de l’exigence de certitude causale
ou de la notion de perte d’une chance. Ces rappels à l’ordre ne paraissaient pas
autoriser d’excursions audacieuses en dehors des canevas bien établis et des sen-
tiers battus du raisonnement classique en droit de la responsabilité, dans le but
d’indemniser des dommages exceptionnels dont il n’est pas possible d’identifier
avec précision ni la cause génératrice ni a fortiori son caractère fautif. Dans ce
contexte, la jurisprudence belge est, sur la question des accidents médicaux non
fautifs, sensiblement plus réduite que son homologue française, sans qu’il soit ici
possible de se perdre en conjectures pour tenter d’expliquer cette disparité ; en
conséquence, chacune de ses étapes est soigneusement épinglée par une doc-
trine attentive 3.
Les auteurs ont du reste pris le relais de juges peu sollicités. Le constat, largement
partagé, qu’il est difficile, sinon impossible, de réparer pareils accidents par le jeu
de la responsabilité civile individuelle a été mis en avant par plusieurs spécialistes
ou groupes de travail belges, depuis une quinzaine d’années 4. Qu’il s’agisse de
LE NOUVEAU RÉGIME BELGE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ
270
n° 38 mars 2011
Revue générale de droit médical
2. Sur le droit de la responsabilité médicale en Belgique, v. notre ouvrage de synthèse : G. GENICOT,
Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, coll. de la Faculté de droit de l’université de Liège,
2010, p. 263-516 ; sur la prise en compte, dans ce schéma, du risque et sur l’exigence croissante
de sécurité du patient, et sur la problématique spécifique des infections nosocomiales, p. 413-437.
3. Les décisions recensées témoignent du reste de l’irréductible controverse qui parcourt notre
jurisprudence. C’est ainsi que, creusant plus profondément un sillage qu’elles avaient déjà entre-
pris de dessiner, les juridictions liégeoises font à cet égard œuvre progressiste, tandis que le tribunal
de première instance de Bruxelles s’en tient, pour sa part, à une approche plus classique (v. notre
commentaire : « Infections nosocomiales : la responsabilité médicale au milieu du gué », Jurispru-
dence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB], 2010, p. 755-761).
4. V. not. Responsabilité et Accidents médicaux, T. VANSWEEVELT (dir.), Anvers, Mys & Breesch, série
Recht en Gezondheidszorg, 1996, spéc. l’article de J.-L. FAGNART, « La réparation des accidents médi-
caux. Proposition de réforme », p. 53 ; de ce même auteur, v. « La réparation des accidents médi-
caux. Perspectives d’avenir », in Actualités du droit de la santé, J. CRUYPLANTS et J.-L. FAGNART (dir.),
Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 1999, p. 361 ; v. aussi R.-O. DALCQ, « L’évolution récente de
la responsabilité médicale », in Liber amicorum Yvette Merchiers, Bruges, Die Keure, 2001, p. 734.
© Les Études Hospitalières
38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 270
téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]
diffusion interdite © Les Études Hospitalières

mettre en avant la fonction « réparatrice » de la responsabilité civile, face à une
atteinte grave et non consentie à l’intégrité physique du patient, en insistant sur
l’importance d’indemniser des victimes durement atteintes dans leur chair, ou de
prôner l’avènement d’une législation spécifique relative aux accidents médicaux
procédant d’un risque thérapeutique ou consécutifs à la réalisation d’un aléa,
les propositions novatrices ont toutefois peiné à se faire entendre.
Lorsque le monde politique s’est décidé à prendre le relais de ces doléances – bran-
dies concurremment par des associations de patients ou de consommateurs –,
plusieurs projets et propositions de lois furent déposés en vue d’instaurer une col-
lectivisation des risques thérapeutiques par la mise sur pied d’un système d’in-
demnisation no fault, voire entièrement détaché des mécanismes de responsabi-
lité 5. Ces initiatives n’ont cependant pas abouti. Les réflexions ont fort logiquement
pris un nouveau tour lorsque la jurisprudence française s’est cristallisée, au plus
haut niveau des deux ordres juridictionnels, dans un sens favorable aux victimes
– dont l’on déplorait qu’il ne paraisse pas possible de l’emprunter en Belgique –,
avant que ces solutions soient intégrées dans les lois françaises n° 2002-303, du
4 mars 2002 (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé),
et n° 2002-1577, du 30 décembre 2002 (relative à la responsabilité civile médicale
et à l’assurance de la responsabilité médicale), qui ont connu un écho certain en
Belgique 6.
Cet intérêt soutenu, doublé de critiques de plus en plus vives adressées à un
droit de la responsabilité civile (nécessairement) enserré dans une gangue rigou-
reuse l’empêchant de répondre à de légitimes prétentions indemnitaires impos-
sibles à rattacher à une faute ou à un autre fait générateur de responsabilité clai-
rement identifié, n’a rien d’étonnant. C’est que les infections nosocomiales, et
plus largement les accidents thérapeutiques, constituent bien davantage qu’un
terrain juridique mouvant et instable, aux chausse-trappes diverses : c’est d’un
véritable problème de société, de solidarité, de santé publique qu’il s’agit ici.
LE NOUVEAU RÉGIME BELGE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ
271 Revue générale de droit médical
n° 38 mars 2011
5. V. le rapport de H. DIERICKX,Auditions sur les aléas thérapeutiques et la responsabilité médicale. Rap-
port fait au nom de la Commission de la santé publique, de l’environnement et du renouveau de
la société, « Doc. Parl. », Chambre, session 2003-2004, 27 avril 2004, document n° 51-1052/001,
ainsi que l’étude très complète de C. DELFORGE, « Vers un nouveau régime d’indemnisation des
accidents médicaux ? », Revue de droit de la santé, 2004-2005, p. 86, qui examine ces propositions
de lois à la lumière des solutions retenues en droit comparé.
6. V. notre article « Faute, risque, aléa, sécurité », in Droit médical, Y.-H. LELEU (dir.), Bruxelles, Lar-
cier, coll. « Commission Université-Palais », 2005, vol. 79, spéc. p. 111-160 ; sur le régime mis en
place par les lois françaises des 4 mars et 30 décembre 2002 quant aux infections nosocomiales
et aux risques thérapeutiques au sens large, tel qu’il a été présenté par la doctrine facilement
accessible en Belgique, v. not. Y. LAMBERT-FAIVRE, « La responsabilité médicale et sa garantie d’assu-
rance dans la législation française de 2002 », in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Bruxelles, Lar-
cier, 2003, p. 808 ; dans le même ouvrage, G. VINEY, « L’originalité du régime d’indemnisation
des risques sanitaires en droit français », p. 851 ; D. MARTIN, « Le dispositif français d’indemnisa-
tion des victimes d’accidents médicaux, par la voie du règlement amiable », in Évolution des droits
du patient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé : le droit médical en mou-
vement, G. SCHAMPS (dir.), Bruxelles-Paris, Bruylant-LGDJ, 2008, p. 473.
© Les Études Hospitalières
38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 271
téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]
diffusion interdite © Les Études Hospitalières

L’insistance se fit de plus en plus vive pour que les accidents médicaux sans rela-
tion avec l’échec des soins fassent l’objet d’une intervention législative ; celle-ci
apparaissait de plus en plus nécessaire, à tout le moins pour organiser l’indem-
nisation des préjudices irrémédiablement liés à la réalisation d’un aléa, où il n’est
pas possible de faire appel aux notions de risque ou de sécurité pour étendre le
spectre de la responsabilité civile traditionnelle. Le souci mis en évidence était de
permettre la prise en charge, en dehors de cette responsabilité (trop) stricte-
ment entendue, de dommages qui appellent un sursaut tendant à une meilleure
gestion collective de malheurs exceptionnels. Ce n’est pas nouveau : en Belgique
comme en France, des études pénétrantes ont mis en évidence que la respon-
sabilité civile n’a nulle vocation à soulager l’intégralité des souffrances, malheurs,
dommages ou préjudices 7.
Le législateur belge a tardé à se laisser convaincre et le résultat auquel il est initia-
lement parvenu était à ce point insatisfaisant qu’il est demeuré lettre morte. L’op-
tique de la loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation des dommages résultant
de soins de santé 8consistait à exclure complètement ceux-ci du domaine de la
responsabilité pour faute, en vue de les orienter vers un système d’indemnisation
forfaitaire et partiel, intégralement fondé sur la solidarité collective. Ce texte, que
la doctrine fut prompte à critiquer – en raison notamment de l’exclusion inac-
ceptable de tout recours au juge dans ce cadre et de l’opacité, des imperfections
et des incohérences du système ainsi mis en place –, n’est jamais entré en vigueur.
La loi du 15 mai 2007 a été abrogée et remplacée par la loi du 31 mars 2010
relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, que
l’on voudrait ici présenter 9. Le nouveau texte met en place un système remodelé,
plus équilibré et satisfaisant, transposant le modèle français « à deux voies » d’in-
LE NOUVEAU RÉGIME BELGE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ
272
n° 38 mars 2011
Revue générale de droit médical
7. Même si, par contraste, il n’est guère novateur de considérer – en droit médical comme ailleurs,
mais peut-être surtout en cette matière – « que l’objectif à atteindre est l’indemnisation rapide et
équitable de tous les dommages encourus par les victimes d’accidents » (F. RIGAUX, « Logique,
morale et sciences expérimentales dans le droit de la responsabilité », in Responsabilités et Assu-
rances. Mélanges Roger O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 522). V. sur ce point notre ouvrage
Droit médical et biomédical, préc. supra note 2, p. 269-275 et les références citées.
8. Moniteur belge, 6 juillet 2007. Une autre loi fut adoptée le même jour concernant le règlement
des différends dans ce cadre. Pour un examen complet assorti de l’éclairage des travaux prépara-
toires, v. E. LANGENAKEN, « La réforme de l’indemnisation du dommage issu des soins de santé : révo-
lution ou régression ? », RGAR, 2007, n° 14.312, et in Droit de la responsabilité, B. KOHL (dir.), Lou-
vain-la-Neuve, Anthemis, coll. « Commission Université-Palais », 2008, vol. 107, p. 281 ;
J.-L. FAGNART, « La réparation des dommages résultant de soins de santé. Belles idées et vilaine
loi », in Évolution des droits du patient..., op. cit., p. 407 ; dans le même ouvrage, les « Points de
vue d’acteurs de terrain » à propos du « nouveau système belge d’indemnisation des dommages
liés aux soins de santé », p. 497-584. V. aussi l’ouvrage Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoe-
ding van gezondheidsschade. De Wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als
gevolg van gezondheidszorgen, H. BOCKEN (éd.), Malines, Kluwer, 2008.
9. La loi du 31 mars 2010, publiée au Moniteur belge du 2 avril 2010 (p. 19.913), peut être
consultée à l’adresse suivante : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller
=summary&pub_date=2010-04-02&numac=2010024096#top. Travaux parlementaires : projet
de loi déposé à la Chambre le 12 novembre 2009 (« Doc. Parl. », Chambre, session 2009-2010,
© Les Études Hospitalières
38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 272
téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]
diffusion interdite © Les Études Hospitalières

demnisation des dommages médicaux, qui a démontré son efficacité depuis
2002. Cette loi « s’applique aux dommages résultant d’un fait postérieur à sa
publication au Moniteur belge », soit le 2 avril 2010, mais n’entrera toutefois en
vigueur qu’à une date déterminée par un arrêté royal (paradoxe belge...), après
que l’architecture et le financement du nouveau système auront été mis en
œuvre, ce qui est nécessairement reporté compte tenu de la conjoncture poli-
tique belge à l’heure où ces lignes sont écrites.
La loi du 31 mars 2010 crée donc un droit de l’avenir, applicable aux dommages
futurs, tout en instaurant déjà des droits subjectifs « virtuels » au bénéfice des
patients victimes. Elle organise l’indemnisation des accidents médicaux d’ori-
gine non fautive au moyen d’une procédure amiable de résolution des litiges, par
l’intermédiaire d’un Fonds des accidents médicaux, sans toutefois supprimer le
recours au juge, ce qui constitue l’inflexion majeure et bienvenue par rapport au
texte de 2007. Le droit commun est maintenu en matière de responsabilité, tan-
dis que la solidarité nationale prend le relais en cas d’accident médical sans res-
ponsabilité, en vue de permettre l’indemnisation des seuls dommages graves
consécutifs à un accident thérapeutique. Cette réforme bouleverse en profon-
deur les fondements mêmes du droit belge de la responsabilité médicale : le sys-
tème mis en place supprime, en effet, l’obligation pour le patient de démontrer
la faute d’un professionnel de la santé, et ouvre un droit à indemnisation de la
victime dès qu’un accident thérapeutique est avéré. Il suffira alors au patient,
pour être indemnisé, de prouver qu’il a subi un dommage et que celui-ci trouve
sa cause dans une prestation de soins ; le Fonds d’indemnisation nouvellement
créé est voué à devenir son interlocuteur privilégié.
Outre son impact pratique majeur, la réforme – dont on peut espérer que la loi
du 31 mars 2010 constitue l’aboutissement – marque un changement radical de
philosophie dans le traitement juridique des accidents médicaux. Dans la mesure
où elle maintient la possibilité d’un recours aux cours et tribunaux, conformé-
ment aux règles du droit commun, la loi nouvelle aplanit en partie les écueils que
celles du 15 mai 2007 n’avaient pas manqué d’ériger, notamment quant à leur
articulation avec les droits généraux du patient, inscrits en Belgique dans la loi
du 22 août 2002 10. L’impact du régime initialement envisagé sur la nature de
LE NOUVEAU RÉGIME BELGE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ
273 Revue générale de droit médical
n° 38 mars 2011
nos 52-2240/001 et 52-2241/001 : exposé des motifs, avant-projet, avis du Conseil d’État et projets
de loi) ; rapport fait, au nom de la Commission de la santé publique, de l’environnement et du renou-
veau de la société, par Mme BURGEON le 26 février 2010, « Doc. Parl. », Chambre, n° 52-2240/006.
Le texte n’a pas été discuté par le Sénat et fut publié avec une célérité inhabituelle. Dès la fin de
l’année 2008, il était certain que les lois du 15 mai 2007 resteraient mort-nées et seraient prochai-
nement supplantées par un régime quelque peu différent, plus souple et plus égalitaire, calqué sur
le modèle français (E. LANGENAKEN, « Les lois du 15 mai 2007 et le respect du principe d’égalité, note
sous Cour const., 15 janvier 2009 », JLMB, 2009, p. 1155-1157).
10. Sur ce que cette articulation n’a, à l’époque, pas nourri la réflexion du législateur, alors qu’en
vue d’une approche cohérente et logique du droit médical belge, ces dispositions auraient dû être
rapprochées, v. E. LANGENAKEN, « Droits du patient, droits de la personnalité, indemnisation : quelle
cohérence ? », in Les Droits de la personnalité, J.-L. RENCHON (dir.), Bruxelles, Bruylant, coll. « Famille
& Droit », 2009, p. 93.
© Les Études Hospitalières
38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 273
téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]
diffusion interdite © Les Études Hospitalières
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%