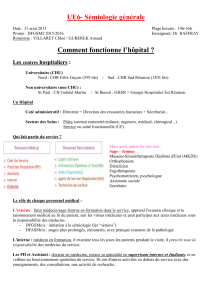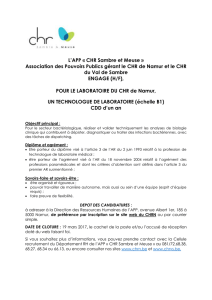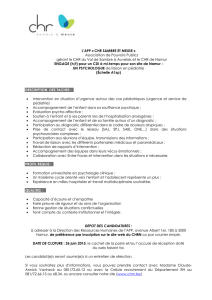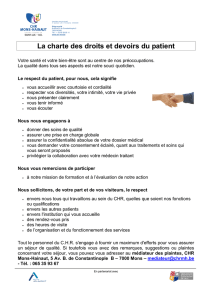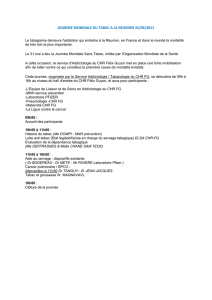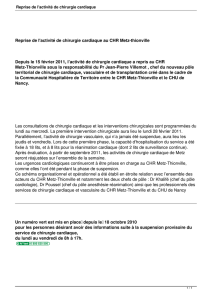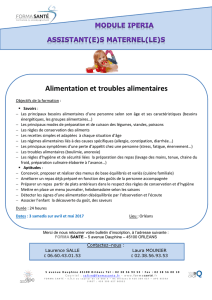Chroniques n°90

N°
NOV 2011
Magazine d’information
du Centre hospitalier régional d’Orléans
DOSSIER
La 11
ème
journée innovations
en images
RECHERCHE
L’autisme à l'ère de la génétique
90

ORLÉANS
Le Clos des Lilas
*
ORLÉANS
Le Marco Polo
*
ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
Prymo Verde
*
VERNOUILLET
Résidence Services Séniors
Le Chant des Lavandières
NOUVEAU
*
AMILLY
Résidence Haute Feuille
*
ST-CYR-EN-VAL
Les Villas Botania
*
ST-DOULCHARD
Résidence Services Séniors
Le Côteau d’Argent
28
41
Orléans
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Vernouillet
Saint-Cyr
en-Val
45
Amilly
18
Saint-Doulchard
Devenez propriétaire
avec Nexity et
découvrez nos adresses d’exception !
Faites confiance
à Nexity,
premier acteur intégré
des métiers de
l’immobilier neuf en France
- Document et illustrations non contactuelles. *Programme en cours de labellisation.
RCS NEXITY GEORGE V CENTRE RCS NANTERRE 4340000148.
D
e
N
e
a
z
e
n
e
v
ve
e
D
t
e
t
i
e
r
p
o
r
p
z
e
r
i
a
t
ta
é
i
d
e
N
c
e
v
ve
a
n
z
e
r
v
u
o
c
co
é
d
t
e
y
d
t
ty
i
x
e
s
s
e
r
re
d
y
a
s
o
n
t
p
e
c
x
e
’
’e
d
s
e
!
n
o
i
t
s
r
o
i
n
é
S
s
e
c
i
v
r
rv
e
S
e
c
n
e
d
i
s
é
R
T
E
L
L
I
U
O
N
R
E
V
U
A
E
V
U
O
N
*
s
nouillet
er
Orléans
er
V
V
Ver
Ver
Orléans
28
Amilly
Orléans
Orléans
Orléans
Orléans
Orléans
S
N
A
É
L
R
O
Amilly
S
*
*
s
e
r
è
i
d
n
a
v
a
L
s
e
d
t
n
a
h
C
e
L
Le
s
r
o
i
n
é
S
s
e
c
i
v
r
rv
e
S
e
c
n
e
d
i
s
é
R
.
8
4
.
n
o
i
t
a
s
i
l
l
e
b
a
l
e
d
s
r
rs
u
o
s
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Saint-Jean-de-la-Ruelle
41
45
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Saint-Jean-de-la-Ruelle
al
en-V
en-Val
Saint-Cyr
Saint-Jean-de-la-Ruelle
41
S
N
A
É
L
R
O
o
P
o
c
r
a
M
e
L
Le
S
*
o
l
o
e
d
r
e
V
Ve
o
m
y
r
ry
P
A
L
LA
-
E
D
-
N
A
E
J
-
-J
T
T-
S
ST
4
1
0
0
0
0
4
3
4
E
R
R
E
T
N
A
N
S
C
R
E
R
T
N
E
C
V
E
G
R
O
E
G
Y
o
c
n
e
e
m
m
a
r
ra
g
o
r
ro
P
*
.
s
e
l
l
e
u
t
c
a
t
n
o
c
n
o
n
s
n
o
i
t
a
r
ra
t
s
u
l
l
i
t
e
U
R
-
A
d
Saint-Doulchar
Saint-Doulchar
18
L
s
e
d
s
o
l
C
e
L
Le
s
a
l
i
L
*
a
i
n
a
t
o
B
s
a
l
l
i
V
s
e
L
Le
L
A
V
VA
-
-V
N
E
-
R
Y
C
-
T
T-
S
ST
Y
T
TY
I
X
E
N
S
C
R
t
n
e
m
u
c
o
D
-
L
e
L
Le
é
R
T
S
ST
t
n
e
g
r
A
’
’A
d
u
a
e
t
ô
C
e
s
r
o
i
n
é
S
s
e
c
i
v
r
rv
e
S
e
c
n
e
d
i
s
é
D
R
A
H
C
L
LC
U
O
D
-
T
T-
F
e
t
u
a
H
e
c
n
e
d
i
s
é
R
Ré
Y
L
LY
L
I
M
A
e
l
l
i
u
e
F
n
e
f
u
e
n
r
e
i
l
i
b
o
m
m
i
’
l
d
s
r
e
i
t
é
m
s
e
d
t
n
i
r
u
e
t
c
a
r
e
i
m
e
r
p
,
y
t
i
x
e
N
à
c
n
a
fi
n
o
c
s
e
t
i
a
F
e
c
n
a
r
F
n
e
é
r
g
é
t
e
c

I ÉDITORIAL
NOVEMBRE 2011 - 3
CHRONIQUES N° 90
Sommaire
LA RECHERCHE
AU CHR D’ORLÉANS
Depuis quelques années, la structuration de la recherche clinique et fondamen-
tale, ainsi que les processus d’innovation, se sont affinés au sein de l’établisse-
ment. La sous-commission Recherche et Enseignement qui coordonne cette
structuration pour le compte de la CME a été à l’origine de la création d’une cellule
d’aide méthodologique permettant au CHR d’Orléans d’évaluer la faisabilité d’une
promotion des études validées. Un partenariat dans le cadre d’une convention avec
l’Université d’Orléans est à l’étude pour fournir un soutien en biostatistique.
Les grandes orientations de notre poli-
tique de recherche portent par ailleurs
sur :
• la poursuite de l’enrichissement des
activités de recherche clinique avec
le partenariat du Centre National de
Gestion des Essais de Produits de Santé
(CENGEPS),
• la promotion d’une politique d’encoura-
gement au dépôt de réponses aux
appels d’offre des Programmes Hospi-
taliers de Recherche Clinique (PHRC) et
des Programmes de Soutien aux Tech-
niques Innovantes Coûteuses (STIC),
• une amélioration des liens avec l’Univer-
sité d’Orléans, en particulier pour déve-
lopper la relation médecin – chercheur
et s’orienter vers la recherche de valori-
sation et de transfert,
• l’initialisation, avec la direction des soins,
d’une démarche en faveur de la
recherche pour et par les personnels
soignants (richesse des journées « inno-
vations »), notamment en matière de
soins infirmiers,
• le renforcement du rôle des pôles pour
mutualiser l’effort de recherche via des
protocoles communs.
Le CHR d’Orléans peut d’ores et déjà
s’appuyer sur les forces existantes dans
l’établissement et s’adosser aux vitrines
que constituent :
• l’équipe « génétique expérimentale et
moléculaire » au sein de l’Unité Mixte de
Recherche 6218 CNRS – Université
d’Orléans sous la responsabilité du
Dr Sylvain BRIAULT, l’équipe Institut
National de la Santé Et de la Recherche
Médicale (INSERM) « Unité 707 » sur le
thème « Epidémiologie, Système d’infor-
mation, Modélisation », antenne de la
Région Centre du réseau Sentinelles,
sous la direction du Dr Thierry PRAZUCK,
• l’équipe INSERM U 658 sur le thème
« Caractérisation du tissu osseux par
imagerie : techniques et applications »
sous la direction du Dr Claude-Laurent
BENHAMOU,
• l’IPROS (Institut de Prévention et de
Recherche sur l’Ostéoporose) qui déve-
loppe 50 % environ des études cliniques
faites dans l’établissement en partena-
riat avec l’industrie pharmaceutique,
• mais aussi les équipes d’hépato-gastro-
entérologie, de dermatologie, de réani-
mation médicale qui sont parmi les plus
contributrices en terme de production
scientifique.
Eric LESPESSAILLES
Président de la Commission
Recherche et Enseignement
‘
I ACTUALITÉ
NHO : Focus sur la gériatrie
et le shéma directeur
du système d’information...............p 4 - 5
Elan de solidarité au CHR ...................p 6
L’association BADA BOUM .............p 6 - 7
Visites des locaux témoins
du Nouvel Hôpital.................................p 7
Action humanitaire au bénéfice
des hôpitaux Burundais .......................p 8
I LES PATIENTS ONT LA PAROLE
Unité d’Accueil des Jeunes Victimes .p 9
IVIE DE L’INSTITUTION
Présentation de l’EADSP 45...............p 10
Le Centre d’Assistance
aux Utilisateurs De L’Informatique
(CAUDI)...............................................p 11
Retour sur la 11ème journée
innovations ................................p 12 - 13
I DOSSIER
Exercice multivictimes ...............p 14 - 15
I RECHERCHE
L’autisme à l'ère de la Génétique ....p 16
Nouvelle avancée de la recherche
au CHR d’Orléans.............................. p 17
I VIE DES SERVICES
Les « Petits Plus » qui améliorent
la vie des services......................p 18 - 19
I CULTURE
Inventaire du patrimoine du CHR ......p 20
I CINÉMA
Un cinéma au cœur
de l’hôpital Porte Madeleine .............p 21
I PORTRAIT
Julie BRUGNEAUX,
documentaliste au CHR .....................p 22
Directeur de la publication : Olivier Boyer
Directeur de la rédaction : Juliette Vilcot-Crépy
Rédacteur en chef : Lorène Gardin
Illustrations : service audiovisuel, DUQC,
Réalisation et impression : Ed’stuaire - St-Nazaire
Tirage : 5560 exemplaires
Dépôt légal : ISSN 1264-9260©
Tous droits de reproduction réservés

POINT DE VUE
D’UN CHEF DE PÔLE
Dans le cadre de la construction du nouvel
hôpital, le CHR regroupera plusieurs unités
fonctionnelles gériatriques sur le site du
plateau technique de l’hôpital de La Source.
Soulignons les futurs bénéfices « en cascade » :
les modifications structurelles importantes
en cours ou à venir au sein du CHR, néces-
saires pour accompagner le vieillissement
de la population et l’apparition de nouveaux
besoins de santé, seront positives sur le plan
fonctionnel, au-delà des frontières de la
gériatrie.
QUELLES MODALITÉS
D’ADAPTATION ?
L’ouverture en deux temps d’un bâtiment de
40 lits court-séjour sur le site de La Source
(octobre 2010-janvier 2011) comprendra :
• une Unité Post-Urgences Gériatrique de
21 lits,
• une Unité Court séjour Gériatrie de 19 lits
avait déjà permis la fermeture de l’UF
« Post-Urgences » de centre-ville, trop loin
du plateau technique et d’ouvrir 5 lits
supplémentaires totalement dévolus à
l’accueil de patients venus aux urgences.
Cette création a facilité la mise en place de
trois unités gériatriques court séjour sur Porte
Madeleine et contribue à préparer l’amont
de la filière d’ici l’ouverture du nouvel hôpital
en 2015 :
• Court séjour Geriatrie avec Soins Palliatifs :
6 lits (en place depuis été 2010)
• Court séjour Geriatrie avec début de réha-
bilitation (nutritionnelle, rééducation, post-
chutes et post-SAU…) de 18 lits en place
depuis janvier 2011.
• Unité de Soins Aigus Patients Alzheimer :
12 lits (en projet).
L’ouverture dès 2013 du pôle A comprenant
120 lits constituera par ailleurs le palier inter-
médiaire indispensable au regroupement
de l’ensemble des unités fonctionnelles
gériatriques et à leur montée en puissance
capacitaire.
QUELS AVANTAGES
POUR LE CENTRE DE MÉDECINE
GÉRIATRIQUE ?
La compensation d’un déficit structurel
SSR de longue date :
Les 58 lits Soins de Suite Réadaptation
(SSRGer) fermeront sur le site de Saran au
profit de l’ouverture de 120 lits SSRGer sur le
site de La Source en 2013. Ces lits permet-
tront un meilleur aval pour l’ensemble
des lits de l’hôpital, en faveur de patients
nécessitant un projet de réadaptation pour
un retour au domicile plus lent qu’en court-
séjour. Une Unité Cognitivo-Comportemen-
tale et une Unité de Soins Palliatifs y seront
également intégrées.
Un fonctionnement quotidien facilité :
La proximité immédiate des 120 lits de SSR
gériatrique, du plateau technique (imagerie),
du plateau technique de rééduction et des
75 lits futurs de court séjour gériatrique
offriront une cohérence exceptionnelle à
cet ensemble.
Un aval amélioré pour l’ensemble de la
filière :
La transformation concomitante en 2013 des
58 lits de SSR de Saran en unités de soins de
longue durée permettra d’accompagner le
regroupement des services d’hébergement
du CHR, de contribuer à l’amélioration des
conditions d’accueil des résidents et de
développer l’aval du SSR et des lits de méde-
cine pour les patients à perte d’autonomie
importante.
QUEL IMPACT SUR LE SERVICE
D’ACCUEIL DES URGENCES ET LA
MÉDECINE LIBÉRALE ?
• un accueil plus adapté des patients en
court-séjour, libérant des places pour des
patients en attente de lits au SAU,
• la possibilité de renforcer la confiance des
généralistes, trop souvent déçus de ne
plus pouvoir faire « des entrées directes »
en court-séjour,
• un respect et un meilleur accueil des
aidants du fait d’un moindre stress
ambiant au sein du CHR.
Toutes ces modifications n’ont de sens que
si elles sont fonctionnellement liées en
externe à un travail de réseau centré sur les
« potentialités de maintien au domicile », en lien
étroit avec les hospitalisations programmées
pouvant venir en appui d’hospitalisations
classiques ; en interne d’une part aux
différents spécialistes du MCO (médecine,
chirurgie, obstétrique), et d’autre part aux
consultations gériatriques classiques (ou
plus spécifiques « chutes et troubles de la
marche », « mémoire » et « d’oncogériatrie »).
Le travail des interfaces demande un temps
de concertation important avec les spécia-
listes et la médecine libérale, il s’appuie sur
l’éducation thérapeutique pour la mise en
place des recommandations et le suivi de
ces recommandations qui sont au cœur
du « concept de fragilité » en médecine
gériatrique.
Jean-Bernard GAUVAIN
Praticien chef de service
I ACTUALITÉ
4
‘
LA GÉRIATRIE
ET LE NOUVEL
HÔPITAL
D’ORLÉANS
FOCUS

I ACTUALITÉ
NOVEMBRE 2011 - 5
CHRONIQUES N° 90
LE SCHÉMA DIRECTEUR
DU SYSTÈME D’INFORMATION
L’objectif recherché est en effet d’iden-
tifier les principaux axes d’évolution du
système d’information, tant au point
de vue des infrastructures (salles blanches,
réseaux, serveurs, PCs), que des applications
administratives, cliniques et médico-tech-
niques avec en particulier l’informatisation
de la prise en charge médicale et de soins.
Ce programme 2009-2013 approuvé par les
instances prend en compte l’évolution du SIH
vers le Nouvel Hôpital d’Orléans sur les
années à venir et prédéfini ce que sera le SIH
« cible » en 2015 dans le Nouvel Hôpital.
Les trois axes majeurs sont :
• la mise en œuvre d’un PACS,
• une complète mise à niveau des infra-
structures en conformité avec l’état de l’art
et les exigences de sécurité et de disponi-
bilité croissante,
• l’implantation d’un socle d’interopérabilité
afin d’optimiser l’utilisation intégrée de la
centaine de logiciels composant l’actuel
SIH dans l’attente du choix d’un logiciel
dossier patient partagé et informatisé à
même de créer une dynamique d’intégra-
tion centrée sur la « colonne vertébrale »
du nouveau dossier patient troisième axe
majeur de ce programme.
Le processus de choix de ce logiciel de
production de soins, actuellement en cours
sous forme de dialogue compétitif entre
4 candidats, sera achevé en 2011.
Puis, s’opéreront le déploiement maximal
possible de ce dossier et la poursuite des
mises à niveaux des infrastructures.
L’enjeu est de faciliter le déménagement
des salles et la mise en œuvre de toutes les
fonctionnalités modernes sur les domaines
administratifs et de gestion, de la production
de soins et du système de pilotage.
DES CHOIX QUI ENGAGENT LA COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE
• Convergence des voix (téléphonie) et données informatiques sur le même réseau avec ex-
ploitation intégrée au système d’information, implantation d’un terminal au lit du malade à
usage privatif (bouquet télévisuel, téléphone, accès aux chaines thématiques de santé et à
l’information hospitalière).
• Expansion de l’utilisation des outils de mobilité tablettes chariots PDA et Smartphone pour utiliser
certaines fonctionnalités du SIH (messagerie, prescription en tout lieu du CHR d’Orléans).
• Automatisation de circuits logistiques par les « Tortues » (Transports Automatisés Lourds) et le
projet d’implanter des robots en pharmacie qui nécessiteront l’installation de logiciels dédiés
et intégrés à notre SIH. Des expérimentations sont en cours dans certains services, afin
d’automatiser plus fortement le travail des secrétariats médicaux, avec le déploiement de la
dictée numérique et bientôt de la reconnaissance vocale. Des études seront menées, pro-
chainement, afin d’optimiser cette organisation : production centralisée et automatisée des
comptes-rendus d’hospitalisation et de consultations, prise de rendez-vous plus fluide et au-
tomatisation des rappels par sms, dématérialisation des archives en lien avec l’implantation
du dossier patient partagé. Ceci afin de faciliter le lien avec les patients, les consultants et les
médecins de ville, lien renforcé par le déploiement du dossier médical personnel sur le terri-
toire ouvert à la demande du patient et permettra de communiquer plus rapidement les in-
formations pertinentes à la prise en charge du patient dans la filière de soins. Techniquement,
ce déploiement exigera de penser au mieux l’infrastructure et d’accroître l’analyse de perfor-
mance du SIH sur la base d’ici 2015 d’une exigence de certification ISO.
Francis GEST
Directeur de la Direction
des Systèmes d’Information
‘
DÈS 2008, UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE A ÉTÉ INITIALISÉE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT AFIN
D’ACTUALISER LE SCHÉMA DIRECTEUR DU SYSTÈME D’INFORMATION (SIH).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%