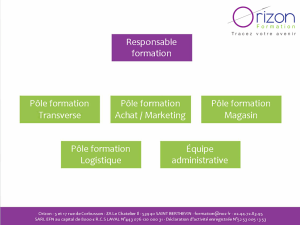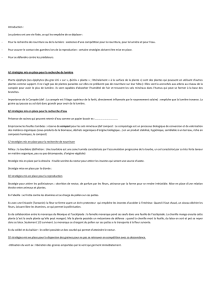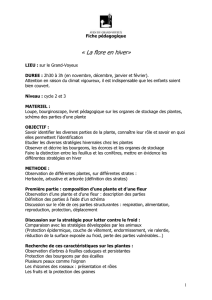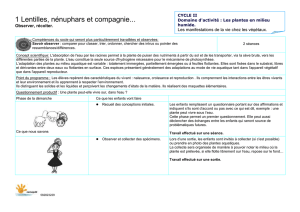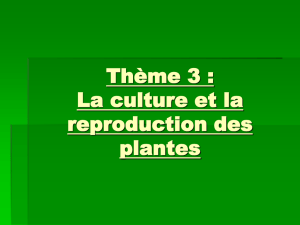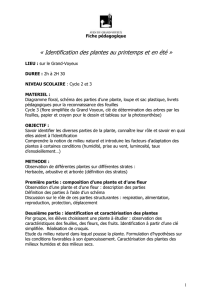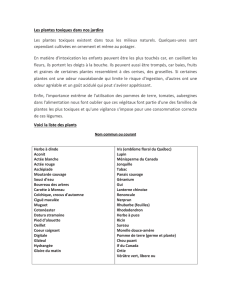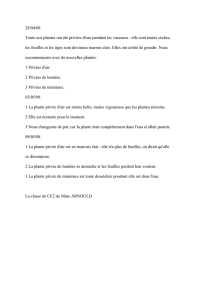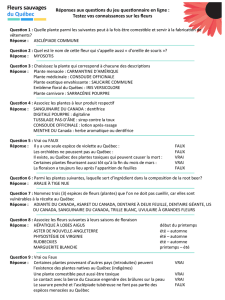Rapport sur les mécanismes de défenses indirectes chez les plantes

Les mécanismes
de défenses
indirectes chez
les plantes
Juliette Giniaux Hugues Mandavid
Master 1 Master 1
PE VRV

2"
"
Sommaire :
Abréviations………………………………………………………………………………...…..2
Introduction………………………………………………………………………………...…...3
I. Les EFN……………………………………………………………………...……..4
A. Description…………………………………………………………………...…5
B. Importance de l’acide jasmonique dans l’induction d’EFN…………...………. 7
C. Le complexe acide jasmonique – Isoleucine…………………………….…… 10
D. Les insectes entomophages impliqués dans la relation tri-
trophique…………………………………………………...………….………10
II. Les HIVOC ……………………………………………………………………… 12
A. Description…………………………………………………………………... 12
B. Les différents types de composés volatiles existants………………………… 13
C. Les HIVOC influencés par les facteurs abiotiques…………………………16
D. Les HIVOC et les EFN…………………………………………………......… 16
E. Les HIVOC : Pas seulement bénéfiques........................................................... 17
Conclusion…………………………………………………………………………………..18
Bibliographie……………………………………………………………………………..…... 19
Résumé (français)…………………………………………………………………………… 20
Résumé (anglais)………………………………………………………………….………… 21

3"
"
Abréviations :
JA : Jasmonic acid: l’acide jasmonique (AJ)
EFN: Extra Floral Nectar: le nectar extra-foral
Ile : Isoleucine
HIVOC: Herbivore-induced volatile organic compounds : Les herbivores induisent des
composés volatils organiques.

4"
"
Introduction
Quel bonheur de se promener en pleine nature, enivré par les douces odeurs des forêts
et campagnes dont les arômes nous bercent et nous emportent vers un Nirvana sensoriel aux
senteurs apaisantes, décontractantes, relaxantes. Mais d’où nous proviennent ces émanations
volatiles si magiques? Depuis des temps immémoriaux, les organismes végétaux eucaryotes et
procaryotes communiquent avec l’environnement qui les entoure. En effet, les plantes étant
des organismes sédentaires, elles ont été obligées au cours du temps de développer maintes
techniques et mécanismes leur permettant de survivre dans les conditions les plus hostiles de
cette planète et de compenser leur immobilité pour s’adapter. Les plantes ont alors synthétisé
des métabolites secondaires qui sont principalement des phénols (tanins, lignine, flavonoïdes),
des composés azotés (alcaloïdes, hétérosides cyanogènes et glucosinolates) ou encore des
terpènes (Hémi-, mono-, sesqui-, di-, tri-, tétra- et polyterpènes). Les métabolites secondaires
– qui sont les outils principaux de la coévolution plantes-êtres vivants - dont font partie des
molécules volatiles, permettent une communication aussi diversifiée que stupéfiante avec leur
environnement. Depuis 1980 (Price et al.) avec des études sur l’existence, puis plus tard sur le
rôle de ces VOC (volatile organic compounds), plus de 1700 composés volatiles ont déjà été
décrits dans plus de 90 familles. Ils peuvent provenir des feuilles, des fleurs ou encore des
fruits de ces plantes sécrétrices. La composition chimique et l’intensité du mélange de ces
substances volatiles sont très révélatrices du statut physiologique dans lequel se trouve la
plante et du stress qu’elle subit. Les molécules volatiles possèdent des rôles divers et variés.
Elles peuvent en effet servir comme un guide jusqu’au nectar (attraction des pollinisateurs)
afin de favoriser la reproduction et la dispersion des graines ou encore jouer un rôle dans les
stress abiotiques rencontrés (les isoprénoïdes volatiles permettent de protéger la plante face à
la chaleur, en améliorant sa thermo tolérance et donc de maintenir un fort taux de
photosynthèse), dans les interactions intra- et inter-plantes ou encore dans la communication
souterraine. Mais un des buts majeurs de cette émission est de défendre la plante face à des
agresseurs de types herbivores, pathogènes ou parasites. La plante, pour se défendre, utilise
des composés allélopathiques de défense contre les prédateurs, qui peuvent être insecticides,
des antifongiques, des anti-pathogènes (les phytoalexines). Il existe deux types de défenses :
les défenses directes, qui peuvent être les épines, les cires, les trichomes, raphides, domaties,
pilosité, silices ou quand les composés volatils interagissent directement avec le prédateur de

5"
"
la plante, perturbant la croissance et le fonctionnement des organes des ravageurs, et limitant,
voire inhibant leur alimentation. – et les défenses indirectes portent leur nom car elles n’ont
pas d’influence directe sur les herbivores mais sur leurs ennemis prédateurs et les
parasitoïdes, elles incluent donc des niveaux trophiques supérieurs. Les avancées
technologiques et scientifiques dans les domaines de la biologie moléculaire, de la génétique
et surtout l’avènement de techniques de chimie analytique très perfectionnées, ont permis une
récente et importante avancée de la compréhension de ces différents processus. Notre étude
portera sur les techniques indirectes utilisées par la plante pour se défendre face aux
herbivores. Nous allons donc dans un premier temps parler des HIVOC (Herbivore-induced
volatiles organic compounds), puis nous traiterons dans un second temps une autre défense
indirecte que possède la plante, qui est l’induction d’EFN (extra-floral nectar).
I. Extra floral nectar
A. Description
Parmi les différentes défenses de la plante, l’une d’elles consiste à se défendre
indirectement face aux herbivores par la production de nectar extra-floral (EFN). Le nectar
qui est produit en dehors de la fleur – contrairement à celui produit à la base de la fleur qui est
impliqué dans l’attraction des pollinisateurs - est fait pour attirer les espèces entomophages.
Les prédateurs attirés mangeront le nectar et l’herbivore étant en train d’attaquer la plante. Ils
fonctionnent donc comme des gardes du corps. Les organes nectarifères peuvent se produire
sur toutes les structures végétatives mais sont généralement situés sur le pétiole des fleurs, la
nervure médiane ou la marge des feuilles. Il sert aux carnivores à attraper leurs proies. Il est
constitué principalement de monosaccharides (glucose, fructose…) ou de diholosides
(saccharose…) mais également de nombreux produits chimiques tels que des acides aminés.
A travers les différentes publications, nous avons pu mieux définir l’EFN, comment il est
induit, ainsi que les réactions qu’il entraine. Parmi les angiospermes, il existe actuellement
109 familles induisant un EFN, et 4032 espèces, et semblerait être absent des Gymnospermes.
(Selon le site biosci).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%