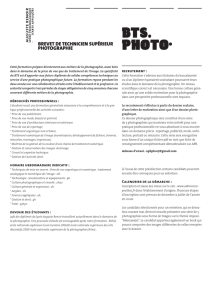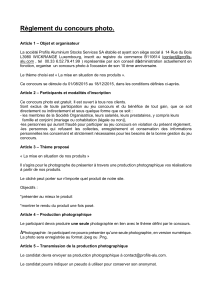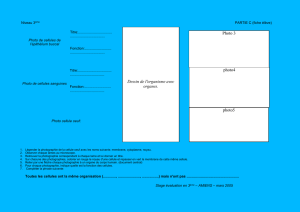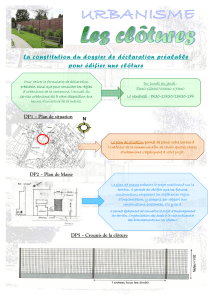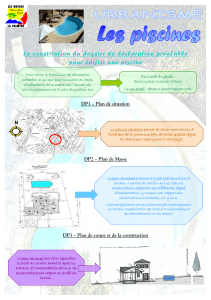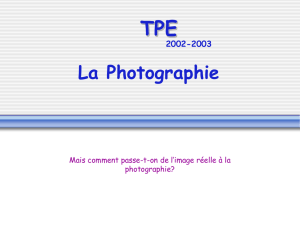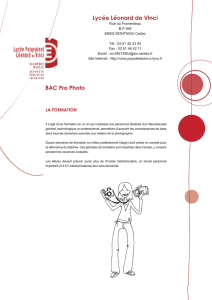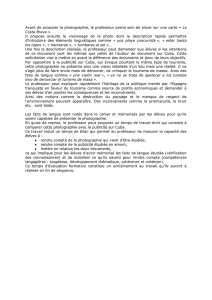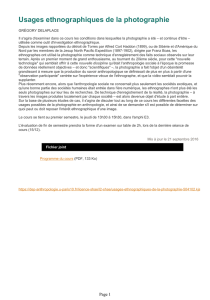L`œil photographique Patrick Tosani Yuri Kozyrev

L’œil photographique
Patrick Tosani
Yuri Kozyrev
Hocine Zaourar
Sophie Ristelhueber
Éric Baudelaire
Paul Graham
David Goldblatt
Allan Sekula
Thomas Ruff
Hiroshi Sugimoto
Philippe Gronon
Valérie Belin
Wolfgang Tillmans
Sophie Calle
Philippe Bazin
Rineke Dijkstra
Pierre Gonnord
Nan Goldin
Éric Poitevin
Viviane Sassen
Véronique Ellena
Andres Serrano
Jean-Luc Mylayne
Xavier Zimmermann
Stéphane Couturier
Bernd & Hilla Becher
Raphaël Dallaporta
Vincent J. Stoker
Andreas Gursky
Thomas Demand
Geert Goiris
Zineb Sedira
Yto Barrada
Jeff Wall
Cindy Sherman
Jeanloup Sieff
Abigail Lane
Philip-Lorca diCorcia
Gregory Crewdson
Camille Henrot
NASA

Avec le mécénat de
Partenaires médias En partenariat avec
PARTENAIRES
Conseil Régional d’Auvergne
DRAC Auvergne - Ministère de la Culture et de la Communication
Ville de Clermont-Ferrand
MÉCÈNES
Michelin
Laboratoires Théa
Banque Populaire du Massif Central
PARTENAIRES MÉDIAS
Groupe La Montagne Centre France
France 3 Auvergne
Atalante Productions
Supaire Frappe, Studio de conception visuelle & Direction artistique
Et
Il Visconti

EXPOSITION DU 5 OCTOBRE 2013 AU 9 FÉVRIER 2014
Du mardi au samedi, de 14 h à 18 h, le dimanche de 15 h à 18 h.
Sauf jours fériés, 24 et 31 décembre. Entrée gratuite.
VISITES GUIDÉES GRATUITES
CHAQUE WEEK-END : samedi à 15 h et 17 h, et dimanche à 16 h 30. Durée : 1 h.
CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS À 16 H 30 (Durée 1 h 30) :
LES TRANSVERSALES / CINQ PARCOURS POUR VOIR L’EXPOSITION AUTREMENT
Dimanche 6 octobre : Lire les images
Focus sur les œuvres de Patrick Tosani, Hocine Zaourar, NASA, Philippe Gronon, Valérie Belin,
Éric Poitevin, Thomas Ruff, Andreas Gursky.
Dimanche 3 novembre : La photographie mise en scène
Focus sur les œuvres de Éric Baudelaire, Andres Serrano, Jean-Luc Mylayne, Raphaël Dallaporta,
Abigail Lane, Gregory Crewdson, Jeanloup Sieff, Cindy Sherman, Philip-Lorca diCorcia.
Dimanche 1er décembre : L’humanité révélée
Focus sur les œuvres de David Goldblatt, Paul Graham, Sophie Calle, Philippe Bazin, Pierre Gonnord,
Rineke Dijkstra, Nan Goldin, Yto Barrada.
Dimanche 5 janvier : Regarder le monde
Focus sur les œuvres de Yuri Kozyrev, Sophie Ristelhueber, Allan Sekula, Viviane Sassen,
Xavier Zimmermann, Bernd et Hilla Becher, Zineb Sedira, Geert Goiris, Vincent J. Stoker, Jeff Wall.
Dimanche 2 février : L’objet de la photographie
Focus sur les œuvres de Thomas Ruff, Patrick Tosani, Camille Henrot, NASA, Wolfgang Tillmans,
Hiroshi Sugimoto, Eric Poitevin, Thomas Demand.
À VOIR PENDANT L’EXPOSITION
K
LASSI
K
AL : LE COLLECTIF CLASSICAL ET KAFKA JOUENT AU FRAC AUVERGNE
A l’occasion de « Clermont Fête ses Étudiants », le groupe de rock Kafka et le collectif électro Classical
(Mr Nô, Freek, Beatcheese, Jen Onesailor, Comausaure, Gëinst) investissent les espaces d’exposition du
FRAC pour 7 heures de concerts.
Samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre de 14 h à 19 h. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Le collectif Classical se produira les 18 et 19 octobre à la Coopérative de Mai.
NAN GOLDIN / THE TIGER LILLIES : THE BALLAD OF SEXUAL DEPENDENCY
Cette œuvre majeure de la photographie contemporaine créée par Nan Goldin entre 1976 et 1986 – près
de 700 photographies – est régulièrement présentée sous la forme d’un diaporama dans des musées ou
des galeries d’art. Beaucoup plus rarement dans un théâtre. Initialement associée à une bande-son conçue
par Nan Goldin elle-même, La Ballade est cette fois accompagnée sur scène par le groupe anglais punko-
burlesque The Tiger Lillies.
Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale / dimanche 24 novembre à 15 h, durée 1 h 45.
PROJECTION DE DEUX DOCUMENTAIRES
Nan Goldin de Jean-Pierre Krief, 13 mn / I’ll Be Your Mirror de Nan Goldin et Edmund Coultheard, 49 mn.
Vendredi 22 novembre à 18 h, École supérieure d’art de Clermont-Métropole.
Dimanche 24 novembre à 13 h, Comédie de Clermont-Ferrand.
Entrée libre, réservation recommandée auprès de la Comédie.

Publication du livre L’œil photographique
370 pages - 115 reproductions couleur - français/anglais
Design graphique : Supaire Frappe
Préfaces d’Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication
et de Richard Lagrange, Directeur du CNAP
Texte de Jean-Charles Vergne, Directeur du FRAC Auvergne, commissaire de l’exposition
Notices détaillées sur chacune des œuvres exposées.
39 €

L’année 2013 est celle du 30ème anniversaire de la création des FRAC. Ce
moment apparaissait comme particulièrement opportun pour entamer un
dialogue fécond entre le FRAC Auvergne et la plus importante collection
publique d’art contemporain de France – celle du Centre national des arts
plastiques. Cette exposition, conçue grâce à une carte blanche accordée par
le CNAP, permet au public de découvrir les œuvres de photographes majeurs
de ces cinquante dernières années, réunies pour la première fois en Auvergne.
Elle est aussi l’occasion d’un exceptionnel dépôt de plus de 60 photographies
présentes dans cette exposition que le CNAP a généreusement accepté de
coner au FRAC Auvergne pour plusieurs années. L’exposition s’accompagne
de la publication d’un important ouvrage consacré à la photographie
contemporaine, dans lequel chaque œuvre fait l’objet d’une notice détaillée.
L’ œil photographique n’est pas une exposition sur l’histoire de la photographie.
Bien que la majorité des 40 artistes qui la compose soit d’ores et déjà
inscrite dans l’histoire de la photographie, le propos consiste davantage à
traverser quelques-uns des territoires investis par le geste photographique. La
géographie sera donc ici préférée à l’histoire.
La sélection opérée au sein de la collection du CNAP est liée à une histoire
qui n’est pas tant celle de la photographie que celle de la collection elle-même.
C’est après avoir visionné ce corpus de 12000 œuvres que se sont dessinées
peu à peu les pistes possibles pour ce projet. Préférer la géographie à l’histoire
implique de s’engager sur les territoires investis par la photographie à partir de
cette grande collection qui conserve autant les créations d’artistes consacrés
internationalement que des images dont le statut est plus ambivalent,
comme ce cliché rapporté de la planète Mars par la NASA ou la célèbre et
problématique « Madone de Bentalha » du photojournaliste Hocine Zaourar.
L’exposition et le livre publié à cette occasion se découpent en huit stations
augmentées d’un prologue et d’un épilogue. Ces dix moments constituent
une somme de territoires connectés les uns aux autres par les éléments
indispensables à l’acte photographique que sont les organes constitutifs de
l’œil humain – fovéa, macula, cristallin, point aveugle –, auxquels s’ajoutent des
dimensions plus symboliques – géographie, astres, larmes, etc. Le parcours de
l’exposition forme une boucle dont le commencement et la n sont structurés
par les deux géographies (re)constituées par la photographie de tambour de
Patrick Tosani et la vue martienne de la NASA. Entre ces deux pôles, les œuvres
opèrent une traversée de quelques territoires du geste photographique, du
documentaire à la ction. Certains de ces territoires ne sont que des îlots, des
ponctuations intenses ; d’autres se développent sur des supercies plus vastes.
Le livre, que nous avons souhaité le plus complet possible, présente chacune
des œuvres de manière détaillée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%