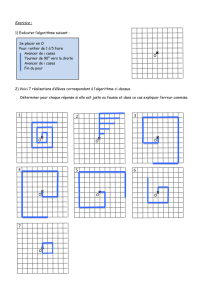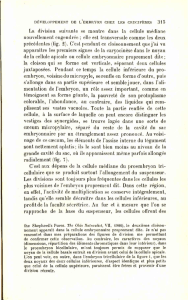LA LOMBALGIE

1
LA LOMBALGIE
Docteur Yann Philippe CHARLES, Professeur Jean-Paul STEIB, Service de
Chirurgie du Rachis, Hôpital Civil
1. INTRODUCTION
La pathologie dégénérative du rachis lombaire est fréquente : la majorité des adultes
ressent au moins un épisode de lombalgie au cours de sa vie. Des études
épidémiologiques montrent que 65 à 90% de la population générale pourrait souffrir à un
moment donné de douleurs lombaires. Les douleurs lombaires chroniques représentent
un problème de santé publique, en raison de leur importante morbidité et de leur
retentissement socio-économique. Ces douleurs sont essentiellement générées par un
processus dégénératif siégeant aussi bien au niveau du disque intervertébral qu’au
niveau des facettes articulaires. Elles se traduisent cliniquement par une lombalgie
aboutissant à une limitation fonctionnelle de la mobilité du tronc. Par ailleurs, ce
processus dégénératif peut également aboutir à une mobilité anormale, voire à une
hypermobilité du segment lombaire et à un glissement vertébral appelé spondylolisthésis.
Ce degré de pathologie dégénérative s’associe à une sténose lombaire se manifestant par
une sciatalgie, voire une symptomatologie de type claudication neurogène.
2. PHYSIOPATHOLOGIE
De nombreux facteurs ont été incriminés dans la physiopathologie dégénérative du rachis
lombaire. La répartition des contraintes entre le disque et les articulaires entraîne une
interaction indissociable des structures lombaires antérieures et postérieures. Le
processus dégénératif de la colonne vertébrale résulte en grande partie de l’usure discale
mécanique, qui représente un cycle physiopathologique débutant déjà chez l’adulte
jeune, mais aussi de facteurs biochimiques, génétiques et infectieux.
La discopathie
La discopathie est caractérisée par une déshydratation de la partie centrale du disque : le
nucleus (Fig. 1). Ceci engendre progressivement une perte de hauteur discale avec une

2
inflammation et une irritation du filet nerveux sur le pourtour du disque : l’annulus. Ce
phénomène est responsable de lombalgies discales et de lumbagos.
Fig. 1 : Anatomie du disque intervertébral normal à gauche et aspect
anatomopathologique de la discopathie montrant la fissuration du nucleus à
droite.
L’affaissement du disque crée un hypercontact des articulaires postérieures associé à une
arthrose des facettes articulaires. Le surpoids majore les contraintes au niveau du disque
et des articulaires et accélère leur usure.
L’arthrose facettaire
L’arthrose facettaire (zygarthrose) représente la deuxième cause mécanique de la
lombalgie en raison de la riche innervation des capsules articulaires. Les douleurs
lombaires en position debout sont typiques et sont majorées en extension. La
dégénérescence articulaire entraîne une sagittalisation des facettes et un cisaillement
intervertébral.
Le spondylolisthésis dégénératif
Le spondylolisthésis dégénératif apparaît alors comme un glissement vertébral vers
l’avant par rapport à la vertèbre sous-jacente. Il survient généralement chez l’adulte de
plus de 40 ans, fréquemment au niveau L4-L5. Les changements hormonaux de la
ménopause ayant une influence sur le système musculaire et ligamentaire, expliquent la
prédominance féminine de cette pathologie. La Fig. 2 illustre les principaux facteurs
mécaniques contribuant à la dégénérescence lombaire.

3
Fig. 2 : Facteurs mécaniques de dégénérescence lombaire : affaissement du
segment suite à la discopathie, hypercontact et arthrose articulaire,
spondylolisthésis et formation d’ostéophytes intracanalaires.
3. EXAMEN CLINIQUE
L’examen clinique est essentiel pour poser un diagnostic. La rencontre avec le patient
nous apprendra parfois plus sur son histoire. Ecouter un lombalgique, c’est déjà le traiter
car il y a dans cette pathologie une dimension affective importante. On connaîtra très
vite le contexte qui fera que le patient est plutôt candidat à un traitement conservateur,
une chirurgie ou une prise en charge pluridisciplinaire. Le diagnostic sera ébauché par la
clinique et confirmé par les examens complémentaires. Les étiologies psychosomatiques
et la recherche d’un bénéfice secondaire doivent systématiquement être prises en
compte lors de l’anamnèse.
L’interrogatoire
L’interrogatoire débute l’examen clinique. Ecouter et regarder apportent 80% du
diagnostic. Le patient raconte sa douleur, les circonstances déclenchantes, la durée, la
fréquence, l’intensité et les conséquences sur sa vie. La douleur impulsive à la toux signe
sa nature discale. La douleur est mécanique : elle est améliorée en position couchée,

4
présente en position debout et maximale en position assise. Le patient s’aide souvent des
bras pour diminuer la pression discale quand il est assis.
Il préfère souvent rester debout lors de l’interrogatoire. Il est soulagé en position chien
de fusil, couché ou accroupi (Fig. 3) .
En position assise, l’effacement de la lordose bascule le maximum du poids sur
le disque. Le disque malade mis en pression se déforme et entraîne une douleur.
En position debout le poids est concentré sur les articulaires postérieures et
entraîne moins de déformation discale. Lors de la flexion non contrainte du rachis, le
disque se tend en arrière et les récepteurs nociceptifs ne sont plus comprimés : le patient
est soulagé. Le mécanisme est inverse en cas de hernie discale : la pression antérieure
sur le nucléus fait sortir la hernie en arrière dans le canal et exacerbe la douleur.
Fig. 3 : Positions typiques de la lombalgie discale, permettant de diminuer la
pression intradiscale : limitation de la douleur en s’appuyant sur les bras,
soulagement de la douleur en position accroupie ou en chien de fusil.
L’examen clinique
L’examen clinique débute debout, le patient est torse nu. On peut observer le rachis et
noter un effacement de la lordose, l’absence de déformation ou l’horizontalité du
bassin. La pression du rachis à deux mains, le pouce en arrière, les doigts en avant
recherche une douleur provoquée. On en connaîtra ainsi le niveau. On étudie la mobilité
rachidienne par le test de Schober : deux marques cutanées espacées de 10 cm en
position neutre, devront passer à 15 cm sur un dos normal en flexion, à moins de 10 cm
sur un dos raide ( Fig. 4 ). La distance doigts-sol signe plutôt une raideur des ischio-
jambiers qu’une raideur rachidienne.

5
Fig. 4 Détermination du niveau douloureux (crêtes iliaques = L4) et test de
Schober mesurant l’allongement d’une distance de 10 cm en flexion en partant
du sacrum (normal = 10/15).
L’examen se poursuit couché en travers du lit d’examen. On dispose ainsi d’un
contre-appui à la pression du rachis. On pressera les épineuses avec les pouces à droite
et à gauche pour déclencher un mouvement intervertébral segmentaire douloureux. On
pressera aussi le rachis vers l’avant toujours à la recherche d’une douleur provoquée. On
notera le niveau douloureux par rapport aux crêtes iliaques (L4). Si la mise en lordose
sur la table (poussée des membres supérieurs, bassin sur le lit) et la pression
paravertébrale postérieure est électivement douloureuse, l’origine des douleurs
est articulaire postérieure ( Fig. 5 ).
Fig. 5 : Douleur paravertébrale élective évocatrice d’une arthrose articulaire
postérieure, à différencier des douleurs musculaires palpables sous forme de
« cordes musculaires » raides.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%




![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)