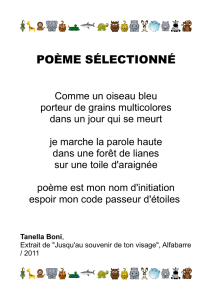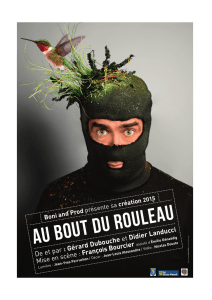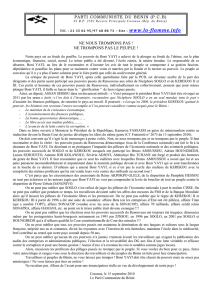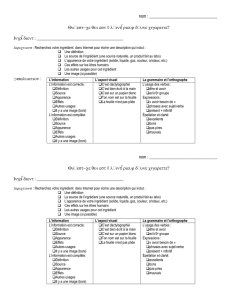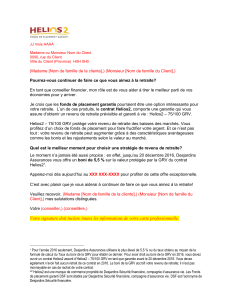Résumé plus long de la thèse de Jean MOOMOU Les Boni à l`âge

1
Résumé plus long de la thèse de Jean MOOMOU
Les Boni à l’âge de l’or et du grand takari (1860-1969) :
« Temps de crises, temps d’espoir »
Nos investigations antérieures, le mémoire de Maîtrise notamment, nous ont permis de
retracer l’histoire des Boni de Guyane de 1772 à 1860. Ce travail a montré non seulement la
manière dont émerge le groupe de Marrons boni qui donnera naissance à un peuple, mais
également la façon dont l’histoire coloniale a produit les Boni et comment les Boni à leur tour
ont fait leur propre histoire. Le 8 septembre 1860, ils sont reconnus libres et autonomes par
les autorités coloniales françaises et hollandaises. Ainsi, loin du monde colonial, ils créent
leur propre univers culturel, religieux. Mais cette vie harmonieuse qui semble naître en 1860
sera très vite perturbée par des circonstances extérieures. La présente étude vise à rendre
lisibles d’une part, les interactions entre la politique des autorités coloniales françaises ou
hollandaises et celle des communautés marronnes, notamment les Boni. D’autre part, elle
cherche à expliquer comment les Boni se sont adaptés aux entreprises exogènes (introduction
de l’économie aurifère et marchande, exploitation forestière, projet politique des autorités
coloniales puis départementales) qui ont bouleversé l’intérieur de leur société sur le plan de
l’autorité traditionnelle, sur le plan économique et social, sur le plan de leur univers culturel et
mental entre 1860 et 1969. Quelle est la nature des transformations ? Comment l’introduction
de l’économie marchande dans le Lawa a-t-elle induit une transformation des valeurs de la
communauté boni ? Quels en sont les facteurs ? Il est question aussi à travers cette étude de
poser la question du sort des sociétés traditionnelles du Maroni, en l’occurrence celle des
Boni, confrontées à l’univers du colonisateur français et hollandais. En effet, saisis par le
regard des habitants du monde colonial, mais aussi par des valeurs, des mœurs jusque-là
inconnues, les « Baka-fii-man nengue » (les nègres de l’âge de paix) pour reprendre
l’expression qu’emploient les « Sabi-man » boni d’aujourd’hui, ont du mal à concilier
tradition et modernité, et à comprendre l’évolution de leur société. N’ayant pas les armes pour
résister à l’invasion d’hommes nouveaux et de mœurs nouvelles, les générations des « nègres
de l’âge de paix » vont tout faire pour ne pas compromettre le sens de l’histoire. Cette attitude
provoque un sentiment d’infériorité contraire à la fierté de soi qui prévalait à l’« âge du
marronnage ». Autrement dit, cette société coutumière de plus de 700 hommes, de femmes et
d’enfants en marge du monde colonial en 1860 a été secouée par les effets de l’économie

2
marchande et de la modernité qui engendre une déstabilisation de la base matérielle
traditionnelle, une transformation des représentations ainsi qu’une altération des règles de vie
collective. L’« âge de l’or et du grand Takari » signe l’acte de naissance d’une nouvelle
société boni où l’économie, le politique deviennent le centre des préoccupations des
individus. En définitive, il s’agit d’une étude de l’évolution de la société boni avec une double
approche : une étude des événements qui ont produit le changement de 1860 à 1969 et une
analyse de la nature des transformations.
L’étude que nous avons menée concerne un peuple sans écriture. Par conséquent, elle
pose des questions d’ordre méthodologique. Aux méthodes historiques occidentales fondées
sur l’écrit doivent être adjoints les outils d’analyse anthropologique de la tradition orale. Notre
objectif a été double. D’une part, nous avons voulu faire intervenir la perception de l’histoire
telle que la conçoivent les Boni eux-mêmes. D’autre part, nous l’avons confrontée avec celle
recueillie par les administrateurs coloniaux. Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous avons
utilisé les sources dites traditionnelles dont l’oralité est le principal vecteur, mais aussi les
sources écrites, telles la cartographie ancienne, les documents d'archives du Surinam et de la
Guyane française, les récits de voyages (Crevaux, Coudreau, Brunetti, à la fin du XIXe siècle,
Laveau, Jean Tripot au début du XXe siècle, Jacques Perret en 1930), des travaux
d’anthropologues (Wim Hoogbergen, Kenneth Bilby, Richard Price…), d’historiens (Silvia De
Groot, Tristan Bellardie), de géographes (Elysée Reclus, Jean Hurault, Frédéric Piantoni). Si le
traitement des sources écrites et iconographiques nous a paru plus aisé, il n’en a pas été de
même pour les sources orales. En effet, comment écrire l’histoire des Boni, quand le récit de
celle-ci passe par la mémoire collective, clanique, familiale, catégorielle, individuelle utilisant
comme mode d’expression la tradition orale ? Pour saisir cette histoire, il était important pour
nous de connaître les « cadres sociaux » de la transmission orale. En effet, l’acquisition et la
transmission des connaissances et des pratiques s'opèrent selon des processus complexes qui
révèlent le lien fondamental entre la connaissance, le savoir et le pouvoir. Ceux qui savent
sont les maîtres de la communauté. Les « Sabi-man »1 portent non seulement en eux l’« âge
des anciens » (esclavage et marronnage), mais aussi celui des « Baka Fii-man » (génération de
l’âge de la paix), un passé qui n’est pas « mort » mais qui vit en eux. Enfin, parmi les autres
modalités de conservation du passé des Boni interviennent les documents audio-visuels et
1 Un « Sabi-man » est celui qui non seulement sait mais qui a la maîtrise du savoir historique et le savoir-faire du
groupe.

3
depuis quelque temps, des monuments historiques. Ces sources exigent à la fois de la vigilance
et un examen critique particulier.
La réalisation de ce travail nous exigé une élaboration d’une méthodologie pour l’étude
de la mémoire et de l’histoire du peuple boni. En effet, la saisie de l’histoire de ce groupe sous
l’angle de la mémoire n’a pas été aisée, compte tenu du fait que d’une part, elle a peiné à se
voir intégrée dans la recherche historique universitaire qui la considère comme aléatoire,
insaisissable, changeante, manipulable. Ses formes tronquées, ses mythes et ses défaillances la
rendent peu crédible pour accéder à la « vérité historique ». Disons cependant, que les
historiens, comme le souligne Jacques Revel, ne sont plus les seuls dépositaires de la « vérité
historique », d’autres « […] acteurs sont aujourd’hui présents sur la scène historiographique
[…] des journalistes, […] des juges, […] enfin des politiques […] »2. Deux types d’histoire
s’opposent donc c’est-à-dire une « histoire charnelle »3 qui travaille avec la mémoire et une
histoire universitaire qui met tout à distance et qui, d’une certaine manière, a du mal à faire
intervenir la mémoire dans l’histoire-science. Cette conception apparaît à nos yeux, comme
c’est le cas pour d’autres historiens (Lucien Febvre4 jadis et Christophe Prochasson5
aujourd’hui), tout à fait illusoire ; elle mène à une histoire qui passe à côté d’une certaine
vérité. Notons que ce débat court toujours et oppose donc les partisans de la mémoire aux
partisans de la science historique. C’est ainsi que la première serait la transmission de la
culture, tout en restant fidèle à la parole des Anciens, la seconde en revanche affirmerait une
volonté de se rattacher à la science, c’est-à-dire de procéder rationnellement par hypothèse,
expérimentation, déduction et vérification. C’est là que le bât blesse. Pouvions-nous écrire une
histoire des Boni qui utilise l’angle de la mémoire comme piste de lecture, conscient du peu de
confiance que la science historique lui réserve ? Ou devions-nous abonder dans le sens de la
science historique en nous appuyant uniquement sur les sources savantes ? Quelle position
adopter ? Si nous optons pour la première position, nous risquons de nous enfermer dans notre
étude et de nous éloigner des exigences universitaires mais en même temps de trahir la
2 Jacques Revel, « Le tribunal de l’opinion », in L’Histoire en procès : manipulations, mythes et tabous, Le
Nouvel Observateur, Hors-série n°70, octobre-novembre 2008, p. 9.
3 Expression chère à Charles Péguy.
4 Lucien Febvre, Combats pour l’Histoire, Editions Armand Colin, Paris, 1992, p. 3-4.
5 Christophe Prochasson, L’empire des émotions Les historiens dans la mêlée, Editions Demopolis, Paris, 2008,
255 pages.

4
manière des Boni de penser et de raconter leur passé. De même, si nous excluons la mémoire
de notre étude consacrée pourtant à un peuple qui n’a pas écrit son histoire pour utiliser
uniquement les sources écrites, notre étude porte certes sur les Boni mais ne s’adresse pas
tellement aux Boni. Afin de sortir de cette impasse qui nous a longuement taraudé l’esprit au
début de cette thèse et de trouver un juste équilibre, il nous fallait dépasser cette « […]
opposition canonique […] »6, un peu artificielle pour essayer de mettre en synergie la mémoire
et l’histoire. Autrement dit, le recours aux sources orales et à la fois écrites s’imposait. Pierre
Nora opposait en 1984 très nettement mémoire et histoire. Aujourd’hui - et Pierre Nora7 en
convient à la fin de son ouvrage, « Lieux des Mémoires », étalé sur plusieurs années - nous ne
pouvons à ce point séparer l’histoire de la mémoire. Nous travaillons, nous historiens, aussi
avec la mémoire, la nôtre comme celle des autres et il est par conséquent bon d’entendre les
mémoires pour mieux les recueillir, les analyser et alimenter l’histoire que ces mémoires
rappellent. Cependant, il faut leur adjoindre une enquête orale et une méthode rigoureuse de
traitement des informations recueillies. D’autre part, l’actualité médiatique n’accorde pas non
plus une image sereine au culte de la mémoire en raison de son instrumentalisation par des
minorités autrefois marginalisées notamment en France qui la saisissent pour inscrire dans
l’histoire nationale leur propre vision de l’histoire. Autrement dit, nous assistons depuis
quelque temps à un certain culte de l’avenir qui semble faire place à une religion du passé se
traduisant par une guerre des mémoires qui malmène l’analyse historique scientifique. Cette
guerre des mémoires, combinée à une surenchère politique8 à la fois nationale, régionale et
locale, n’a fait que compliquer davantage la recherche historique plus compliquée. Si cette
guerre des mémoires trouve un champ d’application de façon exacerbée dans le monde antillo-
guyanais-réunionais et dans certaines minorités issues de l’immigration (africaines,
maghrébines) en France hexagonale, elle semble ne pas avoir cours chez les Boni et les autres
Bushinengue vivant sur le territoire guyanais. Dans la conception de ces descendants de
6 Expression empruntée à l’historien François Dosse, in M. Fournier, « Les réveils de la mémoire », Revue
Sciences Humaines hors-série N°36 Mars-Avril-Mai 2002, p. 35.
7 Cf, Pierre Nora, « Mémoire collective », in Jacques Le Goff, Roger Chartier, et Jacques Revel (dir), La
Nouvelle Histoire, Editions Retz, Paris, 1978, p. 398-401.
8 Pierre Nora, « La politisation de l’histoire », in L’Histoire en procès : manipulations, mythes et tabous, Le
Nouvel Observateur, Hors-série n°70, octobre-novembre 2008, pp. 6-8. Lire également, Jacques Revel, « Le
tribunal de l’opinion », in L’Histoire en procès : manipulations, mythes et tabous, Le Nouvel Observateur, Hors-
série n°70, octobre-novembre 2008, pp. 9-10.

5
Marrons, s’ils devaient revendiquer une place dans l’histoire officielle, ce serait auprès de la
Hollande et du Surinam plutôt qu’auprès de la France bien que depuis les années 1990, ils
affichent leur présence dans le domaine politique et culturel et soulignent le rôle qu’ils ont
joué, notamment les Boni, dans la conquête et la maîtrise des « espaces Intérieurs » par le
pouvoir colonial puis départemental français. Il y a une utilisation de la mémoire par les Boni
pour s’opposer à la législation française (règlementation aurifère, création du parc naturel)
mais nous ne pouvons pas parler d’instrumentalisation. En revanche, il y a bien une
manipulation de la mémoire à l’intérieur de la société boni, comme c’est le cas dans les autres
groupes bushinengue par des « lo » (clans) et des individus en quête de légitimité. Cette
instrumentalisation de la mémoire à l’intérieur de la société boni ne doit pas nous laisser
indifférent et requiert notre vigilance. Mieux cerner cette problématique de la mémoire et de
l’histoire chez les Boni appelle à nous appuyer sur les contributions d’anthropologues et
d’historiens sur le travail de la mémoire mais aussi sur celles d’auteurs qui ont œuvré sur le
même terrain que nous pour ensuite adopter notre propre stratégie de travail. D’autre part,
cette problématique de la mémoire et de l’histoire nous oblige à nous demander s’il existe une
réelle différence entre ces deux concepts dans le contexte boni.
Dans une société traditionnelle, la mémoire utilise l’oralité comme moyen d’expression
et de transmission. Nombre d’anthropologues ou d’historiens9 ont eu « […] le souci
d’appréhender la vie quotidienne passée autrement qu’à travers les filtres trompeurs des
textes ; ils souhaitaient retrouver les mentalités et sensibilités d’une époque et d’un lieu, d’un
groupe social ou religieux, auprès des hommes et des femmes qui « n’avaient pas d’histoire »
[…] »10. Jan Vansina11, Claude-Hélène Perrot12, les historiens de l’école des Annales (Lucien
9 E. Bernheim, A. Feder, W. Bauer, A. Van Gennep9, Robert Lowie, Claude Lévi-Strauss, Hubert Deschamps,
Jan Vansina, Georges Mazenot9, Philippe Joutard, Vincent Milliot, Claude-Hélène Perrot, Myriam Cottias pour
n’en citer que quelques-uns.
10 Vincent Milliot, « L’enquête orale », in Alain et Didier Guyvarc’h : Guide de l’histoire locale Faisons notre
histoire !, Editions du Seuil, Paris, 1990, p. 130-131.
11 Jan Vansina, De la tradition orale Essai de méthode historique, Musée Royal de l’Afrique Centrale Tervuren,
Belgique Annales Série I n 8° Sciences humaines n°36, 1961, 179 pages.
12 Claude-Hélène Perrot (dir), Le passé de l’Afrique par l’oralité, collection La Documentation Française, Paris,
1993, 304 pages ; Claude-Hélène Perrot, « La tradition orale n’est pas un terrain vague », Cahiers d’Etudes
africaines, 1977, p. 66-67.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%