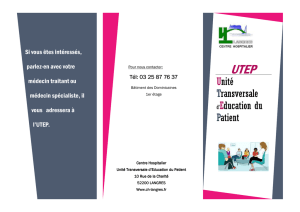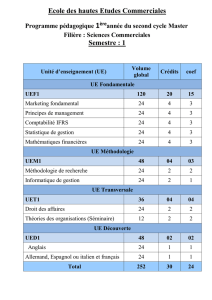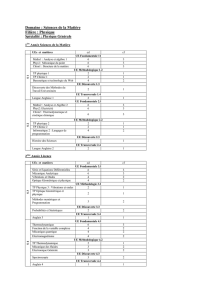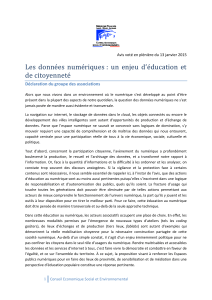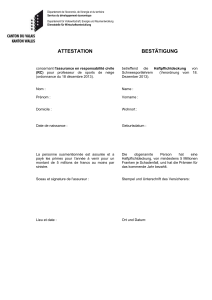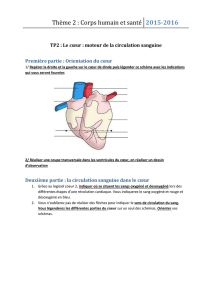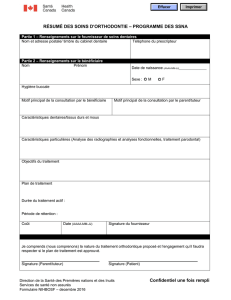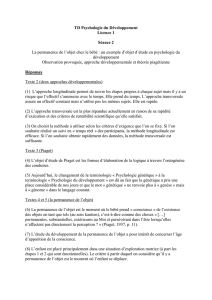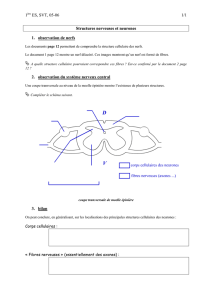arts et sciences en recherche transversale erkundungen in kunst

arts et sciences en recherche transversale erkundungen in kunst und wissenschaft 1/10
revue annuelle européenne
Ein europäisches Jahrbuch
info@transversale.org
www.transversale.org
Sociologue embedded
Propos pour une approche ethnographique du travail journalistique
Nicolas Hubé, Sociologue, Politologue, Strasbourg ([email protected])
Eine auf die Schlagzeilen der Titelseite begrenzte Untersuchung mag zunächst
mit einem soziologischen, noch dazu ethnographischen Ansatz der
Presseanalyse unvereinbar scheinen. Dennoch ist diese Methode eine der
Hauptachsen der Forschung des Autors, da sie es ermöglicht, jenseits von
statischer Inhaltsanalyse zu einer kontextualisierten Sicht auf den
Produktionsprozess dieses Inhalts zu kommen. Sie erlaubt ebenfalls, durch die
Erörterung des mythischen Begriffs der « actualité » (Aktualität) die von den
Berufsakteuren produzierten Rationalisierungen zu erfassen. Die Methode
impliziert allerdings notwendig, dass der Forscher seine Identität von Fall zu Fall
inszeniert und dadurch jeweils die Distanz zu seinem Gegenstand moduliert, um
diesen besser zu verstehen. Die methodische Selbstreflexion soll erste
Bausteine für eine Herangehensweise liefern, die man als verständnisvollen
soziologischen Blick auf journalistisches Arbeiten bezeichnen könnte.
« J’espère que vous avez maintenant un regard pas trop critique sur ce qu’on
fait… vous voyez bien qu’on fait notre maximum avec les moyens minimaux
qu’on nous donne. [Après un temps d’arrêt] Mais c’est aussi votre travail de nous
montrer ce qu’on ne voit plus ! »1
La « Une » de la presse quotidienne renvoie à une notion mythique de la profession journalistique-
l’actualité - offrant au public une vision construite du politique. Pour la comprendre, l’approche
processuelle et ethnographique de l’écriture du titre se révèle heuristique car elle permet pénétrer
la « boîte noire » de l’information : le processus de fabrication de l’actualité.
Inscrit dans une sociologie interactioniste du travail de production de l’actualité, je m’intéresse à
la phase de transformation du fait déjà là - aux mains du journaliste spécialisé ou les demandes
des chefs – en information de premier plan2. Ce n’est autre chose que l’observation en pratique
des règles du champ journalistique et de ses acteurs, tantôt représentants du public, tantôt des
concurrents ou des espaces sociaux traités. J’aborde, ici, les apports de cette démarche
ethnographique3 - croisée aux entretiens semi-directifs – à partir de mes propres données
d’enquêtes4.
Je reviendrai, dans un premier temps, sur l’observation comme méthode, pour m’intéresser
ensuite à la conduite de mes enquêtes au concret. Je m’attarderai, in fine, sur la gestion des
assignations dont le chercheur est porteur dans sa relation sociale avec les journalistes.

arts et sciences en recherche transversale erkundungen in kunst und wissenschaft 2/10
revue annuelle européenne
Ein europäisches Jahrbuch
info@transversale.org
www.transversale.org
L’observation ethnographique comme méthode
Démonter les non-dits
Le processus du choix de l’information repose sur des rituels quotidiens : les conférences de
rédaction et de titre. Il s’agit de saisir comment tous les jours une organisation, entièrement
tournée vers la production d’un journal, structure et contrôle les interactions des service. Or
comme tout geste institutionnalisé, ce processus de transformation est naturalisé par les acteurs
qui considèrent que les informations qu’ils produisent ont une réalité extérieure et coercitive.
L’observation permet de déchiffrer les stratégies de présentation des informations - ou de
résistance aux demandes des chefs, les contraintes concurrentielles, les effets d’un agenda
politique (des élections ou la crise en Irak), dans le choix au concret des sujets. En d’autres
termes, l’observation est un moyen d’analyser le fonctionnement des rédactions à partir du
comportement des acteurs, leurs interactions étant inscrites dans une structuration particulière
construite par l’histoire propre du journal. Les entretiens ne permettent pas toujours de saisir ces
différences.
Ainsi lorsqu’il m’arrive - par mégarde ou maladresse - d’utiliser le terme
« production », « fabrication » ou « construction » de l’actualité, j’essuie un déni
de cette hypothèse, dans les deux pays. Les journalistes me disent que les
informations ne sont pas le fruit d’une invention imaginaire mais une copie de la
réalité sociale qui nous entoure, et rapportées par les sources, les agences, les
autres médias. L’interaction n’est en général pas rompue quand j’explicite
ensuite le terme : ces mots ne sont que des raccourcis scientifiques pour parler
de mon attention au déroulement de leur journée de travail, au comment un
journal est fabriqué, au sens commun du terme.
Il s’agit de briser cette stratégie de défense en signifiant que je m’intéresse au comment et non au
pourquoi d’une activité. Howard Becker explique ainsi qu’en posant la question du comment on fait
une chose, on arrive plus rapidement à la narration que par le pourquoi perçu plus directement
comme le propre du travail scientifique de décryptage5.
La réticence à la réflexivité spécifique des journalistes
La pratique de l’entretien comme « objectivation participante »6, tout comme la posture rigoureuse
de l’entretien ethnographique nécessitant une longue durée d’entretien7, sont très difficiles à tenir.
Plusieurs éléments propre à l’activité journalistique rendent cette pratique difficile.
La temporalité de l’activité journalistique – reposant sur la nécessaire urgence - impose un
rythme rapide des interactions8. Pour les interroger, il faut adapter son emploi du temps à ceux des
agents qui n’ont « pas plus de 30 minutes ». Il faut saisir les opportunités d’un entretien inattendu

arts et sciences en recherche transversale erkundungen in kunst und wissenschaft 3/10
revue annuelle européenne
Ein europäisches Jahrbuch
info@transversale.org
www.transversale.org
(« vous avez deux minutes ? je peux poser quelques questions ? »), ce qui nécessite d’avoir le
dictaphone sur soi. Il convient aussi parfois de laisser le dictaphone éteint, d’écouter sans noter un
discours qui est autant un indicateur des images mentales, des systèmes symboliques, des
rhétoriques de légitimation9 que des savoir-faire que l’on transmet à un enquêteur, appréhendé
comme un stagiaire ou un nouvel-entrant. En me faisant expliquer comment on bâtit une page,
comment telle photographie ou tel titre ont été choisis plutôt que tel autre, j’invite les enquêtés à
mettre en mots leur pratique, sans que cela leur soit coûteux en temps et en investissement
psychique. Cela permet de comprendre en pratique leurs actes.
La difficulté, en situation d’entretien, est de gérer la distance entre deux acteurs issus pour la
plupart des mêmes filières universitaires (ma formation a été effectuée dans un Institut d’études
politiques comme pour une partie non négligeable de mes interlocuteurs) et maîtrisant
sensiblement les mêmes savoir-faire (interview enregistrée, questionnement sur le vécu quotidien).
Perçu comme interviewer, je suis tenu à ce rôle par les enquêtés eux-mêmes.
Ils me rappellent par des ponctuations de phrase comme « voilà ! », « autre
chose ? » leur propre maîtrise des entretiens. La durée de celui-ci ne peut donc
être excessive puisqu’il implique des questions relativement directes. Le
dictaphone fait parfois l’objet de remarques, rappelant ces savoir-faire
professionnels : ayant eu un jour du mal à mettre en route mon appareil, mon
interlocuteur s’exclame « Ah, ça ! les dictaphones… c’est un métier ! ».
Ceci ne signifie pas non plus que les enquêtés refusent l’entretien. Mais les acteurs prêts à
accepter cette situation marquent, en même temps, leur gêne par le recours à des signes visibles
de stress (cigarettes fumées les unes après les autres) ou alors par la mise à distance ironique
(« cette pièce me donne l’impression d’être chez un psy ! »).
Cette résistance est aussi un principe de protection du groupe professionnel. En parlant de leur
activité comme étant difficile à « théoriser » - c'est-à-dire ne répondant d’aucun motif d’action
particulier autre que l’essence des informations -, les journalistes assurent la sécurité ontologique
de leur pratique routinière10. La réflexivité des agents sociaux passe par une mise en mots des
motifs d’une action11. Dans la rationalisation discursive de leur pratique, les journalistes en restent
à leur conscience pratique, c'est-à-dire qu’ils mettent en mots ce qui est pratique. En d’autres
termes, « ils savent “comment faire” sans nécessairement savoir comment dire ce qu’ils font »12.
Produire un discours sur la pratique journalistique revient à produire un discours sur les savoir-
faire historiquement construits et naturalisés. Les acteurs le font d’autant plus facilement qu’ils
« savent » ce qui est attendu de l’enquêteur et que la « Une » est un enjeu stratégique pour la
rédaction. L’enquête ne peut donc qu’être située, placée dans les anecdotes du quotidien vécu par

arts et sciences en recherche transversale erkundungen in kunst und wissenschaft 4/10
revue annuelle européenne
Ein europäisches Jahrbuch
info@transversale.org
www.transversale.org
l’enquêteur et l’enquêté. Il convient de comprendre ensemble « ce qui s’est passé à l’instant » et
non « pourquoi ça se passe comme cela ». Seule l’observation permet de saisir ce pourquoi,
renvoyant à des interactions sociales qui se donnent aisément à voir par leur ritualisation.
La recherche au concret
Comprendre les lieux de l’observation
Dans la démarche ethnographique, il est important de noter les lieux auxquels le chercheur a
accès ou non13. Ils permettent de revenir sur la contextualité des lieux d’interactions afin de mieux
comprendre ces dernières14.Les lieux interdits traduisent un démarquage de l’espace social entre
ce qui relève de l’activité journalistique classique (produire et programmer un journal) et ce qui
relève de l’activité de l’entreprise. Les refus correspondent à des situations auxquelles seuls
certains membres choisis du groupe peuvent assister pour parler des décisions de stratégies
entrepreneuriales. Ainsi, j’ai seulement essuyé trois refus (au Monde, à la Tageszeitung et à Die
Welt) quand j’ai demandé l’autorisation de me rendre à la réunion de chefs services.
Mais ces refus ne s’arrêtent pas aux seuls lieux de décisions économiques. Le chercheur -
comme observateur - est circonscrit dans les lieux où le journal se donne à voir comme
communauté éditoriale, en charge d’un produit collectif. Son statut formel de stagiaire est alors un
argument pour le refuser dans les lieux du pouvoir éditorial : la réunion des chefs de service
chargés de la « Une » à Die Welt, par exemple. Ces frontières institutionnalisées - puisque tous
respectent la même discipline - sont aussi le fruit de l’histoire des journaux, qui n’accordent pas
toujours dans le temps, la même importance aux espaces.
A 20 ans d’écart, on peut noter une différence entre les enquêtes menées au
Monde par J-G. Padioleau15 et la mienne, observant tous les deux la rédaction en
période électorale. Jusqu’au début des années 80, la rédaction du journal se veut
un organe collectif autonome, chargé de la ligne éditoriale du journal. Le comité
de rédaction regroupe tous les journalistes actionnaires et définit la politique
éditoriale, notamment par la nomination du directeur de rédaction. La
programmation quotidienne du journal est ensuite effectuée de manière
autonome dans les services, et rediscutée entre chefs de service lors de la
conférence du matin. J.-G. Padioleau témoigne dans son livre de son regret de
ne pas avoir été accepté dans ce lieu des décisions stratégiques quotidiennes,
mais se félicite de sa facilité à observer les réunions du comité16. A l’inverse,
depuis la réorganisation de 1995, les conférences de rédaction du Monde sont
ouvertes à tous les journalistes qui voudraient s’intéresser à la production
générale et aux visiteurs extérieurs17. Il n’y avait donc pas de raisons que je ne
puisse participer à ces réunions, puisque le journal y est programmé et s’y donne
à voir. En revanche, je me suis vu refuser l’entrée de la réunion mensuelle du
comité de rédaction (portant sur le traitement de la campagne électorale par Le
Monde) au motif que c’est une réunion d’actionnaires et qu’elle concerne la ligne

arts et sciences en recherche transversale erkundungen in kunst und wissenschaft 5/10
revue annuelle européenne
Ein europäisches Jahrbuch
info@transversale.org
www.transversale.org
stratégique du journal. Tout doit rester en interne de peur de la fuite vers la
concurrence.
Cet exemple montre que le lieu de production est étroitement lié à la définition socialement
construite de ce qui relève de l’arbitrage stratégique et/ou arbitraire (donc immontrable) et ce qui
témoigne de la production routinière (donc de l’identité collective d’un organe de presse). Cet
exemple renvoie à une consigne classique faite au jeune ethnologue : la nécessité de bien gérer
son statut d’observateur.
Bien gérer son statut d’observateur
Dès l’instant où l’on pénètre dans une salle de rédaction, une gestion de son statut s’impose.
Avant de pouvoir passer à l’observation proprement dite, je dois passer par deux figures
imposées : le motif de ma présence et la manière dont j’ai pu pénétrer dans ce lieu. Raison
pratique (ai-je un lien avec quelqu’un de la rédaction ?) et raison professionnel (stagiaire d’une
école de journalisme ?). La justification par la thèse – plus encore par l’Université - est suffisante
pour répondre aux deux questions à la fois, mais elle n’entraîne nullement une typification aboutie
du statut et des échanges entre un chercheur et des enquêtés. Leur typification permettrait
d’abaisser considérablement la tension dans les rapports sociaux, dans la mesure où elle rendrait
les actions de l’autre prévisible en les routinisant18.
Or ici, l’enquêteur est constamment amené à jongler avec son identité mise en scène et en
situation. Je suis tantôt politiste, tantôt stagiaire. Le statut de jeune stagiaire induit le recours au
tutoiement. En retour, il m’est permis de tutoyer les journalistes à la base. Le fait de poser des
questions n’est pas non plus gênant, cela nous renvoie au rôle habituel du stagiaire, comme en
témoigne ces notes :
« R : N’hésite pas à poser des questions
Q. Tu vas finir par me détester, si je te harcèle avec toutes mes questions…
R. Non, non du tout ! On a l’habitude des stagiaires ! On est là pour ça… sauf si,
vraiment, ce sont des questions nulles. Mais je te fais confiance pour ça. C’est toi
qui fais une recherche ! »19
En endossant plusieurs rôles, en jouant des différentes situations, en écoutant plusieurs formes de
discours, je suis amené à effectuer un bricolage permanent pour produire ou réduire la distance
qui me sépare des agents que j’observe et j’interroge.
Face aux ouvriers du Livre en France, ma position est toujours ambivalente.
Perçu comme journaliste-stagiaire, ils marquent une forte distanciation. Perçu
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%