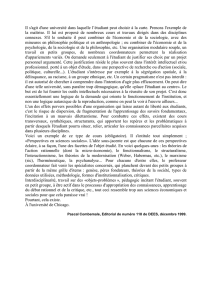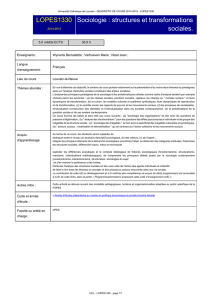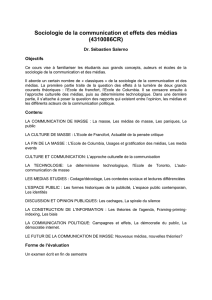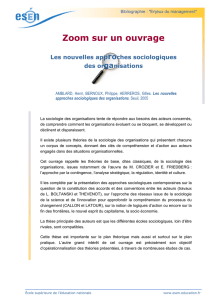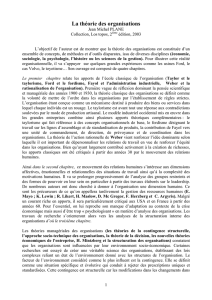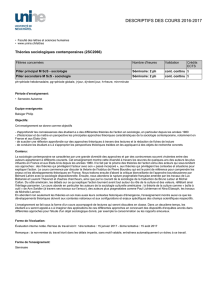La société du risque et la guerre

89
OPINIONS
La société du risque et la guerre
Le chef d’escadron Paul-Marie Vilbé, diplômé du mastère en gestion des risques de
l’École nationale d’administration, est actuellement stagiaire au Collège interamées
de défense, promotion 2009-2010, Maréchal Lyautey.
Paul-Marie VILBÉ
Les débats autour de la vaccination face à la grippe A-H1N1 sont révélateurs
des rapports ambigus que notre société entretient avec les risques qui l’en-
tourent. Malgré la réalité du risque sanitaire, certains citoyens ont fait le
choix de ne pas se faire vacciner car leur inquiétude se focalisait surtout sur la pro-
babilité que le vaccin ne soit pas fiable à 100 %.
On revendique souvent le fait que la société militaire serait « l’émanation
de la nation ». Ainsi, le général Cuche, ancien chef d’état-major de l’Armée de
terre, déclara à l’occasion du 64eanniversaire des combats des Glières, le 30 mars
2008: « Les soldats, les sous-officiers, les officiers de l’Armée de terre d’aujourd’hui
et leurs familles demeurent l’émanation de la Nation ». Les militaires ne peuvent
donc demeurer indifférents aux évolutions sociétales. L’omniprésence de la notion
de risque et les phénomènes comportementaux qui l’accompagnent auraient donc
une influence sur les affaires militaires qui reste à évaluer.
Cependant, cette tendance ne va pas de soi et se révèle même paradoxale,
puisque le métier militaire exige de prendre des risques, alors que le phénomène
sociologique qui nous intéresse, concerne un ressenti anxiogène face aux risques,
dont la simple existence devient intolérable.
La judiciarisation de l’embuscade d’Uzbeen renvoie directement à ce refus
des risques par notre société post-moderne. Cette expression forgée par Lyotard
dans les années 60 est employée par le sociologue Ulrich Beck, tout en reconnais-
sant qu’elle ne désigne qu’imparfaitement notre société contemporaine; son usage
lui permet, néanmoins, de souligner que nous sommes définitivement rentrés dans
une nouvelle étape sociétale, qui rompt avec la précédente.
Ne pas accepter que des hommes, dont c’est pourtant le métier, prennent
des risques révèle un changement profond de notre société, qui entretient désor-
mais à l’égard des risques une aversion maladive.
Cette nouvelle donne sociétale influe sur la manière dont nos sociétés occi-
dentales mènent leurs guerres, à la fois bridées par l’aversion des risques et inspi-
rées par les théories issues du risk-management.

90
Nous vivons dans une « société de risques »
Dans La société du risque, Ulrich Beck démontre que nous avons vécu une
évolution sociétale majeure. Selon ses théories et celles de nombreux sociologues,
notre époque se caractérise, en effet, par une omniprésence des risques, qui devien-
nent ainsi un schéma de pensée dominant. On parle, par exemple, de « civilisation
du risque », « société du risque », « société vulnérable », voire de « culture de la peur ».
Olivier Borraz, dans une récente étude, constate ainsi que « la notion de
risque a « colonisé » le langage des institutions, [qu’]elle est devenue une référence
récurrente pour caractériser toute une gamme de problèmes publics ; bref [qu’]elle
offre un moyen commode pour affronter la complexité qui nous entoure. En ce
sens, elle s’apparente à une boussole improbable avec laquelle on peut s’aventurer
dans un espace peuplé d’incertitudes ».
L’inscription, en 2003, du principe de précaution dans notre constitution
est un exemple emblématique de ce processus sociologique.
Ainsi, nous sommes passés d’une culture visant à dominer les risques à une
culture de soumission aux risques qui influencent nos comportements et modes de
pensée.
Cette société du risque produit des sentiments et attitudes parfois irration-
nels. En témoigne la manière dont le vocabulaire issu des risques se retrouve abu-
sivement employé. On parle ainsi de « tsunami urbain » (titre d’un ouvrage récent)
pour qualifier l’explosion d’AZF, de « séisme » (Ignacio Ramonet et Pascal Lamy)
ou encore de « tsunami » (Jacques Attali) pour se référer à la crise économique. Les
termes de catastrophe et de crise, issus du monde des risques, ont été à ce point
banalisés qu’ils ont perdu tout effet. Il faut donc soit recourir à la métaphore, soit
à l’emphase en rajoutant systématiquement le préfixe hyper — comme dans
l’expression d’« hyperterrorisme » — pour espérer atteindre l’écoute de la société du
risque. L’omniprésence du mot résilience participe de la même logique. Pour expli-
quer la judiciarisation d’Uzbeen, Isabelle Lasserre dans
Le Figaro
du 10 novembre
2009 note que « la France a un problème de résilience ». L’hyperbole laisse croire
que cet événement représenterait un traumatisme profond pour la société française.
En l’espèce, malgré l’ampleur dramatique de cet événement et l’empathie qu’il a
générée, on ne peut pas véritablement parler de crise nationale ni, donc, de la capa-
cité du pays à les surmonter. Ce qui est en jeu dans cette judiciarisation, c’est bien
plutôt notre rapport aux risques et les comportements irrationnels ainsi induits.
Cette irrationalité s’illustre dans notre rapport au risque terroriste. Les
sommes engagées, les débats et la résonance médiatique peuvent sembler dispro-
portionnés en regard de ce risque. Pourtant, c’est justement pour lutter contre le
terrorisme que nos troupes sont engagées en Afghanistan dans une stratégie de
réduction du risque.

91
Pour Clausewitz, si la guerre est un « caméléon », c’est que chaque société
la mène selon des modes propres aux caractéristiques de son époque (Zeitgeist).
Nous avons montré que les risques occupent désormais une place centrale dans nos
perceptions et notre manière d’appréhender le monde. Il s’agit maintenant de voir
comment cette caractéristique sociétale peut modifier la manière de faire la guerre.
Les pratiques militaires reproduisent les modes de pensée de la société du
risque: transfert et évitement des risques, notions d’effet boomerang, de préven-
tion et de « risque zéro »
« Les guerres d’aujourd’hui possèdent des caractères inédits qui nous offrent
l’opportunité de les assimiler aux autres risques de la modernité ».
La littérature associant la sociologie du risque aux sphères stratégico-
militaires est florissante chez les Anglo-Saxons. Poursuivant les théories d’Ulrich
Beck et d’Anthony Giddens, certains auteurs les adaptent au monde de la straté-
gie, afin de redéfinir une pratique de la guerre en phase avec notre époque.
Un des premiers auteurs à avoir — dès 1993 — véritablement théorisé ce
rapprochement est le sociologue britannique Martin Shaw. Dans un livre paru en
2005, il montre que le modèle actuel consiste à s’assurer que les combats génèrent
le moins de nuisances possible pour la puissance occidentale impliquée, en adap-
tant ainsi à la guerre la technique dite de « transfert de risques ». La soumission au
risque est ainsi déplacée sur les forces ennemies et surtout sur les populations
civiles. C’est notamment le cas, selon lui, lors des bombardements aériens.
Cette démarche décryptant les guerres actuelles au prisme de la sociologie
des risques est poursuivie par quatre auteurs issus de la London School of Economics.
Selon eux, la guerre industrielle totale a laissé place à une guerre « post-industrielle »
minimaliste, qui se caractérise par une aversion proactive des risques. Elle repose
sur une stratégie de l’évitement: « Éviter les risques : décider de ne pas prendre un
risque, c’est-à-dire de choisir une autre voie qui ne fait pas intervenir ce risque ». Il
s’agit d’éviter la concrétisation de scénarios reconnus comme probables. Dans la
conception traditionnelle de la guerre, en réponse à une menace réelle et immi-
nente, on cherche à obtenir la victoire par la bataille décisive. Dans le modèle post-
moderne, on définit des risques probables et on cherche soit à les éviter, soit à les
réduire. Face au risque terroriste, il ne s’agit plus de maximiser les moyens pour
vaincre définitivement un ennemi, mais de faire en sorte, par une stratégie pré-
ventive, que ce risque demeure dans des limites acceptables. Il s’agit alors de gérer
et de mitiger les risques.
Si ces théories reçoivent peu d’écho en France, force est de constater leur
prégnance au sein de l’armée américaine, même si, contrairement à la Grande-
Bretagne, peu d’études sociologiques les y accompagnent. Ce thème du risk mana-
gement apparaît omniprésent dans leurs études en relations internationales et dans
les discours politiques. Sans pouvoir être exhaustif, il est intéressant de noter que
OPINIONS

92
les théories du risque influencent la stratégie à travers les notions d’effets boome-
rang, de « préemption » et de refus des pertes.
Les théories présentées par Ulrich Beck relatives aux effets pervers de la
science et du progrès se retrouvent dans la disqualification des thèses présentées par
la Revolution in Military Affairs (RMA). Présentée comme une panacée permettant
d’économiser le sang des troupes et d’obtenir une victoire facile et propre, la RMA
a été sanctionnée par des réalités moins triomphantes, et qui ressortissent de ce que
Beck nomme l’« effet boomerang ». Selon lui, les progrès scientifiques comportent
des effets induits, parfois contre-productifs. Ainsi, le nucléaire, s’il permet de béné-
ficier d’une énergie « propre », est également générateur de risques majeurs, dont
Tchernobyl est une des malheureuses concrétisations. Ainsi, les progrès technolo-
giques vantés par les experts n’ont pas permis la victoire sans risques, mais, au
contraire, se sont accompagnés d’une multitude d’effets induits parmi lesquels le
retour de l’asymétrie et la dé-légitimation de la force.
Si Colin Gray note que la RMA était la théorie à la mode dans les années
90, il relève que le concept de guerre préemptive, théorisé par l’Administration
Bush en 2002 face au risque irakien, lui a désormais ravi la vedette. Il précise, par
ailleurs, que l’usage du terme
preemption
est impropre et qu’il faut lui préférer celui
de prevention. Cette doctrine américaine de la guerre préventive, dont les origines
remontent au XIXesiècle (développée notamment par le Secrétaire d’État Daniel
Webster en 1842, puis par le Secrétaire d’État Elihu Root en 1914), stipule qu’il
est légitime pour un État d’anticiper une menace par une action préventive, afin
d’éliminer un risque dont la concrétisation entraînerait un dommage tel que toute
riposte ultérieure serait trop tardive. Gray, en fonction du degré d’incertitude du
risque, classifie la guerre préventive en preemption (l’attaque ennemie est en cours
ou imminente), prevention (l’attaque est probable) et precaution (un ennemi pro-
bable pourrait recourir à certaines capacités). Ce concept basé sur la spéculation de
risques futurs renvoie directement au principe de précaution. De fait, les person-
nalités de Bush et Rumsfeld sont représentatives de la société du risque. La défini-
tion, par ce dernier, des fameux unknown unknowns est symptomatique de notre
époque, qui redécouvre les incertitudes et ne les supporte pas.
Enfin, la société du risque s’installe dans les débats stratégiques en impo-
sant le refus des pertes (casualty aversion). Cette attitude, souvent résumée à un
simple syndrome vietnamien est beaucoup plus complexe. De même que les
comportements des individus de la société du risque décrits par Ulrich Beck peu-
vent paraître exagérément angoissés, de même, le refus des pertes se révèle ambigu.
Dans une étude sur ce phénomène, le colonel américain Lacquement montre que
la crainte des décideurs politiques et militaires de ne pas être suivis par la popula-
tion en cas de pertes massives, est souvent injustifiée et conduit, inconsidérément,
à anticiper une possible baisse de popularité. Une fois encore, la logique de pré-
caution est à l’œuvre, mais recèle ses « effets boomerang ».

93
Loin d’être synonyme d’efficacité, cette prise en compte des risques réduit
l’efficacité opérationnelle. En prenant l’exemple des combats de Tora Bora en
décembre 2001, le colonel Lacquement montre l’improductivité à laquelle réduit
une prudence inspirée par l’aversion pour les pertes. De fait, si les Américains
avaient osé engager des moyens terrestres massifs dès le début de cette opération,
ils auraient vraisemblablement pu porter un coup fatal à Al-Qaïda voire capturer
Ben Laden. Le refus des pertes, en réduisant le nombre de forces engagées a per-
mis aux terroristes de se réorganiser au Pakistan et a entraîné, de manière contre-
productive, un enlisement du conflit.
Repenser la place du risque dans la société militaire
Si la sociologie s’intéressait jusqu’alors peu à la guerre, la société du risque
pourrait permettre d’y remédier et d’apporter aux études stratégiques une nouvel-
le approche conforme à l’esprit de notre époque. Selon Rémi Baudouï, « si la guer-
re a longtemps relevé d’un épiphénomène pour la sociologie, les évolutions
récentes des conflits armés renvoient précisément à la production d’effets induits
tels que définis par la sociologie du risque. La guerre ne peut désormais plus être
analysée comme la seule relation entre des objectifs recherchés et des résultats
acquis. Elle est plus que jamais un rapport entre des objectifs et une somme
d’effets induits ».
Alors que les effets contre-productifs d’une culture excessivement « risquo-
phobe » ont été relevés, il apparaît nécessaire de redéfinir les rapports que le stra-
tège doit entretenir avec les risques: comment les percevoir, comment s’en prému-
nir, mais aussi comment les accepter pour remporter la décision ?
Dans ce cadre, les théories, concepts et méthodes issus de la gestion des
risques pourraient éclairer utilement le stratège. Les grilles d’analyse cindyniques
(« sciences du danger », discipline scientifique créée en France en 1987 sous
l’impulsion de Georges-Yves Kervern) pourraient, par exemple, aider à renouveler
les méthodes de décision opérationnelle, qui semblent désormais insuffisantes pour
appréhender la complexité des théâtres d’engagements actuels. Les matrices cindy-
niques permettent, entre autres, de déceler les dissonances existant entre acteurs au
sein d’organisations complexes. Elles semblent donc particulièrement adaptées
pour améliorer les structures des coalitions internationales engagées avec des
acteurs civils dans des opérations de maintien de la paix. L’approche réaliste de
Nathan Freier sur la politique à suivre en Afghanistan est une autre manière de
repenser la guerre à l’aune de la gestion des risques. Dans un article intitulé « A risk
management approach to Afghanistan », il démontre que la stratégie qui y est appli-
quée doit revenir aux fondamentaux de la gestion du risque en comparant les coûts
et bénéfices et donc en acceptant de ne pas y éliminer le risque, mais seulement de
le réduire: Afghan failure merits some continued but limited commitment focused
mostly on risk mitigation, not risk elimination.
OPINIONS
 6
6
 7
7
1
/
7
100%